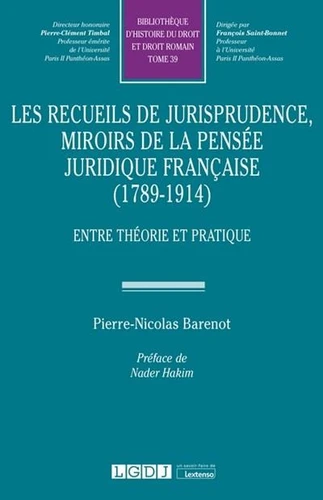Les recueils de jurisprudence, miroirs de la pensée juridique française (1789 - 1914). Entre théorie et pratique
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages450
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.704 kg
- Dimensions15,5 cm × 24,0 cm × 2,5 cm
- ISBN978-2-275-08850-1
- EAN9782275088501
- Date de parution22/02/2022
- CollectionBibliothèque d'histoire du dro
- ÉditeurLGDJ
- PréfacierNader Hakim
Résumé
Au croisement de l'histoire de la pensée, de l'édition et des cultures juridiques, cette thèse propose de revisiter les travaux des arrêtistes du XIXe siècle. L'étude des recueils d'arrêts de jurisprudence met en lumière les relations complexes et mouvantes de la jurisprudence et de la doctrine, du Palais et de l'Ecole, mais aussi les concurrences et les innovations éditoriales qui ont jalonné l'histoire de la littérature juridique contemporaine.
Au croisement de l'histoire de la pensée, de l'édition et des cultures juridiques, cette thèse propose de revisiter les travaux des arrêtistes du XIXe siècle. L'étude des recueils d'arrêts de jurisprudence met en lumière les relations complexes et mouvantes de la jurisprudence et de la doctrine, du Palais et de l'Ecole, mais aussi les concurrences et les innovations éditoriales qui ont jalonné l'histoire de la littérature juridique contemporaine.