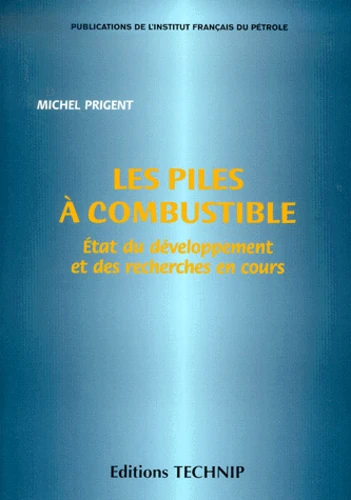Les Piles A Combustible. Etat Du Developpement Et Des Recherches En Cours
Par :Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages63
- PrésentationBroché
- Poids0.165 kg
- Dimensions17,0 cm × 24,0 cm × 0,7 cm
- ISBN2-7108-0792-0
- EAN9782710807926
- Date de parution01/01/2001
- ÉditeurTechnip (Editions)
Résumé
Des recherches très actives sur les piles à combustible sont menées actuellement un peu partout dans le monde. Quatre principaux types de piles sont étudiés : piles à membranes polymères (fonctionnant vers 80-100°C), piles à acide phosphorique (180-210°C), piles à carbonates fondus (600-700°C) et piles à oxydes solides (850-1000°C). Pour les piles basse température, le seul combustible acceptable est l'hydrogène très pur (celui-ci ne doit pas contenir plus de quelques ppm de CO pour les piles à membranes). Avec le méthanol, les performances obtenues sont encore insuffisantes. Pour les piles à acide phosphorique, la teneur en CO de l'hydrogène peut atteindre 1% ; et, dans les piles à carbonates fondus, le combustible peut même être le mélange CO-H2 issu directement du vaporeformage d'un hydrocarbure quelconque ou de la gazéification du charbon. Pour une alimentation directe par un hydrocarbure, il faut avoir recours aux piles à oxydes solides, dans lesquelles la conversion en hydrogène peut se faire directement au contact des électrodes. Les principaux avantages des piles sont leur rendement (entre 40 et 70%), leur très faible niveau d'émission de polluants et leur fonctionnement silencieux. Mais, malgré une baisse sensible au cours de ces dernières années, leur coût est encore prohibitif pour de nombreuses applications. Dans d'autres secteurs, où ce coût pourrait être accepté, c'est leur durabilité sur de très longues périodes qui est encore à prouver. Trois domaines d'application sont visés : les transports, la cogénération chaleur-électricité et la production décentralisée d'électricité. Dans le secteur des transports, les difficultés majeures sont : le stockage embarqué d'H2, le coût des blocs et la disponibilité du platine. Même si des démonstrateurs sont régulièrement présents dans les grands programmes de R&D à financement public, l'usage généralisé des piles dans ce secteur semble très peu probable à court terme. Pour la cogénération et les petites centrales (de la dizaine de kW à quelques MW), l'utilisation de piles fonctionnant au gaz naturel pourrait être stimulée par la dérégulation de la distribution des énergies. Leur entrée sur le marché pourrait être assez rapide (vers 2005-2010). Le taux de pénétration dépendra essentiellement de leur fiabilité et du compromis coût-endurance.
Des recherches très actives sur les piles à combustible sont menées actuellement un peu partout dans le monde. Quatre principaux types de piles sont étudiés : piles à membranes polymères (fonctionnant vers 80-100°C), piles à acide phosphorique (180-210°C), piles à carbonates fondus (600-700°C) et piles à oxydes solides (850-1000°C). Pour les piles basse température, le seul combustible acceptable est l'hydrogène très pur (celui-ci ne doit pas contenir plus de quelques ppm de CO pour les piles à membranes). Avec le méthanol, les performances obtenues sont encore insuffisantes. Pour les piles à acide phosphorique, la teneur en CO de l'hydrogène peut atteindre 1% ; et, dans les piles à carbonates fondus, le combustible peut même être le mélange CO-H2 issu directement du vaporeformage d'un hydrocarbure quelconque ou de la gazéification du charbon. Pour une alimentation directe par un hydrocarbure, il faut avoir recours aux piles à oxydes solides, dans lesquelles la conversion en hydrogène peut se faire directement au contact des électrodes. Les principaux avantages des piles sont leur rendement (entre 40 et 70%), leur très faible niveau d'émission de polluants et leur fonctionnement silencieux. Mais, malgré une baisse sensible au cours de ces dernières années, leur coût est encore prohibitif pour de nombreuses applications. Dans d'autres secteurs, où ce coût pourrait être accepté, c'est leur durabilité sur de très longues périodes qui est encore à prouver. Trois domaines d'application sont visés : les transports, la cogénération chaleur-électricité et la production décentralisée d'électricité. Dans le secteur des transports, les difficultés majeures sont : le stockage embarqué d'H2, le coût des blocs et la disponibilité du platine. Même si des démonstrateurs sont régulièrement présents dans les grands programmes de R&D à financement public, l'usage généralisé des piles dans ce secteur semble très peu probable à court terme. Pour la cogénération et les petites centrales (de la dizaine de kW à quelques MW), l'utilisation de piles fonctionnant au gaz naturel pourrait être stimulée par la dérégulation de la distribution des énergies. Leur entrée sur le marché pourrait être assez rapide (vers 2005-2010). Le taux de pénétration dépendra essentiellement de leur fiabilité et du compromis coût-endurance.