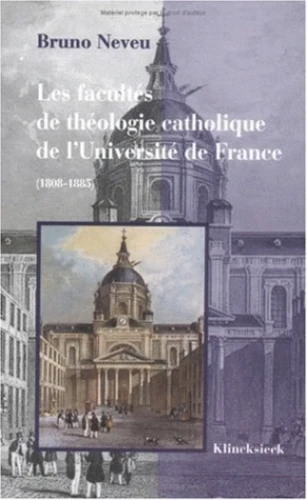Les facultés de théologie catholique de l'Université de France. 1808-1885
Par :Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Nombre de pages844
- PrésentationBroché
- Poids1.325 kg
- Dimensions16,3 cm × 24,1 cm × 4,6 cm
- ISBN2-252-03216-2
- EAN9782252032169
- Date de parution27/11/1998
- CollectionMélanges de la Bibliothèque
- ÉditeurKlincksieck
Résumé
Dans le cadre des rapports entre l'Eglise et l'Etat en France au XIXe siècle, l'existence des facultés de théologie catholiques instituées en 1808 au sein de l'Université impériale sans accord du SAINT-SIEGE, a contraint les gouvernements successifs à d'épineuses négociations avec la Cour de Rome. La nécessité de pourvoir ces établissements d'un statut canonique était admise, mais faisait difficulté la part prépondérante de l'Etat dans les nominations, la collation des grades, la surveillance de l'enseignement. Sachant les réserves grandissantes d'un épiscopat de plus en plus acquis à l'ultramontanisme et peu soucieux de haute culture ecclésiastique, Rome n'eut guère de considération pour un corps professoral tenu pour majoritairement attaché au gallicanisme et qui n'avait pour ainsi dire pas d'étudiants à ses cours, sauf à Paris où la faculté de la Sorbonne exerça sous le Second Empire et aux débuts de la Troisième République, avec la forte personnalité du Doyen Henry Maret, une réelle attraction. La création de facultés libres à partir de 1875 acheva d'affaiblir la position des facultés d'Etat, que le combat anticlérical fit sombrer en 1885, les facultés de théologie protestante se maintenant jusqu'à la Séparation de 1905. L'examen approfondi auquel on a procédé ici, d'après de nombreuses sources inédites, éclaire des aspects peu connus de l'Histoire de l'Université de France au XIXe siècle, du développement des études théologiques dans le clergé, du gallicanisme administratif et politique, de l'action diplomatique du Saint-Siège concernant des points exclus des dispositions concordataires.
Dans le cadre des rapports entre l'Eglise et l'Etat en France au XIXe siècle, l'existence des facultés de théologie catholiques instituées en 1808 au sein de l'Université impériale sans accord du SAINT-SIEGE, a contraint les gouvernements successifs à d'épineuses négociations avec la Cour de Rome. La nécessité de pourvoir ces établissements d'un statut canonique était admise, mais faisait difficulté la part prépondérante de l'Etat dans les nominations, la collation des grades, la surveillance de l'enseignement. Sachant les réserves grandissantes d'un épiscopat de plus en plus acquis à l'ultramontanisme et peu soucieux de haute culture ecclésiastique, Rome n'eut guère de considération pour un corps professoral tenu pour majoritairement attaché au gallicanisme et qui n'avait pour ainsi dire pas d'étudiants à ses cours, sauf à Paris où la faculté de la Sorbonne exerça sous le Second Empire et aux débuts de la Troisième République, avec la forte personnalité du Doyen Henry Maret, une réelle attraction. La création de facultés libres à partir de 1875 acheva d'affaiblir la position des facultés d'Etat, que le combat anticlérical fit sombrer en 1885, les facultés de théologie protestante se maintenant jusqu'à la Séparation de 1905. L'examen approfondi auquel on a procédé ici, d'après de nombreuses sources inédites, éclaire des aspects peu connus de l'Histoire de l'Université de France au XIXe siècle, du développement des études théologiques dans le clergé, du gallicanisme administratif et politique, de l'action diplomatique du Saint-Siège concernant des points exclus des dispositions concordataires.