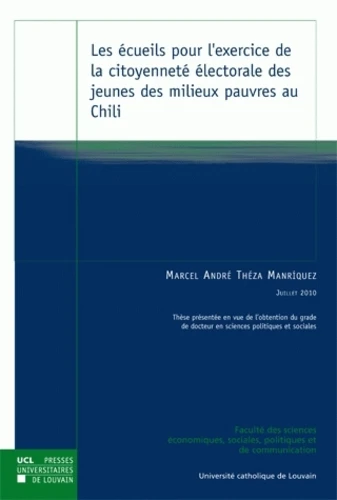Les écueils pour l'exercice de la citoyenneté électorale des jeunes des milieux pauvres au Chili
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages310
- PrésentationBroché
- Poids0.496 kg
- Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 1,6 cm
- ISBN978-2-87463-240-2
- EAN9782874632402
- Date de parution01/09/2010
- CollectionThèses de l'UCL
- ÉditeurPresses Universitaires Louvain
Résumé
En Amérique latine et particulièrement au Chili, de plus en plus de regards s'intéressent à ce paradoxe étonnant d'un continent qui a reconquis un statut démocratique dont la normalité institutionnelle semble être déjà un trait caractéristique, mais où les expressions essentielles de civisme, comme celles de l'adhésion à la démocratie, l'associativité, la confiance interpersonnelle, le sens du devoir, etc.
, connaissent une diminution progressive. Le Chili, considéré habituellement comme "l'élève avancé de la classe latinoaméricaine" , étant donné ses performances aux niveaux économique, politique et social, est un exemple de cette disharmonie entre une modernisation profonde de la société et un manque d'identification avec la démarche et les fruits de cette modernisation. Ce phénomène, bien qu'il affecte la société toute entière, affecte plus clairement les segments plus jeunes de la société, ceux qui n'ont connu que le Chili de la modernisation, le Chili des "opportunités" et le Chili de l'expansion des libertés individuelles.
Mais parmi les jeunes, ce sentiment de désaffection paraît être plus fort chez les plus pauvres. Le rapport jeune-pauvre devient ainsi un phénomène d'autoexclusion très lourd dans le système institutionnel chilien, ce qui entraîne une absence dramatique de ces jeunes des bureaux d'inscription électorale et par conséquent du vote. Dans ce contexte de réflexion, la question essentielle de cette thèse doctorale est donc : "Pourquoi au Chili, depuis le retour à la démocratie, la participation des jeunes les plus pauvres aux consultations électorales est-elle moins forte que celle des jeunes d'origine sociale moyenne ou élevée ?"
, connaissent une diminution progressive. Le Chili, considéré habituellement comme "l'élève avancé de la classe latinoaméricaine" , étant donné ses performances aux niveaux économique, politique et social, est un exemple de cette disharmonie entre une modernisation profonde de la société et un manque d'identification avec la démarche et les fruits de cette modernisation. Ce phénomène, bien qu'il affecte la société toute entière, affecte plus clairement les segments plus jeunes de la société, ceux qui n'ont connu que le Chili de la modernisation, le Chili des "opportunités" et le Chili de l'expansion des libertés individuelles.
Mais parmi les jeunes, ce sentiment de désaffection paraît être plus fort chez les plus pauvres. Le rapport jeune-pauvre devient ainsi un phénomène d'autoexclusion très lourd dans le système institutionnel chilien, ce qui entraîne une absence dramatique de ces jeunes des bureaux d'inscription électorale et par conséquent du vote. Dans ce contexte de réflexion, la question essentielle de cette thèse doctorale est donc : "Pourquoi au Chili, depuis le retour à la démocratie, la participation des jeunes les plus pauvres aux consultations électorales est-elle moins forte que celle des jeunes d'origine sociale moyenne ou élevée ?"
En Amérique latine et particulièrement au Chili, de plus en plus de regards s'intéressent à ce paradoxe étonnant d'un continent qui a reconquis un statut démocratique dont la normalité institutionnelle semble être déjà un trait caractéristique, mais où les expressions essentielles de civisme, comme celles de l'adhésion à la démocratie, l'associativité, la confiance interpersonnelle, le sens du devoir, etc.
, connaissent une diminution progressive. Le Chili, considéré habituellement comme "l'élève avancé de la classe latinoaméricaine" , étant donné ses performances aux niveaux économique, politique et social, est un exemple de cette disharmonie entre une modernisation profonde de la société et un manque d'identification avec la démarche et les fruits de cette modernisation. Ce phénomène, bien qu'il affecte la société toute entière, affecte plus clairement les segments plus jeunes de la société, ceux qui n'ont connu que le Chili de la modernisation, le Chili des "opportunités" et le Chili de l'expansion des libertés individuelles.
Mais parmi les jeunes, ce sentiment de désaffection paraît être plus fort chez les plus pauvres. Le rapport jeune-pauvre devient ainsi un phénomène d'autoexclusion très lourd dans le système institutionnel chilien, ce qui entraîne une absence dramatique de ces jeunes des bureaux d'inscription électorale et par conséquent du vote. Dans ce contexte de réflexion, la question essentielle de cette thèse doctorale est donc : "Pourquoi au Chili, depuis le retour à la démocratie, la participation des jeunes les plus pauvres aux consultations électorales est-elle moins forte que celle des jeunes d'origine sociale moyenne ou élevée ?"
, connaissent une diminution progressive. Le Chili, considéré habituellement comme "l'élève avancé de la classe latinoaméricaine" , étant donné ses performances aux niveaux économique, politique et social, est un exemple de cette disharmonie entre une modernisation profonde de la société et un manque d'identification avec la démarche et les fruits de cette modernisation. Ce phénomène, bien qu'il affecte la société toute entière, affecte plus clairement les segments plus jeunes de la société, ceux qui n'ont connu que le Chili de la modernisation, le Chili des "opportunités" et le Chili de l'expansion des libertés individuelles.
Mais parmi les jeunes, ce sentiment de désaffection paraît être plus fort chez les plus pauvres. Le rapport jeune-pauvre devient ainsi un phénomène d'autoexclusion très lourd dans le système institutionnel chilien, ce qui entraîne une absence dramatique de ces jeunes des bureaux d'inscription électorale et par conséquent du vote. Dans ce contexte de réflexion, la question essentielle de cette thèse doctorale est donc : "Pourquoi au Chili, depuis le retour à la démocratie, la participation des jeunes les plus pauvres aux consultations électorales est-elle moins forte que celle des jeunes d'origine sociale moyenne ou élevée ?"