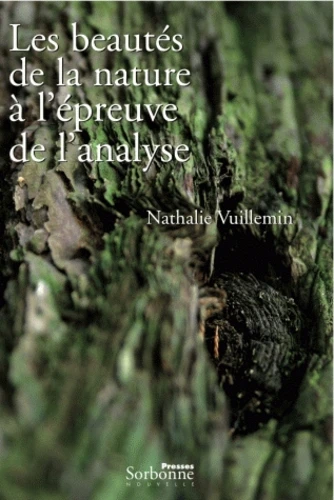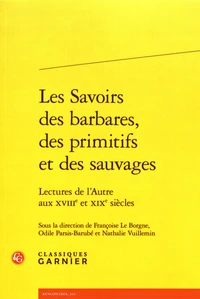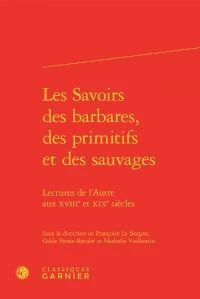Les beautés de la nature à l'épreuve de l'analyse. Programmes scientifiques et tentations esthétiques dans l'histoire naturelle du XVIIIe siècle (1744-1805)
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages412
- PrésentationBroché
- Poids0.66 kg
- Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 2,0 cm
- ISBN978-2-87854-466-4
- EAN9782878544664
- Date de parution01/05/2009
- ÉditeurPresses Sorbonne Nouvelle
Résumé
Le discours scientifique du XVIIe siècle est un objet hybride où se rencontrent et s'opposent sans cesse deux tendances divergentes : la volonté de créer une langue de la nature toujours plus formalisée, d'une part, qui conduise à une connaissance précise et efficace des choses, et l'attachement à un regard contemplatif, à une vision de surface attentive aux apparences - fussent-elles trompeuses - d'autre part. Partout, le projet scientifique doit faire face à la question de la beauté. Peut-on connaître et admirer à la fois ? Transmettre les données techniques issues de l'observation tout en transcrivant le plaisir que celle-ci procure ? Cette étude envisage ces questions sous deux aspects : elle s'intéresse d'abord à la formation des discours formalisés dans le domaine de l'histoire naturelle, aux modèles préexistants sur Pit lesquels ils s'appuient, ainsi qu'aux alternatives qui se proposent aux auteurs lorsqu'il s'agit d'élaborer un langage susceptible de transmettre un savoir objectif sur la réalité naturelle. On aborde dans un second temps les débats qui se nouent entre des visions anciennes et modernes de la nature, autour des concepts de merveilleux, de contemplation ou de beauté naturelle. A l'origine de notre modernité scientifique, le regard et le discours sur la nature ont dû faire le deuil du sentiment du beau qui anime pourtant l'intérêt de l'étude et contribue à élaborer une signification des êtres et des corps.
Le discours scientifique du XVIIe siècle est un objet hybride où se rencontrent et s'opposent sans cesse deux tendances divergentes : la volonté de créer une langue de la nature toujours plus formalisée, d'une part, qui conduise à une connaissance précise et efficace des choses, et l'attachement à un regard contemplatif, à une vision de surface attentive aux apparences - fussent-elles trompeuses - d'autre part. Partout, le projet scientifique doit faire face à la question de la beauté. Peut-on connaître et admirer à la fois ? Transmettre les données techniques issues de l'observation tout en transcrivant le plaisir que celle-ci procure ? Cette étude envisage ces questions sous deux aspects : elle s'intéresse d'abord à la formation des discours formalisés dans le domaine de l'histoire naturelle, aux modèles préexistants sur Pit lesquels ils s'appuient, ainsi qu'aux alternatives qui se proposent aux auteurs lorsqu'il s'agit d'élaborer un langage susceptible de transmettre un savoir objectif sur la réalité naturelle. On aborde dans un second temps les débats qui se nouent entre des visions anciennes et modernes de la nature, autour des concepts de merveilleux, de contemplation ou de beauté naturelle. A l'origine de notre modernité scientifique, le regard et le discours sur la nature ont dû faire le deuil du sentiment du beau qui anime pourtant l'intérêt de l'étude et contribue à élaborer une signification des êtres et des corps.