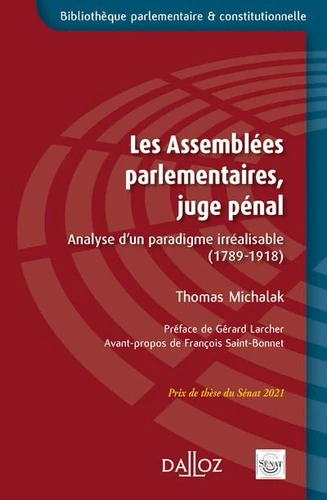Les assemblées parlementaires, juge pénal. Analyse d'un paradigme irréalisable (1789 - 1918)
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 5 décembreCet article sera commandé chez un fournisseur et vous sera envoyé 6 jours après la date de votre commande.
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 5 décembre
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages473
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.77 kg
- Dimensions15,8 cm × 24,1 cm × 2,7 cm
- ISBN978-2-247-21500-3
- EAN9782247215003
- Date de parution17/03/2022
- CollectionBibliothèque parlementaire et
- ÉditeurDalloz
- PréfacierGérard Larcher
- PréfacierFrançois Saint-Bonnet
Résumé
Le sujet de cette thèse renvoie aux expériences institutionnelles de la Cour des pairs (1814-1848) et du Sénat de la IIIe République (1875-1940). Ce sont les manifestations les plus marquantes de la participation d'une assemblée parlementaire à la reddition de la justice. Le procès des ministres de Charles X et celui de Malvy semblent être bien connus mais ils ne le sont en réalité qu'imparfaitement.
Dans les deux cas, les Chambres hautes se sont détournées de leur mission de législateur et de contrôleur du Gouvernement pour se métamorphoser, de manière très incomplète, en instances judiciaires. Cependant le traitement isolé de ces deux seules expériences ne permet pas de définir la mission d'une juridiction parlementaire. La notion de Haute Cour doit être appréhendée dans sa globalité et dans son histoire.
Ces hautes juridictions se voient confier des compétences spéciales : ratione personae et ratione materiae. A raison des personnes, il s'agit de juger des personnalités politiques et, dès la Révolution, on entrevoit la difficulté de le faire avec un droit criminel qui n'est guère adapté à la résolution de différends politiques. Enfin, une Haute Cour est aussi un tribunal des grands crimes politiques, c'est-à-dire des graves atteintes à la souveraineté.
L'histoire du "Tribunal supréme" français doit être retracée afin de faire apparaitre le concept mémo de justice politique, dans toute sa nudité, comme une aporie.
Dans les deux cas, les Chambres hautes se sont détournées de leur mission de législateur et de contrôleur du Gouvernement pour se métamorphoser, de manière très incomplète, en instances judiciaires. Cependant le traitement isolé de ces deux seules expériences ne permet pas de définir la mission d'une juridiction parlementaire. La notion de Haute Cour doit être appréhendée dans sa globalité et dans son histoire.
Ces hautes juridictions se voient confier des compétences spéciales : ratione personae et ratione materiae. A raison des personnes, il s'agit de juger des personnalités politiques et, dès la Révolution, on entrevoit la difficulté de le faire avec un droit criminel qui n'est guère adapté à la résolution de différends politiques. Enfin, une Haute Cour est aussi un tribunal des grands crimes politiques, c'est-à-dire des graves atteintes à la souveraineté.
L'histoire du "Tribunal supréme" français doit être retracée afin de faire apparaitre le concept mémo de justice politique, dans toute sa nudité, comme une aporie.
Le sujet de cette thèse renvoie aux expériences institutionnelles de la Cour des pairs (1814-1848) et du Sénat de la IIIe République (1875-1940). Ce sont les manifestations les plus marquantes de la participation d'une assemblée parlementaire à la reddition de la justice. Le procès des ministres de Charles X et celui de Malvy semblent être bien connus mais ils ne le sont en réalité qu'imparfaitement.
Dans les deux cas, les Chambres hautes se sont détournées de leur mission de législateur et de contrôleur du Gouvernement pour se métamorphoser, de manière très incomplète, en instances judiciaires. Cependant le traitement isolé de ces deux seules expériences ne permet pas de définir la mission d'une juridiction parlementaire. La notion de Haute Cour doit être appréhendée dans sa globalité et dans son histoire.
Ces hautes juridictions se voient confier des compétences spéciales : ratione personae et ratione materiae. A raison des personnes, il s'agit de juger des personnalités politiques et, dès la Révolution, on entrevoit la difficulté de le faire avec un droit criminel qui n'est guère adapté à la résolution de différends politiques. Enfin, une Haute Cour est aussi un tribunal des grands crimes politiques, c'est-à-dire des graves atteintes à la souveraineté.
L'histoire du "Tribunal supréme" français doit être retracée afin de faire apparaitre le concept mémo de justice politique, dans toute sa nudité, comme une aporie.
Dans les deux cas, les Chambres hautes se sont détournées de leur mission de législateur et de contrôleur du Gouvernement pour se métamorphoser, de manière très incomplète, en instances judiciaires. Cependant le traitement isolé de ces deux seules expériences ne permet pas de définir la mission d'une juridiction parlementaire. La notion de Haute Cour doit être appréhendée dans sa globalité et dans son histoire.
Ces hautes juridictions se voient confier des compétences spéciales : ratione personae et ratione materiae. A raison des personnes, il s'agit de juger des personnalités politiques et, dès la Révolution, on entrevoit la difficulté de le faire avec un droit criminel qui n'est guère adapté à la résolution de différends politiques. Enfin, une Haute Cour est aussi un tribunal des grands crimes politiques, c'est-à-dire des graves atteintes à la souveraineté.
L'histoire du "Tribunal supréme" français doit être retracée afin de faire apparaitre le concept mémo de justice politique, dans toute sa nudité, comme une aporie.