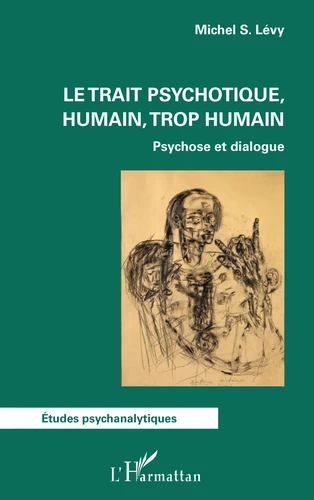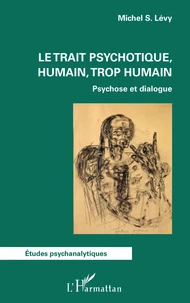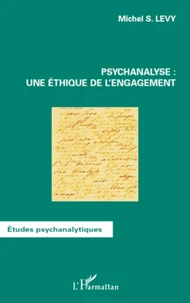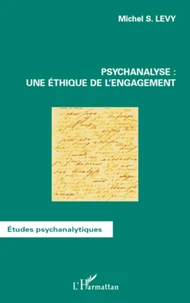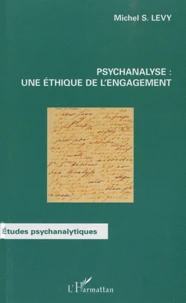Le trait psychotique, humain, trop humain. Psychose et dialogue
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages230
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.274 kg
- Dimensions13,5 cm × 21,5 cm × 1,3 cm
- ISBN978-2-336-47333-8
- EAN9782336473338
- Date de parution25/07/2024
- CollectionEtudes psychanalytiques
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
Le but de ce travail est de proposer que les aléas du dialogue soient la cause principale de l'apparition des traits psychotiques, puis le moyen privilégié de leur évolution lorsque cette thématique dialogique guide la conduite du thérapeute, de l'analyste. C'est pour cela que la psychanalyse, lorsqu'elle ne se concevait surtout pas comme dialogue, ce sur quoi insistait Lacan, a longtemps été incapable d'aborder ces difficultés psychotiques.
Ce sont, au contraire, les analystes qui se sont emparés de la question de l'échange dialogique qui firent avancer ces problèmes, comme M. Klein, G. Pankow, F. Tosquelles, Alain Manier, et avant eux Jean-Baptiste Pussin, le surveillant de Pinel, inventeur du traitement institutionnel du trait psychotique. Tous les développements de Lacan sur la fonction de suspension du dialogue dans le déroulement de la cure - afin que par la suspension de la réponse de l'autre advienne le champ des projections et fantasmes personnels du patient qui vont ouvrir le travail de son inconscient -restent clairement pertinents, mais dans le champ des traits de nature névrotique.
C'est pourquoi les références qui nous serviront dans le présent travail seront celles de ces analystes qui purent témoigner de succès avec ces traits psychiques, contrairement à Freud lui-même et Lacan. A l'inverse de ces derniers, ils furent toutes et tous des spécialistes fort avertis des arcanes et complexités du dialogue humain concret. C'est à partir de l'éclectisme de sa formation et de sa pratique, de la médecine à la psychiatrie, la pédopsychiatrie, la psychothérapie familiale, institutionnelle, le psychodrame, les groupes Balint, que Michel S.
Lévy tente de réinventer, à l'aide de ce que les patients et les confrères lui ont amené, une psychanalyse qui en a grand besoin.
Ce sont, au contraire, les analystes qui se sont emparés de la question de l'échange dialogique qui firent avancer ces problèmes, comme M. Klein, G. Pankow, F. Tosquelles, Alain Manier, et avant eux Jean-Baptiste Pussin, le surveillant de Pinel, inventeur du traitement institutionnel du trait psychotique. Tous les développements de Lacan sur la fonction de suspension du dialogue dans le déroulement de la cure - afin que par la suspension de la réponse de l'autre advienne le champ des projections et fantasmes personnels du patient qui vont ouvrir le travail de son inconscient -restent clairement pertinents, mais dans le champ des traits de nature névrotique.
C'est pourquoi les références qui nous serviront dans le présent travail seront celles de ces analystes qui purent témoigner de succès avec ces traits psychiques, contrairement à Freud lui-même et Lacan. A l'inverse de ces derniers, ils furent toutes et tous des spécialistes fort avertis des arcanes et complexités du dialogue humain concret. C'est à partir de l'éclectisme de sa formation et de sa pratique, de la médecine à la psychiatrie, la pédopsychiatrie, la psychothérapie familiale, institutionnelle, le psychodrame, les groupes Balint, que Michel S.
Lévy tente de réinventer, à l'aide de ce que les patients et les confrères lui ont amené, une psychanalyse qui en a grand besoin.
Le but de ce travail est de proposer que les aléas du dialogue soient la cause principale de l'apparition des traits psychotiques, puis le moyen privilégié de leur évolution lorsque cette thématique dialogique guide la conduite du thérapeute, de l'analyste. C'est pour cela que la psychanalyse, lorsqu'elle ne se concevait surtout pas comme dialogue, ce sur quoi insistait Lacan, a longtemps été incapable d'aborder ces difficultés psychotiques.
Ce sont, au contraire, les analystes qui se sont emparés de la question de l'échange dialogique qui firent avancer ces problèmes, comme M. Klein, G. Pankow, F. Tosquelles, Alain Manier, et avant eux Jean-Baptiste Pussin, le surveillant de Pinel, inventeur du traitement institutionnel du trait psychotique. Tous les développements de Lacan sur la fonction de suspension du dialogue dans le déroulement de la cure - afin que par la suspension de la réponse de l'autre advienne le champ des projections et fantasmes personnels du patient qui vont ouvrir le travail de son inconscient -restent clairement pertinents, mais dans le champ des traits de nature névrotique.
C'est pourquoi les références qui nous serviront dans le présent travail seront celles de ces analystes qui purent témoigner de succès avec ces traits psychiques, contrairement à Freud lui-même et Lacan. A l'inverse de ces derniers, ils furent toutes et tous des spécialistes fort avertis des arcanes et complexités du dialogue humain concret. C'est à partir de l'éclectisme de sa formation et de sa pratique, de la médecine à la psychiatrie, la pédopsychiatrie, la psychothérapie familiale, institutionnelle, le psychodrame, les groupes Balint, que Michel S.
Lévy tente de réinventer, à l'aide de ce que les patients et les confrères lui ont amené, une psychanalyse qui en a grand besoin.
Ce sont, au contraire, les analystes qui se sont emparés de la question de l'échange dialogique qui firent avancer ces problèmes, comme M. Klein, G. Pankow, F. Tosquelles, Alain Manier, et avant eux Jean-Baptiste Pussin, le surveillant de Pinel, inventeur du traitement institutionnel du trait psychotique. Tous les développements de Lacan sur la fonction de suspension du dialogue dans le déroulement de la cure - afin que par la suspension de la réponse de l'autre advienne le champ des projections et fantasmes personnels du patient qui vont ouvrir le travail de son inconscient -restent clairement pertinents, mais dans le champ des traits de nature névrotique.
C'est pourquoi les références qui nous serviront dans le présent travail seront celles de ces analystes qui purent témoigner de succès avec ces traits psychiques, contrairement à Freud lui-même et Lacan. A l'inverse de ces derniers, ils furent toutes et tous des spécialistes fort avertis des arcanes et complexités du dialogue humain concret. C'est à partir de l'éclectisme de sa formation et de sa pratique, de la médecine à la psychiatrie, la pédopsychiatrie, la psychothérapie familiale, institutionnelle, le psychodrame, les groupes Balint, que Michel S.
Lévy tente de réinventer, à l'aide de ce que les patients et les confrères lui ont amené, une psychanalyse qui en a grand besoin.