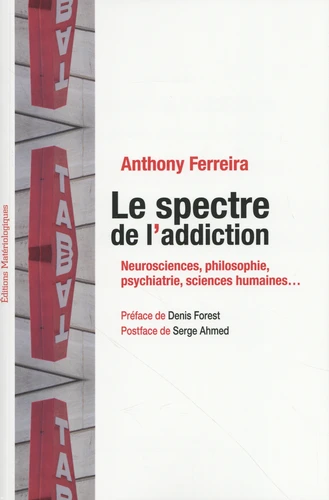Le spectre de l'addiction. Neurosciences, philosophie, psychiatrie, sciences humaines...
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages683
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids1.055 kg
- Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 3,5 cm
- ISBN978-2-37361-470-1
- EAN9782373614701
- Date de parution01/11/2024
- CollectionEpistémologie de la médecine e
- ÉditeurMatériologiques (Editions)
- PréfacierDenis Forest
- PostfacierSerge Ahmed
Résumé
"Le Spectre de l'addiction" est un ouvrage unique en ce qu'il réunit en une fresque dûment organisée la présentation des nombreuses théories de l'addiction, d'une part, et d'autre part en exposant les propres réflexions de son auteur, Anthony Ferreira, lequel, pourvu d'un doctorat en neurosciences et d'un autre en philosophie, dispose des outils conceptuels et expérimentaux pour s'aventurer avec la plus grande des perspicacités dans ce vaste et sinueux champ d'étude.
Ainsi que s'exclame avec enthousiasme son postfacier le neuroscientifique Serge Ahmed, il s'agit d'un livre "immense". La première partie est une somme historique permettant de rendre compte de la diversité des addictions et des approches qui, depuis des siècles, ont tenté de les décrire, les définir, les contrer. Cette ample perspective comparatiste implique de comprendre "l'addiction" comme un spectre et d'en donner une définition minimale capable d'englober cette variété d'expressions.
Cette profusion, cette hétérogénéité, problématiques en ce qu'elles entravent la connaissance et l'action (soigner), doivent dès lors être circonscrites sans pour autant être effacées du tableau complet. La deuxième partie s'intéresse aux mécanismes sous-jacents capables de donner une unité épistémique à ce spectre en abordant la question du choix et de la rationalité dans l'addiction. Traitées par la psychologie et l'économie, ces notions influencent profondément les théories de l'addiction issues tant des neurosciences que des disciplines qui s'y opposent.
Nombre des difficultés du champ viennent avant tout des conceptions hétérogènes et incompatibles du choix et de la rationalité que mobilisent les penseurs de l'addiction. La dernière partie, tirant les conséquences de cette enquête multidisciplinaire (neurobiologie, psychiatrie, psychologie, philosophie, économie, etc.), propose une théorie unifiée du phénomène "addiction" tendanciellement apte à répondre efficacement aux problèmes constants auxquels les "addictologues", au sens large, ne cessent d'être confrontés : l'unité de l'addiction bien sûr, la légitimité des modèles animaux, les questions de la nature des objets d'addiction, des addictions comportementales, de la place de la dimension sociale dans la constitution du fait "addiction", les conséquences éthiques relatives aux statuts moral et légal de l'addict, etc.
Ainsi que s'exclame avec enthousiasme son postfacier le neuroscientifique Serge Ahmed, il s'agit d'un livre "immense". La première partie est une somme historique permettant de rendre compte de la diversité des addictions et des approches qui, depuis des siècles, ont tenté de les décrire, les définir, les contrer. Cette ample perspective comparatiste implique de comprendre "l'addiction" comme un spectre et d'en donner une définition minimale capable d'englober cette variété d'expressions.
Cette profusion, cette hétérogénéité, problématiques en ce qu'elles entravent la connaissance et l'action (soigner), doivent dès lors être circonscrites sans pour autant être effacées du tableau complet. La deuxième partie s'intéresse aux mécanismes sous-jacents capables de donner une unité épistémique à ce spectre en abordant la question du choix et de la rationalité dans l'addiction. Traitées par la psychologie et l'économie, ces notions influencent profondément les théories de l'addiction issues tant des neurosciences que des disciplines qui s'y opposent.
Nombre des difficultés du champ viennent avant tout des conceptions hétérogènes et incompatibles du choix et de la rationalité que mobilisent les penseurs de l'addiction. La dernière partie, tirant les conséquences de cette enquête multidisciplinaire (neurobiologie, psychiatrie, psychologie, philosophie, économie, etc.), propose une théorie unifiée du phénomène "addiction" tendanciellement apte à répondre efficacement aux problèmes constants auxquels les "addictologues", au sens large, ne cessent d'être confrontés : l'unité de l'addiction bien sûr, la légitimité des modèles animaux, les questions de la nature des objets d'addiction, des addictions comportementales, de la place de la dimension sociale dans la constitution du fait "addiction", les conséquences éthiques relatives aux statuts moral et légal de l'addict, etc.
"Le Spectre de l'addiction" est un ouvrage unique en ce qu'il réunit en une fresque dûment organisée la présentation des nombreuses théories de l'addiction, d'une part, et d'autre part en exposant les propres réflexions de son auteur, Anthony Ferreira, lequel, pourvu d'un doctorat en neurosciences et d'un autre en philosophie, dispose des outils conceptuels et expérimentaux pour s'aventurer avec la plus grande des perspicacités dans ce vaste et sinueux champ d'étude.
Ainsi que s'exclame avec enthousiasme son postfacier le neuroscientifique Serge Ahmed, il s'agit d'un livre "immense". La première partie est une somme historique permettant de rendre compte de la diversité des addictions et des approches qui, depuis des siècles, ont tenté de les décrire, les définir, les contrer. Cette ample perspective comparatiste implique de comprendre "l'addiction" comme un spectre et d'en donner une définition minimale capable d'englober cette variété d'expressions.
Cette profusion, cette hétérogénéité, problématiques en ce qu'elles entravent la connaissance et l'action (soigner), doivent dès lors être circonscrites sans pour autant être effacées du tableau complet. La deuxième partie s'intéresse aux mécanismes sous-jacents capables de donner une unité épistémique à ce spectre en abordant la question du choix et de la rationalité dans l'addiction. Traitées par la psychologie et l'économie, ces notions influencent profondément les théories de l'addiction issues tant des neurosciences que des disciplines qui s'y opposent.
Nombre des difficultés du champ viennent avant tout des conceptions hétérogènes et incompatibles du choix et de la rationalité que mobilisent les penseurs de l'addiction. La dernière partie, tirant les conséquences de cette enquête multidisciplinaire (neurobiologie, psychiatrie, psychologie, philosophie, économie, etc.), propose une théorie unifiée du phénomène "addiction" tendanciellement apte à répondre efficacement aux problèmes constants auxquels les "addictologues", au sens large, ne cessent d'être confrontés : l'unité de l'addiction bien sûr, la légitimité des modèles animaux, les questions de la nature des objets d'addiction, des addictions comportementales, de la place de la dimension sociale dans la constitution du fait "addiction", les conséquences éthiques relatives aux statuts moral et légal de l'addict, etc.
Ainsi que s'exclame avec enthousiasme son postfacier le neuroscientifique Serge Ahmed, il s'agit d'un livre "immense". La première partie est une somme historique permettant de rendre compte de la diversité des addictions et des approches qui, depuis des siècles, ont tenté de les décrire, les définir, les contrer. Cette ample perspective comparatiste implique de comprendre "l'addiction" comme un spectre et d'en donner une définition minimale capable d'englober cette variété d'expressions.
Cette profusion, cette hétérogénéité, problématiques en ce qu'elles entravent la connaissance et l'action (soigner), doivent dès lors être circonscrites sans pour autant être effacées du tableau complet. La deuxième partie s'intéresse aux mécanismes sous-jacents capables de donner une unité épistémique à ce spectre en abordant la question du choix et de la rationalité dans l'addiction. Traitées par la psychologie et l'économie, ces notions influencent profondément les théories de l'addiction issues tant des neurosciences que des disciplines qui s'y opposent.
Nombre des difficultés du champ viennent avant tout des conceptions hétérogènes et incompatibles du choix et de la rationalité que mobilisent les penseurs de l'addiction. La dernière partie, tirant les conséquences de cette enquête multidisciplinaire (neurobiologie, psychiatrie, psychologie, philosophie, économie, etc.), propose une théorie unifiée du phénomène "addiction" tendanciellement apte à répondre efficacement aux problèmes constants auxquels les "addictologues", au sens large, ne cessent d'être confrontés : l'unité de l'addiction bien sûr, la légitimité des modèles animaux, les questions de la nature des objets d'addiction, des addictions comportementales, de la place de la dimension sociale dans la constitution du fait "addiction", les conséquences éthiques relatives aux statuts moral et légal de l'addict, etc.