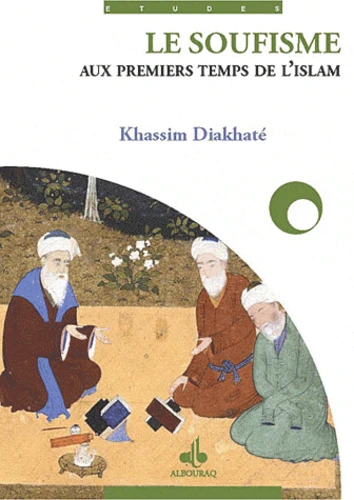Le soufisme aux premiers temps de l'Islam
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages206
- PrésentationBroché
- Poids0.333 kg
- Dimensions13,0 cm × 19,0 cm × 0,1 cm
- ISBN978-2-84161-394-6
- EAN9782841613946
- Date de parution01/03/2012
- CollectionEtudes
- ÉditeurAlbouraq
Résumé
Cette étude est consacrée à la théologie mystique des premiers
soufis (du I°/8° au IV°/10° siècles), à partir de deux ouvrages
de référence qui font partie des plus anciens traités de
soufisme écrits en arabe : Kitâb al-ta`arruf li madhab ahl al-
tasawwuf d’Abû Bakr al-Kalâbâdhî (m. vers 385/995), et
Kitâb al-luma` d’Abû Nasr al-Sarrâj (m. 378/988). Kalâbâdhî
et Sarrâj pensaient que la réputation des soufis était ternie par
des soi-disant soufis qui n’avaient ni le comportement ni
l’expérience spirituelle des soufis dignes de ce nom.
C’est ce qui les poussa à rédiger leur traité respectif afin d’exposer les principes et les sciences du soufisme authentique, qui prend sa source dans le Coran, la Tradition prophétique, ainsi que le consensus des pieux anciens. Les expériences mystiques et théologiques des soufis s’inscrivent, selon Kalâbâdhî et Sarrâj, dans un processus complexe de combat contre l’âme qu’ils considèrent comme la source des maux et des déviations.
Dans ce combat, les soufis renoncent totalement aux mondanités pour s’adonner à la méditation, à l’invocation de Dieu, et à toute sorte de pratiques surérogatoires, grâce auxquelles ils acquièrent des bénéfices spirituels significatifs appelés, selon les circonstances, "étapes" ou "états" spirituels. Leurs comportements, leurs pratiques cultuelles ainsi que l’ensemble de leurs activités sont fortement marqués par des règles de bienséance et des convenances spirituelles qui leur sont propres.
On peut distinguer, grâce aux règles en question, le vrai soufi du faux. Ces règles impressionnantes de bienséance touchent à tous les domaines d’activités, et sont mises en pratique par les soufis tout au long de leur parcours sur la Voie de Dieu. Des règles qu’ils s’efforcent de respecter du début de leur vie spirituelle jusqu’à leur mort.
C’est ce qui les poussa à rédiger leur traité respectif afin d’exposer les principes et les sciences du soufisme authentique, qui prend sa source dans le Coran, la Tradition prophétique, ainsi que le consensus des pieux anciens. Les expériences mystiques et théologiques des soufis s’inscrivent, selon Kalâbâdhî et Sarrâj, dans un processus complexe de combat contre l’âme qu’ils considèrent comme la source des maux et des déviations.
Dans ce combat, les soufis renoncent totalement aux mondanités pour s’adonner à la méditation, à l’invocation de Dieu, et à toute sorte de pratiques surérogatoires, grâce auxquelles ils acquièrent des bénéfices spirituels significatifs appelés, selon les circonstances, "étapes" ou "états" spirituels. Leurs comportements, leurs pratiques cultuelles ainsi que l’ensemble de leurs activités sont fortement marqués par des règles de bienséance et des convenances spirituelles qui leur sont propres.
On peut distinguer, grâce aux règles en question, le vrai soufi du faux. Ces règles impressionnantes de bienséance touchent à tous les domaines d’activités, et sont mises en pratique par les soufis tout au long de leur parcours sur la Voie de Dieu. Des règles qu’ils s’efforcent de respecter du début de leur vie spirituelle jusqu’à leur mort.
Cette étude est consacrée à la théologie mystique des premiers
soufis (du I°/8° au IV°/10° siècles), à partir de deux ouvrages
de référence qui font partie des plus anciens traités de
soufisme écrits en arabe : Kitâb al-ta`arruf li madhab ahl al-
tasawwuf d’Abû Bakr al-Kalâbâdhî (m. vers 385/995), et
Kitâb al-luma` d’Abû Nasr al-Sarrâj (m. 378/988). Kalâbâdhî
et Sarrâj pensaient que la réputation des soufis était ternie par
des soi-disant soufis qui n’avaient ni le comportement ni
l’expérience spirituelle des soufis dignes de ce nom.
C’est ce qui les poussa à rédiger leur traité respectif afin d’exposer les principes et les sciences du soufisme authentique, qui prend sa source dans le Coran, la Tradition prophétique, ainsi que le consensus des pieux anciens. Les expériences mystiques et théologiques des soufis s’inscrivent, selon Kalâbâdhî et Sarrâj, dans un processus complexe de combat contre l’âme qu’ils considèrent comme la source des maux et des déviations.
Dans ce combat, les soufis renoncent totalement aux mondanités pour s’adonner à la méditation, à l’invocation de Dieu, et à toute sorte de pratiques surérogatoires, grâce auxquelles ils acquièrent des bénéfices spirituels significatifs appelés, selon les circonstances, "étapes" ou "états" spirituels. Leurs comportements, leurs pratiques cultuelles ainsi que l’ensemble de leurs activités sont fortement marqués par des règles de bienséance et des convenances spirituelles qui leur sont propres.
On peut distinguer, grâce aux règles en question, le vrai soufi du faux. Ces règles impressionnantes de bienséance touchent à tous les domaines d’activités, et sont mises en pratique par les soufis tout au long de leur parcours sur la Voie de Dieu. Des règles qu’ils s’efforcent de respecter du début de leur vie spirituelle jusqu’à leur mort.
C’est ce qui les poussa à rédiger leur traité respectif afin d’exposer les principes et les sciences du soufisme authentique, qui prend sa source dans le Coran, la Tradition prophétique, ainsi que le consensus des pieux anciens. Les expériences mystiques et théologiques des soufis s’inscrivent, selon Kalâbâdhî et Sarrâj, dans un processus complexe de combat contre l’âme qu’ils considèrent comme la source des maux et des déviations.
Dans ce combat, les soufis renoncent totalement aux mondanités pour s’adonner à la méditation, à l’invocation de Dieu, et à toute sorte de pratiques surérogatoires, grâce auxquelles ils acquièrent des bénéfices spirituels significatifs appelés, selon les circonstances, "étapes" ou "états" spirituels. Leurs comportements, leurs pratiques cultuelles ainsi que l’ensemble de leurs activités sont fortement marqués par des règles de bienséance et des convenances spirituelles qui leur sont propres.
On peut distinguer, grâce aux règles en question, le vrai soufi du faux. Ces règles impressionnantes de bienséance touchent à tous les domaines d’activités, et sont mises en pratique par les soufis tout au long de leur parcours sur la Voie de Dieu. Des règles qu’ils s’efforcent de respecter du début de leur vie spirituelle jusqu’à leur mort.