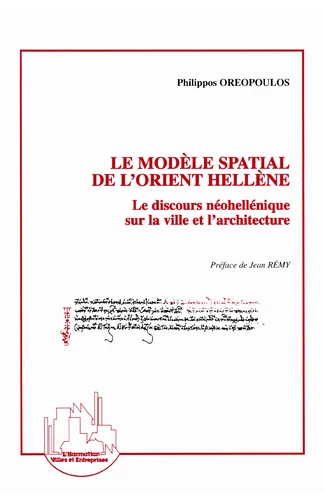Le Modèle Spatial de l'orient Hellene. Le discours néohellonique sur la ville et l'architecture
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages336
- PrésentationBroché
- Poids0.542 kg
- Dimensions15,5 cm × 24,0 cm × 1,8 cm
- ISBN2-7384-6973-6
- EAN9782738469731
- Date de parution15/09/1998
- CollectionVilles et entreprises
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
Le propos initial de cette recherche concernait les problèmes théoriques du discours architectural néohellénique. Mais celle-ci prit une dimension comparative avec l'étude, au niveau architectural, des relations discursives entre les cultures néohellénique, byzantine, occidentale et musulmane. Des phénomènes culturels complexes, déterminants au niveau du discours, comme le classicisme de la Renaissance occidentale et les points de vue sur la ville renaissante, ainsi que des aspects moins connus, comme le classicisme byzantin ou encore le modèle spatial des Byzantins (nommé modèle spatial de l'Orient hellène) ont sans doute leurs origines dans la Grèce ancienne, mais relever cette origine commune ne suffit pas pour énoncer les analogies et les différences, et donc leurs identités.
En particulier, le discours architectural de l'Orient hellène, et notamment celui du modèle spatial, par ses dimensions géographiques (les Balkans, l'Asie Mineure, la Méditerranée musulmane), diachroniques (au moins du Xe au XIXe siècle), et plurinationales (les nations byzantines, musulmanes, slaves, grecques) peut être considéré, du fait de son étendue spatio-temporelle, comme justement ce discours unique.
En même temps, l'ensemble d'une telle pensée exige un discours critique susceptible de l'articuler dans le discours architectural contemporain. La recherche a alors dépassé le discours architectural néohellénique, pour aboutir aux phénomènes cognitifs généraux concernant le discours sur la ville et l'architecture dans l'Occident latin comme dans l'Orient hellène, c'est-à-dire dans la vaste culture européenne.
Un tel livre s'adresse à divers publics. Il y a d'abord ceux qui s'intéressent à la genèse d'un monde qui nous est trop méconnu. Ensuite, il y a une diversité de publics qui sont préoccupés par le devenir de nos villes, pour qui la comparaison peut créer un champ de liberté pour imaginer des scénarios d'avenir. Dans tous les cas, il s'agit de suivre l'auteur pas à pas pour ajouter toute la saveur d'un univers différent.
En particulier, le discours architectural de l'Orient hellène, et notamment celui du modèle spatial, par ses dimensions géographiques (les Balkans, l'Asie Mineure, la Méditerranée musulmane), diachroniques (au moins du Xe au XIXe siècle), et plurinationales (les nations byzantines, musulmanes, slaves, grecques) peut être considéré, du fait de son étendue spatio-temporelle, comme justement ce discours unique.
En même temps, l'ensemble d'une telle pensée exige un discours critique susceptible de l'articuler dans le discours architectural contemporain. La recherche a alors dépassé le discours architectural néohellénique, pour aboutir aux phénomènes cognitifs généraux concernant le discours sur la ville et l'architecture dans l'Occident latin comme dans l'Orient hellène, c'est-à-dire dans la vaste culture européenne.
Un tel livre s'adresse à divers publics. Il y a d'abord ceux qui s'intéressent à la genèse d'un monde qui nous est trop méconnu. Ensuite, il y a une diversité de publics qui sont préoccupés par le devenir de nos villes, pour qui la comparaison peut créer un champ de liberté pour imaginer des scénarios d'avenir. Dans tous les cas, il s'agit de suivre l'auteur pas à pas pour ajouter toute la saveur d'un univers différent.
Le propos initial de cette recherche concernait les problèmes théoriques du discours architectural néohellénique. Mais celle-ci prit une dimension comparative avec l'étude, au niveau architectural, des relations discursives entre les cultures néohellénique, byzantine, occidentale et musulmane. Des phénomènes culturels complexes, déterminants au niveau du discours, comme le classicisme de la Renaissance occidentale et les points de vue sur la ville renaissante, ainsi que des aspects moins connus, comme le classicisme byzantin ou encore le modèle spatial des Byzantins (nommé modèle spatial de l'Orient hellène) ont sans doute leurs origines dans la Grèce ancienne, mais relever cette origine commune ne suffit pas pour énoncer les analogies et les différences, et donc leurs identités.
En particulier, le discours architectural de l'Orient hellène, et notamment celui du modèle spatial, par ses dimensions géographiques (les Balkans, l'Asie Mineure, la Méditerranée musulmane), diachroniques (au moins du Xe au XIXe siècle), et plurinationales (les nations byzantines, musulmanes, slaves, grecques) peut être considéré, du fait de son étendue spatio-temporelle, comme justement ce discours unique.
En même temps, l'ensemble d'une telle pensée exige un discours critique susceptible de l'articuler dans le discours architectural contemporain. La recherche a alors dépassé le discours architectural néohellénique, pour aboutir aux phénomènes cognitifs généraux concernant le discours sur la ville et l'architecture dans l'Occident latin comme dans l'Orient hellène, c'est-à-dire dans la vaste culture européenne.
Un tel livre s'adresse à divers publics. Il y a d'abord ceux qui s'intéressent à la genèse d'un monde qui nous est trop méconnu. Ensuite, il y a une diversité de publics qui sont préoccupés par le devenir de nos villes, pour qui la comparaison peut créer un champ de liberté pour imaginer des scénarios d'avenir. Dans tous les cas, il s'agit de suivre l'auteur pas à pas pour ajouter toute la saveur d'un univers différent.
En particulier, le discours architectural de l'Orient hellène, et notamment celui du modèle spatial, par ses dimensions géographiques (les Balkans, l'Asie Mineure, la Méditerranée musulmane), diachroniques (au moins du Xe au XIXe siècle), et plurinationales (les nations byzantines, musulmanes, slaves, grecques) peut être considéré, du fait de son étendue spatio-temporelle, comme justement ce discours unique.
En même temps, l'ensemble d'une telle pensée exige un discours critique susceptible de l'articuler dans le discours architectural contemporain. La recherche a alors dépassé le discours architectural néohellénique, pour aboutir aux phénomènes cognitifs généraux concernant le discours sur la ville et l'architecture dans l'Occident latin comme dans l'Orient hellène, c'est-à-dire dans la vaste culture européenne.
Un tel livre s'adresse à divers publics. Il y a d'abord ceux qui s'intéressent à la genèse d'un monde qui nous est trop méconnu. Ensuite, il y a une diversité de publics qui sont préoccupés par le devenir de nos villes, pour qui la comparaison peut créer un champ de liberté pour imaginer des scénarios d'avenir. Dans tous les cas, il s'agit de suivre l'auteur pas à pas pour ajouter toute la saveur d'un univers différent.