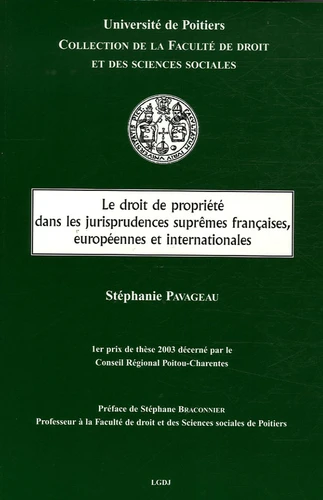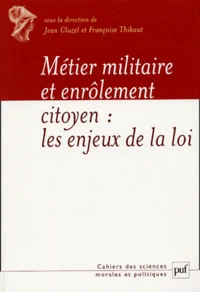Le droit de la propriété dans les jurisprudences suprêmes françaises, européennes et internationales
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages474
- PrésentationBroché
- Poids0.73 kg
- Dimensions16,5 cm × 24,0 cm × 3,0 cm
- ISBN2-275-02522-7
- EAN9782275025223
- Date de parution02/05/2006
- CollectionFaculté de droit Poitiers
- ÉditeurLGDJ
- PréfacierStéphane Braconnier
Résumé
Garanti par l'ensemble des juridictions suprêmes françaises, européennes et internationales, le droit de propriété se trouve au cœur d'un jeu d'influences croisées entre les diverses jurisprudences.
Détaché de sa structure classique, le droit de propriété est une notion commune au contenu variable. Appréhendé de façon souple et convergente par les différentes Cours, il est conçu comme une relation patrimoniale privilégiée entre son titulaire, personne privée ou publique, et le bien sûr lequel il porte. Ce dernier se révèle être une notion aux contours incertains, caractérisée par une dématérialisation croissante.
Traditionnellement considérée comme un faible rempart contre les atteintes dont il fait l'objet, la protection juridictionnelle du droit de propriété tend cependant à se renouveler. Ce mouvement est perceptible tant au stade de la qualification des atteintes qu'à celui de l'appréciation de leur légitimité. En tenant compte du degré de gravité de l'ingérence, les juges ont su dépasser la distinction classique fondée sur la seule nature de l'atteinte et ainsi renforcer les garanties entourant certaines mesures non privatives. Le renouvellement de cette protection passe, en outre, par le refus de toute ingérence arbitraire, ce qui se traduit aujourd'hui par des exigences plus grandes en matières de garanties procédurales et indemnitaires. Ces divers éléments offrent au juge un ensemble de données objectives lui permettant d'exercer un contrôle de proportionnalité. Le rejet de toute mesure disproportionnée visant le droit de propriété implique que les juges veillent à l'existence d'un intérêt supérieur, vecteur de la satisfaction du bien commun, et au respect d'un certain équilibre entre l'atteinte portée au droit de propriété et l'intérêt de la collectivité. Si les juridictions suprêmes demeurent encore prudentes dans l'appréciation qu'elles portent sur l'intérêt général, elles n'hésitent plus à censurer des mesures qui se révèlent manifestement excessives.
Garanti par l'ensemble des juridictions suprêmes françaises, européennes et internationales, le droit de propriété se trouve au cœur d'un jeu d'influences croisées entre les diverses jurisprudences.
Détaché de sa structure classique, le droit de propriété est une notion commune au contenu variable. Appréhendé de façon souple et convergente par les différentes Cours, il est conçu comme une relation patrimoniale privilégiée entre son titulaire, personne privée ou publique, et le bien sûr lequel il porte. Ce dernier se révèle être une notion aux contours incertains, caractérisée par une dématérialisation croissante.
Traditionnellement considérée comme un faible rempart contre les atteintes dont il fait l'objet, la protection juridictionnelle du droit de propriété tend cependant à se renouveler. Ce mouvement est perceptible tant au stade de la qualification des atteintes qu'à celui de l'appréciation de leur légitimité. En tenant compte du degré de gravité de l'ingérence, les juges ont su dépasser la distinction classique fondée sur la seule nature de l'atteinte et ainsi renforcer les garanties entourant certaines mesures non privatives. Le renouvellement de cette protection passe, en outre, par le refus de toute ingérence arbitraire, ce qui se traduit aujourd'hui par des exigences plus grandes en matières de garanties procédurales et indemnitaires. Ces divers éléments offrent au juge un ensemble de données objectives lui permettant d'exercer un contrôle de proportionnalité. Le rejet de toute mesure disproportionnée visant le droit de propriété implique que les juges veillent à l'existence d'un intérêt supérieur, vecteur de la satisfaction du bien commun, et au respect d'un certain équilibre entre l'atteinte portée au droit de propriété et l'intérêt de la collectivité. Si les juridictions suprêmes demeurent encore prudentes dans l'appréciation qu'elles portent sur l'intérêt général, elles n'hésitent plus à censurer des mesures qui se révèlent manifestement excessives.