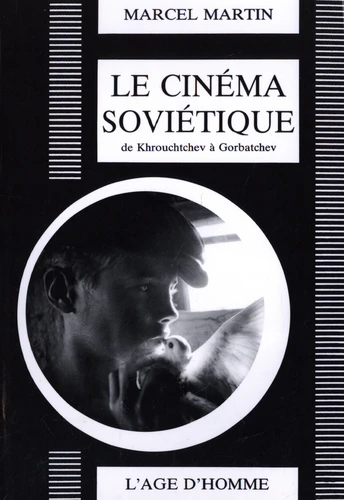Le cinéma soviétique. De Khrouchtchev à Gorbatchev (1955 - 1992)
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Nombre de pages223
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.395 kg
- Dimensions15,5 cm × 23,0 cm × 2,0 cm
- ISBN2-8251-0441-8
- EAN9782825104415
- Date de parution01/11/1993
- CollectionHistoire et théorie du cinéma
- ÉditeurL'Age d'Homme
Résumé
L'auteur analyse le cinéma soviétique après Staline en répartissant ce panorama artistique et culturel en trois périodes correspondant logiquement à l'évolution politique de l'URSS : le dégel amorcé par Khrouchtchev (1955-1968), la stagnation sous le long règne de Brejnev (1968-1985) et la perestroïka impulsée par Gorbatchev (1985-1992). Sa connaissance personnelle des films et du contexte socioculturel lui a permis une approche directe et précise d'un développement artistique étroitement conditionné par le système politique mais qui a pu se ménager des espaces de liberté créatrice non négligeables au vu du bilan de la période.
Ce n'est pas le moindre paradoxe du régime soviétique, en effet, que le financement du cinéma par l'Etat ait assuré aux réalisateurs des conditions de travail souvent enviables et permis la production de bon nombre d'oeuvres comportant, dans certaines limites, une critique des déficiences et des handicaps du système : mais les films interdits dans les années 70, visibles aujourd'hui, témoignent de l'affrontement permanent entre une bureaucratie étouffante et répressive et des cinéastes soucieux de s'exprimer en tant qu'artistes et citoyens.
De Quand passent les cigognes à L'Enfance d'Ivan et des Chevaux de feu au Repentir, l'histoire du cinéma soviétique après Staline est jalonnée de film qui ont eu un retentissement mondial mais l'interdiction de bon nombre de chefs-d'oeuvre n'a pas permis à ce cinéma d'occuper sur l'échiquier international la place de premier plan à laquelle il aurait pu prétendre. La perestroïka a heureusement favorisé une explosion thématique et stylistique dont témoignent La petite Véra, Taxi Blues et Bouge pas, meurs, ressuscite.
Au terme de son bilan, Marcel Martin peut écrire que le cinéma est le seul domaine du communisme soviétique dont le bilan soit globalement positif. Mais, malgré sa vitalité créatrice retrouvée, l'avenir de ce cinéma parait bien incertain : brutalement déstabilisé par les impératifs de l'économie de marché, confronté aux tentations stérilisantes de la rentabilité commerciale, il ne survit guère, dans ce qu'il a de plus ambitieux et de plus accompli, que grâce aux coproductions étrangères, en particulier françaises.
Ce n'est pas le moindre paradoxe du régime soviétique, en effet, que le financement du cinéma par l'Etat ait assuré aux réalisateurs des conditions de travail souvent enviables et permis la production de bon nombre d'oeuvres comportant, dans certaines limites, une critique des déficiences et des handicaps du système : mais les films interdits dans les années 70, visibles aujourd'hui, témoignent de l'affrontement permanent entre une bureaucratie étouffante et répressive et des cinéastes soucieux de s'exprimer en tant qu'artistes et citoyens.
De Quand passent les cigognes à L'Enfance d'Ivan et des Chevaux de feu au Repentir, l'histoire du cinéma soviétique après Staline est jalonnée de film qui ont eu un retentissement mondial mais l'interdiction de bon nombre de chefs-d'oeuvre n'a pas permis à ce cinéma d'occuper sur l'échiquier international la place de premier plan à laquelle il aurait pu prétendre. La perestroïka a heureusement favorisé une explosion thématique et stylistique dont témoignent La petite Véra, Taxi Blues et Bouge pas, meurs, ressuscite.
Au terme de son bilan, Marcel Martin peut écrire que le cinéma est le seul domaine du communisme soviétique dont le bilan soit globalement positif. Mais, malgré sa vitalité créatrice retrouvée, l'avenir de ce cinéma parait bien incertain : brutalement déstabilisé par les impératifs de l'économie de marché, confronté aux tentations stérilisantes de la rentabilité commerciale, il ne survit guère, dans ce qu'il a de plus ambitieux et de plus accompli, que grâce aux coproductions étrangères, en particulier françaises.
L'auteur analyse le cinéma soviétique après Staline en répartissant ce panorama artistique et culturel en trois périodes correspondant logiquement à l'évolution politique de l'URSS : le dégel amorcé par Khrouchtchev (1955-1968), la stagnation sous le long règne de Brejnev (1968-1985) et la perestroïka impulsée par Gorbatchev (1985-1992). Sa connaissance personnelle des films et du contexte socioculturel lui a permis une approche directe et précise d'un développement artistique étroitement conditionné par le système politique mais qui a pu se ménager des espaces de liberté créatrice non négligeables au vu du bilan de la période.
Ce n'est pas le moindre paradoxe du régime soviétique, en effet, que le financement du cinéma par l'Etat ait assuré aux réalisateurs des conditions de travail souvent enviables et permis la production de bon nombre d'oeuvres comportant, dans certaines limites, une critique des déficiences et des handicaps du système : mais les films interdits dans les années 70, visibles aujourd'hui, témoignent de l'affrontement permanent entre une bureaucratie étouffante et répressive et des cinéastes soucieux de s'exprimer en tant qu'artistes et citoyens.
De Quand passent les cigognes à L'Enfance d'Ivan et des Chevaux de feu au Repentir, l'histoire du cinéma soviétique après Staline est jalonnée de film qui ont eu un retentissement mondial mais l'interdiction de bon nombre de chefs-d'oeuvre n'a pas permis à ce cinéma d'occuper sur l'échiquier international la place de premier plan à laquelle il aurait pu prétendre. La perestroïka a heureusement favorisé une explosion thématique et stylistique dont témoignent La petite Véra, Taxi Blues et Bouge pas, meurs, ressuscite.
Au terme de son bilan, Marcel Martin peut écrire que le cinéma est le seul domaine du communisme soviétique dont le bilan soit globalement positif. Mais, malgré sa vitalité créatrice retrouvée, l'avenir de ce cinéma parait bien incertain : brutalement déstabilisé par les impératifs de l'économie de marché, confronté aux tentations stérilisantes de la rentabilité commerciale, il ne survit guère, dans ce qu'il a de plus ambitieux et de plus accompli, que grâce aux coproductions étrangères, en particulier françaises.
Ce n'est pas le moindre paradoxe du régime soviétique, en effet, que le financement du cinéma par l'Etat ait assuré aux réalisateurs des conditions de travail souvent enviables et permis la production de bon nombre d'oeuvres comportant, dans certaines limites, une critique des déficiences et des handicaps du système : mais les films interdits dans les années 70, visibles aujourd'hui, témoignent de l'affrontement permanent entre une bureaucratie étouffante et répressive et des cinéastes soucieux de s'exprimer en tant qu'artistes et citoyens.
De Quand passent les cigognes à L'Enfance d'Ivan et des Chevaux de feu au Repentir, l'histoire du cinéma soviétique après Staline est jalonnée de film qui ont eu un retentissement mondial mais l'interdiction de bon nombre de chefs-d'oeuvre n'a pas permis à ce cinéma d'occuper sur l'échiquier international la place de premier plan à laquelle il aurait pu prétendre. La perestroïka a heureusement favorisé une explosion thématique et stylistique dont témoignent La petite Véra, Taxi Blues et Bouge pas, meurs, ressuscite.
Au terme de son bilan, Marcel Martin peut écrire que le cinéma est le seul domaine du communisme soviétique dont le bilan soit globalement positif. Mais, malgré sa vitalité créatrice retrouvée, l'avenir de ce cinéma parait bien incertain : brutalement déstabilisé par les impératifs de l'économie de marché, confronté aux tentations stérilisantes de la rentabilité commerciale, il ne survit guère, dans ce qu'il a de plus ambitieux et de plus accompli, que grâce aux coproductions étrangères, en particulier françaises.