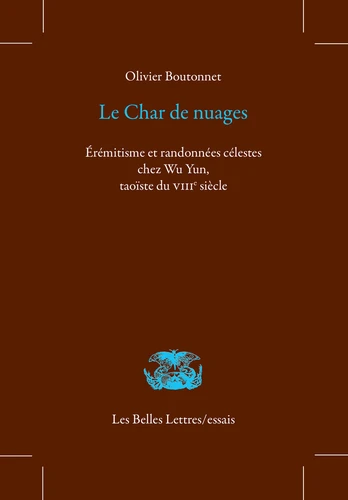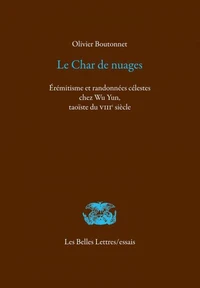Le Char de nuages. Erémitisme et randonnées célestes chez Wu Yun, taoïste du VIIIe siècle
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages314
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.504 kg
- Dimensions16,5 cm × 23,0 cm × 2,4 cm
- ISBN978-2-251-45186-2
- EAN9782251451862
- Date de parution10/09/2021
- CollectionLes Belles Lettres/essais
- ÉditeurBelles Lettres
Résumé
Le Char de nuages présente la vie et l'oeuvre de Wu Yun (ca. 715-778), une figure emblématique du taoïsme des Tang (618-907). Si une grande partie de sa production littéraire a aujourd'hui disparu, vraisemblablement sous la pression du clergé bouddhique à l'époque mongole, les textes qui ont survécu éclairent sous un nouveau jour notre compréhension des religiosités lettrées de la Chine médiévale.
Cet essai s'articule autour de deux axes. D'une part, l'étude du phénomène érémitique dont on pensait jusqu'alors qu'il avait été définitivement théorisé à l'orée du IVe siècle. Or Wu Yun révèle l'existence d'une troisième voie largement empruntée à son époque ; celle-ci conjugue l'intelligence de circonstance et l'accord avec la nature intime de l'être. Ses textes en sont les développements les plus aboutis.
D'autre part, l'analyse des "randonnées célestes" de l'auteur qui nous sont parvenues en intégralité. Wu Yun est le seul lettré taoïste de la Chine médiévale dont on peut mettre en perspective les traités, à vocation didactique, et les poèmes. Cette étude en miroir permet de reconstituer une fonction oubliée de la poésie sidérale, un deuxième niveau de lecture à vocation spirituelle. On s'aperçoit alors que ces écrits ne relevaient pas simplement d'un jeu stylistique et littéraire, ce que l'on considérait jusqu'à présent, mais qu'ils constituaient avant tout de véritables supports de méditation réservés à l'initié.
Il s'agissait de pratiques visionnaires, héritées d'une tradition ancienne, destinées à transformer la corporéité de l'adepte par la médiation de l'image intérieure. Ce dernier apprenait ainsi à "marcher dans le Vide" .
Cet essai s'articule autour de deux axes. D'une part, l'étude du phénomène érémitique dont on pensait jusqu'alors qu'il avait été définitivement théorisé à l'orée du IVe siècle. Or Wu Yun révèle l'existence d'une troisième voie largement empruntée à son époque ; celle-ci conjugue l'intelligence de circonstance et l'accord avec la nature intime de l'être. Ses textes en sont les développements les plus aboutis.
D'autre part, l'analyse des "randonnées célestes" de l'auteur qui nous sont parvenues en intégralité. Wu Yun est le seul lettré taoïste de la Chine médiévale dont on peut mettre en perspective les traités, à vocation didactique, et les poèmes. Cette étude en miroir permet de reconstituer une fonction oubliée de la poésie sidérale, un deuxième niveau de lecture à vocation spirituelle. On s'aperçoit alors que ces écrits ne relevaient pas simplement d'un jeu stylistique et littéraire, ce que l'on considérait jusqu'à présent, mais qu'ils constituaient avant tout de véritables supports de méditation réservés à l'initié.
Il s'agissait de pratiques visionnaires, héritées d'une tradition ancienne, destinées à transformer la corporéité de l'adepte par la médiation de l'image intérieure. Ce dernier apprenait ainsi à "marcher dans le Vide" .
Le Char de nuages présente la vie et l'oeuvre de Wu Yun (ca. 715-778), une figure emblématique du taoïsme des Tang (618-907). Si une grande partie de sa production littéraire a aujourd'hui disparu, vraisemblablement sous la pression du clergé bouddhique à l'époque mongole, les textes qui ont survécu éclairent sous un nouveau jour notre compréhension des religiosités lettrées de la Chine médiévale.
Cet essai s'articule autour de deux axes. D'une part, l'étude du phénomène érémitique dont on pensait jusqu'alors qu'il avait été définitivement théorisé à l'orée du IVe siècle. Or Wu Yun révèle l'existence d'une troisième voie largement empruntée à son époque ; celle-ci conjugue l'intelligence de circonstance et l'accord avec la nature intime de l'être. Ses textes en sont les développements les plus aboutis.
D'autre part, l'analyse des "randonnées célestes" de l'auteur qui nous sont parvenues en intégralité. Wu Yun est le seul lettré taoïste de la Chine médiévale dont on peut mettre en perspective les traités, à vocation didactique, et les poèmes. Cette étude en miroir permet de reconstituer une fonction oubliée de la poésie sidérale, un deuxième niveau de lecture à vocation spirituelle. On s'aperçoit alors que ces écrits ne relevaient pas simplement d'un jeu stylistique et littéraire, ce que l'on considérait jusqu'à présent, mais qu'ils constituaient avant tout de véritables supports de méditation réservés à l'initié.
Il s'agissait de pratiques visionnaires, héritées d'une tradition ancienne, destinées à transformer la corporéité de l'adepte par la médiation de l'image intérieure. Ce dernier apprenait ainsi à "marcher dans le Vide" .
Cet essai s'articule autour de deux axes. D'une part, l'étude du phénomène érémitique dont on pensait jusqu'alors qu'il avait été définitivement théorisé à l'orée du IVe siècle. Or Wu Yun révèle l'existence d'une troisième voie largement empruntée à son époque ; celle-ci conjugue l'intelligence de circonstance et l'accord avec la nature intime de l'être. Ses textes en sont les développements les plus aboutis.
D'autre part, l'analyse des "randonnées célestes" de l'auteur qui nous sont parvenues en intégralité. Wu Yun est le seul lettré taoïste de la Chine médiévale dont on peut mettre en perspective les traités, à vocation didactique, et les poèmes. Cette étude en miroir permet de reconstituer une fonction oubliée de la poésie sidérale, un deuxième niveau de lecture à vocation spirituelle. On s'aperçoit alors que ces écrits ne relevaient pas simplement d'un jeu stylistique et littéraire, ce que l'on considérait jusqu'à présent, mais qu'ils constituaient avant tout de véritables supports de méditation réservés à l'initié.
Il s'agissait de pratiques visionnaires, héritées d'une tradition ancienne, destinées à transformer la corporéité de l'adepte par la médiation de l'image intérieure. Ce dernier apprenait ainsi à "marcher dans le Vide" .
Avis des lecteursCommentaires laissés par nos lecteurs
5/5