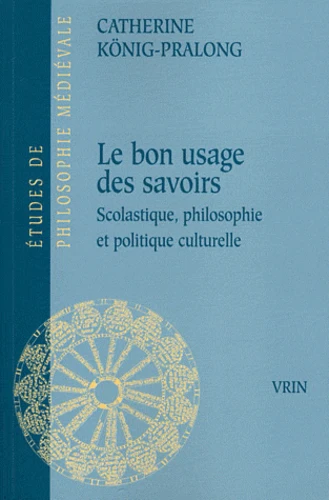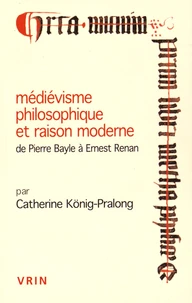Le bon usage des savoirs. Scolastique, Philosophie et Politique culturelle
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 22 décembreCet article sera commandé chez un fournisseur et vous sera envoyé 5 jours après la date de votre commande.
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 22 décembre
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages358
- PrésentationBroché
- Poids0.555 kg
- Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 2,1 cm
- ISBN978-2-7116-2358-7
- EAN9782711623587
- Date de parution18/10/2011
- CollectionEtudes de philosophie médiéval
- ÉditeurVrin
Résumé
La philosophie médiévale est en général mieux connue que ses
auteurs. Ce livre s'intéresse aux auteurs, vrais acteurs
intellectuels qui fournirent les textes ayant servi de matériaux
à l'histoire de la philosophie médiévale. Qui sont-ils ? Dans
quels lieux institutionnels et dans quelles conditions
culturelles ont-ils travaillé ? Quelles conceptions se faisaient-
ils de leur mission, de ses intérêts et de ses fins ? Démentant
un préjugé répandu, les scolastiques se révèlent intéressés à la
politique culturelle ; ils avaient une conscience aiguë des
enjeux épistémiques, éthiques et sociaux de leurs pratiques
professionnelles.
Cette étude documente ces autoreprésentations et les met en regard de la description des pratiques savantes des auteurs scolastiques, reconstruisant ainsi leurs différentes conceptions du savoir et de la société chrétienne. La lecture de textes issus de divers milieux et temps, permet de poser les distinctions, entre clerc et laïc, évêque et docteur, arts libéraux et arts mécaniques, sédentaires et pérégrins, adulte et enfant, homme et femme, centre et périphérie, chrétien et non chrétien, théologie et philosophie.
Conditions culturelles du savoir et contenus doctrinaux sont approchés par des méthodes irréductiblement différentes, qui convergent cependant sur un même objet, le texte qualifié de "philosophique" par son auteur ou par ses historiens.
Cette étude documente ces autoreprésentations et les met en regard de la description des pratiques savantes des auteurs scolastiques, reconstruisant ainsi leurs différentes conceptions du savoir et de la société chrétienne. La lecture de textes issus de divers milieux et temps, permet de poser les distinctions, entre clerc et laïc, évêque et docteur, arts libéraux et arts mécaniques, sédentaires et pérégrins, adulte et enfant, homme et femme, centre et périphérie, chrétien et non chrétien, théologie et philosophie.
Conditions culturelles du savoir et contenus doctrinaux sont approchés par des méthodes irréductiblement différentes, qui convergent cependant sur un même objet, le texte qualifié de "philosophique" par son auteur ou par ses historiens.
La philosophie médiévale est en général mieux connue que ses
auteurs. Ce livre s'intéresse aux auteurs, vrais acteurs
intellectuels qui fournirent les textes ayant servi de matériaux
à l'histoire de la philosophie médiévale. Qui sont-ils ? Dans
quels lieux institutionnels et dans quelles conditions
culturelles ont-ils travaillé ? Quelles conceptions se faisaient-
ils de leur mission, de ses intérêts et de ses fins ? Démentant
un préjugé répandu, les scolastiques se révèlent intéressés à la
politique culturelle ; ils avaient une conscience aiguë des
enjeux épistémiques, éthiques et sociaux de leurs pratiques
professionnelles.
Cette étude documente ces autoreprésentations et les met en regard de la description des pratiques savantes des auteurs scolastiques, reconstruisant ainsi leurs différentes conceptions du savoir et de la société chrétienne. La lecture de textes issus de divers milieux et temps, permet de poser les distinctions, entre clerc et laïc, évêque et docteur, arts libéraux et arts mécaniques, sédentaires et pérégrins, adulte et enfant, homme et femme, centre et périphérie, chrétien et non chrétien, théologie et philosophie.
Conditions culturelles du savoir et contenus doctrinaux sont approchés par des méthodes irréductiblement différentes, qui convergent cependant sur un même objet, le texte qualifié de "philosophique" par son auteur ou par ses historiens.
Cette étude documente ces autoreprésentations et les met en regard de la description des pratiques savantes des auteurs scolastiques, reconstruisant ainsi leurs différentes conceptions du savoir et de la société chrétienne. La lecture de textes issus de divers milieux et temps, permet de poser les distinctions, entre clerc et laïc, évêque et docteur, arts libéraux et arts mécaniques, sédentaires et pérégrins, adulte et enfant, homme et femme, centre et périphérie, chrétien et non chrétien, théologie et philosophie.
Conditions culturelles du savoir et contenus doctrinaux sont approchés par des méthodes irréductiblement différentes, qui convergent cependant sur un même objet, le texte qualifié de "philosophique" par son auteur ou par ses historiens.