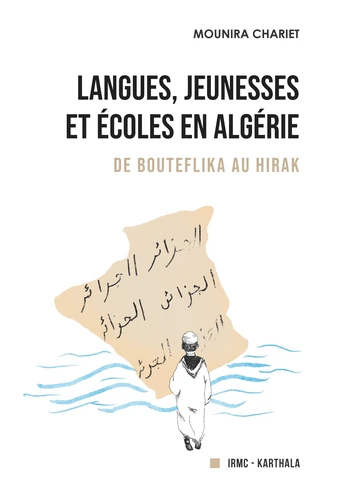Langues, jeunesses et écoles en Algérie. De Bouteflika au Hirak
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages352
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.461 kg
- Dimensions15,0 cm × 21,0 cm × 2,5 cm
- ISBN978-2-38409-366-3
- EAN9782384093663
- Date de parution22/05/2025
- CollectionMaghreb contemporain : nouvel
- ÉditeurKarthala
- PréfacierLuis Martinez
Résumé
Cet ouvrage analyse les transformations de l'Algérie contemporaine en interrogeant ses langues et ses systèmes éducatifs aux différentes phases de son histoire. A l'indépendance, le choix de l'arabisation et sa mise en oeuvre dans le champ scolaire jusqu'à l'université sont engagés au détriment de la diversité des langues parlées - darija, tamazight et français - et de leurs variétés. Dans l'esprit des législateurs, et dans leurs discours, celle-ci devait permettre la récupération d'une identité bafouée durant la colonisation, contribuer à la construction de l'Etat-nation et, à terme, à l'unification linguistique et culturelle du pays au service d'une citoyenneté algérienne spécifique.
A rebours des approches normatives qui concluent à l'échec de l'arabisation, mais aussi de celles qui interprètent le maintien du français comme une intériorisation des rapports de domination coloniale, nous proposons une approche en termes de complexité. Dans le côtoiement des langues et de leurs différents registres et variétés, notre démarche est de saisir les indices de transformations plus discrètes à l'oeuvre dans la société, de la plus urbaine à la plus rurale, tenant compte des configurations nouvelles et évolutives du pays, des années Bouteflika au Hirak.
A travers la jeunesse et les pratiques sociales, convoquant des matériaux divers, de l'observation sociologique à la production du cinéma algérien, cette analyse met en évidence les prémices du désaveu de la société pour le politique.
A rebours des approches normatives qui concluent à l'échec de l'arabisation, mais aussi de celles qui interprètent le maintien du français comme une intériorisation des rapports de domination coloniale, nous proposons une approche en termes de complexité. Dans le côtoiement des langues et de leurs différents registres et variétés, notre démarche est de saisir les indices de transformations plus discrètes à l'oeuvre dans la société, de la plus urbaine à la plus rurale, tenant compte des configurations nouvelles et évolutives du pays, des années Bouteflika au Hirak.
A travers la jeunesse et les pratiques sociales, convoquant des matériaux divers, de l'observation sociologique à la production du cinéma algérien, cette analyse met en évidence les prémices du désaveu de la société pour le politique.
Cet ouvrage analyse les transformations de l'Algérie contemporaine en interrogeant ses langues et ses systèmes éducatifs aux différentes phases de son histoire. A l'indépendance, le choix de l'arabisation et sa mise en oeuvre dans le champ scolaire jusqu'à l'université sont engagés au détriment de la diversité des langues parlées - darija, tamazight et français - et de leurs variétés. Dans l'esprit des législateurs, et dans leurs discours, celle-ci devait permettre la récupération d'une identité bafouée durant la colonisation, contribuer à la construction de l'Etat-nation et, à terme, à l'unification linguistique et culturelle du pays au service d'une citoyenneté algérienne spécifique.
A rebours des approches normatives qui concluent à l'échec de l'arabisation, mais aussi de celles qui interprètent le maintien du français comme une intériorisation des rapports de domination coloniale, nous proposons une approche en termes de complexité. Dans le côtoiement des langues et de leurs différents registres et variétés, notre démarche est de saisir les indices de transformations plus discrètes à l'oeuvre dans la société, de la plus urbaine à la plus rurale, tenant compte des configurations nouvelles et évolutives du pays, des années Bouteflika au Hirak.
A travers la jeunesse et les pratiques sociales, convoquant des matériaux divers, de l'observation sociologique à la production du cinéma algérien, cette analyse met en évidence les prémices du désaveu de la société pour le politique.
A rebours des approches normatives qui concluent à l'échec de l'arabisation, mais aussi de celles qui interprètent le maintien du français comme une intériorisation des rapports de domination coloniale, nous proposons une approche en termes de complexité. Dans le côtoiement des langues et de leurs différents registres et variétés, notre démarche est de saisir les indices de transformations plus discrètes à l'oeuvre dans la société, de la plus urbaine à la plus rurale, tenant compte des configurations nouvelles et évolutives du pays, des années Bouteflika au Hirak.
A travers la jeunesse et les pratiques sociales, convoquant des matériaux divers, de l'observation sociologique à la production du cinéma algérien, cette analyse met en évidence les prémices du désaveu de la société pour le politique.