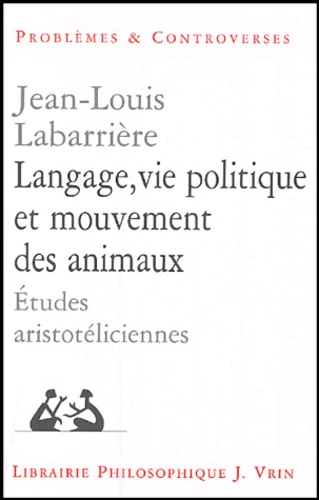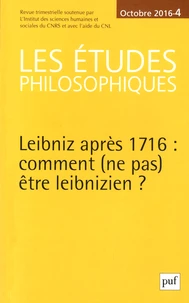Langage, vie politique et mouvement des animaux. Etudes aristotéliciennes
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages270
- PrésentationBroché
- Poids0.345 kg
- Dimensions13,5 cm × 21,5 cm × 1,6 cm
- ISBN2-7116-1706-8
- EAN9782711617067
- Date de parution01/09/2004
- CollectionProblèmes et controverses
- ÉditeurVrin
Résumé
Les traités de zoologie d'Aristote ne sont nullement des traités mineurs, voire anecdotiques, mais des traités à inscrire au contraire dans la vaste " enquête sur la nature " qu'il entendait mener et qui caractérise si bien sa philosophie. Qu'en est-il cependant des capacités animales telles qu'Aristote les a décrites ? Le problème est autre, tant, dans nombre de recherches récentes, les animaux eux-mêmes semblent avoir été parfois comme oubliés en chemin au profit de recherches plus épistémologiques. C'est ce singulier " oubli " que ces études voudraient commencer de réparer en s'attachant à ce qu'Aristote dit effectivement de la vie même des animaux et de leurs capacités à communiquer, à vivre en société, voire tout simplement à se mouvoir. Qu'en est-il exactement de la différence entre la voix que possèdent certains animaux et le langage propre aux êtres humains ? Comment se peut-il qu'Aristote qualifie certains autres animaux que l'homme de " politiques " et non seulement de " grégaires " ? Par quels mécanismes psychologiques et physiologiques les animaux se mettent-ils en mouvement ? Que cherche à expliquer le prétendu " syllogisme pratique " ? Telles sont les questions abordées dans ces études. Si ces questions sont encore largement les nôtres, il n'en sera que plus pertinent d'aller chercher quelles réponses Aristote y apporta. L'histoire de la philosophie et l'histoire des sciences croiseront ainsi notre questionnement contemporain en psychologie comparée, en éthologie, dans les sciences cognitives, voire dans cette discipline qui a si mauvaise réputation : la sociobiologie. Et si Aristote, tenu aussi bien pour le fondateur de la zoologie et de la " biologie " que pour celui de la différence ontologique entre l'homme et l'animal du fait que seul l'homme possède en propre le logos, devait être aussi tenu pour le " père " de la sociobiologie ?
Les traités de zoologie d'Aristote ne sont nullement des traités mineurs, voire anecdotiques, mais des traités à inscrire au contraire dans la vaste " enquête sur la nature " qu'il entendait mener et qui caractérise si bien sa philosophie. Qu'en est-il cependant des capacités animales telles qu'Aristote les a décrites ? Le problème est autre, tant, dans nombre de recherches récentes, les animaux eux-mêmes semblent avoir été parfois comme oubliés en chemin au profit de recherches plus épistémologiques. C'est ce singulier " oubli " que ces études voudraient commencer de réparer en s'attachant à ce qu'Aristote dit effectivement de la vie même des animaux et de leurs capacités à communiquer, à vivre en société, voire tout simplement à se mouvoir. Qu'en est-il exactement de la différence entre la voix que possèdent certains animaux et le langage propre aux êtres humains ? Comment se peut-il qu'Aristote qualifie certains autres animaux que l'homme de " politiques " et non seulement de " grégaires " ? Par quels mécanismes psychologiques et physiologiques les animaux se mettent-ils en mouvement ? Que cherche à expliquer le prétendu " syllogisme pratique " ? Telles sont les questions abordées dans ces études. Si ces questions sont encore largement les nôtres, il n'en sera que plus pertinent d'aller chercher quelles réponses Aristote y apporta. L'histoire de la philosophie et l'histoire des sciences croiseront ainsi notre questionnement contemporain en psychologie comparée, en éthologie, dans les sciences cognitives, voire dans cette discipline qui a si mauvaise réputation : la sociobiologie. Et si Aristote, tenu aussi bien pour le fondateur de la zoologie et de la " biologie " que pour celui de la différence ontologique entre l'homme et l'animal du fait que seul l'homme possède en propre le logos, devait être aussi tenu pour le " père " de la sociobiologie ?