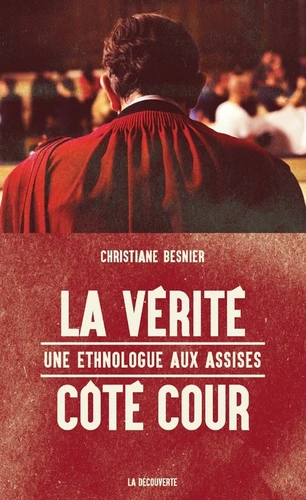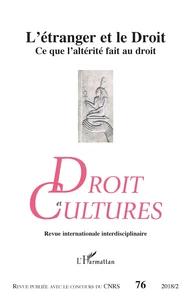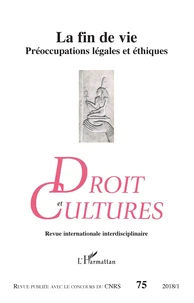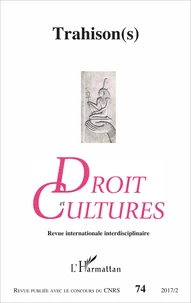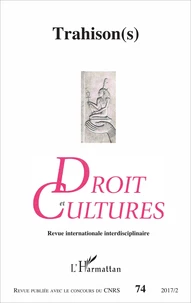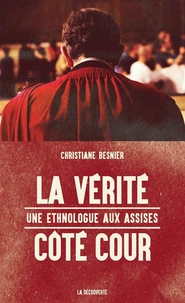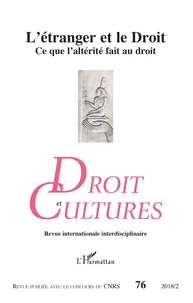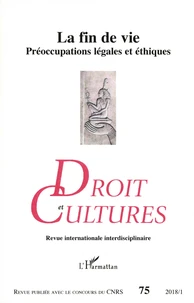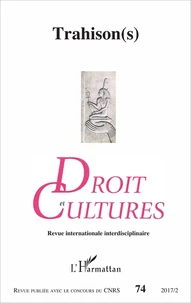La vérité côté cour. Une ethnologue aux assises
Par :Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages256
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.32 kg
- Dimensions13,5 cm × 22,0 cm × 2,1 cm
- ISBN978-2-7071-9211-0
- EAN9782707192110
- Date de parution24/05/2017
- CollectionCahiers libres
- ÉditeurLa Découverte
Résumé
Fruit d'une quinzaine d'années d'immersion dans les prétoires, La Vérité côté cour propose pour la première fois une approche ethnographique de la cour d'assises. C'est en effet en ethnologue que l'auteur a suivi une quarantaine de procès de 2001 à 2016, dans le Nord, en Ile-de-France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Midi-Pyrénées. Il s'agissait principalement d'affaires de moeurs (viols et incestes) et d'homicides (meurtres et assassinats).
L'enquête s'est ainsi nourrie d'une observation prolongée, de notes d'audience et d'entretiens menés auprès de présidents de cour d'assises, procureurs, avocats, greffiers, etc. La principale visée du livre est de dresser un parallèle entre la façon dont la cour d'assises cherche à établir la vérité et la recherche en laboratoire. Le président formule des hypothèses à partir de l'observation des faits, qu'il soumet au débat – l'oralité est particulièrement importante dans ce processus – pour en mesurer la validité.
Il est assisté dans cette tâche par les autres acteurs de l'audience. A travers de nombreuses citations saisies sur le vif, l'auteure montre comment la cour d'assises produit une vérité construite collectivement, à l'inverse de la justice américaine qui vise à désigner un gagnant et un perdant au cours d'un affrontement entre avocats. Cette comparaison met en évidence le sens du modèle français : la recherche graduelle de la vérité, à laquelle toutes les parties contribuent, faisant " oeuvre commune ".
L'enquête s'est ainsi nourrie d'une observation prolongée, de notes d'audience et d'entretiens menés auprès de présidents de cour d'assises, procureurs, avocats, greffiers, etc. La principale visée du livre est de dresser un parallèle entre la façon dont la cour d'assises cherche à établir la vérité et la recherche en laboratoire. Le président formule des hypothèses à partir de l'observation des faits, qu'il soumet au débat – l'oralité est particulièrement importante dans ce processus – pour en mesurer la validité.
Il est assisté dans cette tâche par les autres acteurs de l'audience. A travers de nombreuses citations saisies sur le vif, l'auteure montre comment la cour d'assises produit une vérité construite collectivement, à l'inverse de la justice américaine qui vise à désigner un gagnant et un perdant au cours d'un affrontement entre avocats. Cette comparaison met en évidence le sens du modèle français : la recherche graduelle de la vérité, à laquelle toutes les parties contribuent, faisant " oeuvre commune ".
Fruit d'une quinzaine d'années d'immersion dans les prétoires, La Vérité côté cour propose pour la première fois une approche ethnographique de la cour d'assises. C'est en effet en ethnologue que l'auteur a suivi une quarantaine de procès de 2001 à 2016, dans le Nord, en Ile-de-France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Midi-Pyrénées. Il s'agissait principalement d'affaires de moeurs (viols et incestes) et d'homicides (meurtres et assassinats).
L'enquête s'est ainsi nourrie d'une observation prolongée, de notes d'audience et d'entretiens menés auprès de présidents de cour d'assises, procureurs, avocats, greffiers, etc. La principale visée du livre est de dresser un parallèle entre la façon dont la cour d'assises cherche à établir la vérité et la recherche en laboratoire. Le président formule des hypothèses à partir de l'observation des faits, qu'il soumet au débat – l'oralité est particulièrement importante dans ce processus – pour en mesurer la validité.
Il est assisté dans cette tâche par les autres acteurs de l'audience. A travers de nombreuses citations saisies sur le vif, l'auteure montre comment la cour d'assises produit une vérité construite collectivement, à l'inverse de la justice américaine qui vise à désigner un gagnant et un perdant au cours d'un affrontement entre avocats. Cette comparaison met en évidence le sens du modèle français : la recherche graduelle de la vérité, à laquelle toutes les parties contribuent, faisant " oeuvre commune ".
L'enquête s'est ainsi nourrie d'une observation prolongée, de notes d'audience et d'entretiens menés auprès de présidents de cour d'assises, procureurs, avocats, greffiers, etc. La principale visée du livre est de dresser un parallèle entre la façon dont la cour d'assises cherche à établir la vérité et la recherche en laboratoire. Le président formule des hypothèses à partir de l'observation des faits, qu'il soumet au débat – l'oralité est particulièrement importante dans ce processus – pour en mesurer la validité.
Il est assisté dans cette tâche par les autres acteurs de l'audience. A travers de nombreuses citations saisies sur le vif, l'auteure montre comment la cour d'assises produit une vérité construite collectivement, à l'inverse de la justice américaine qui vise à désigner un gagnant et un perdant au cours d'un affrontement entre avocats. Cette comparaison met en évidence le sens du modèle français : la recherche graduelle de la vérité, à laquelle toutes les parties contribuent, faisant " oeuvre commune ".