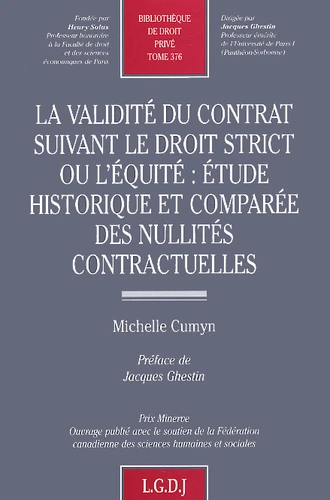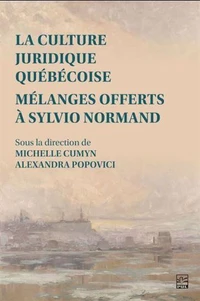La Validite Du Contrat Suivant Le Droit Strict Ou L'Equite : Etude Historique Et Comparee Des Nullites Contractuelles
Par :Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages300
- PrésentationBroché
- Poids0.49 kg
- Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 1,8 cm
- ISBN2-275-02263-5
- EAN9782275022635
- Date de parution15/11/2002
- CollectionBibliothèque de Droit privé
- ÉditeurLGDJ
Résumé
Cette étude explore les fondements historiques des nullités contractuelles en droit civil et en droit de tradition anglaise, pour proposer ensuite une réinterprétation des nullités en droit contemporain. En droit romain, en Ancien droit français et en droit de tradition anglaise, la distinction entre les nullités absolue et relative (ou void et voidable contracts) tire son origine d'une opposition entre une juridiction de droit strict et une juridiction d'équité.
On en déduit que l'inexistence et la nullité absolue sanctionnent la non-conformité du contrat au droit strict, dont le rôle est de définir, en termes objectifs et généraux, les critères permettant l'identification du contrat et les règles assurant sa conformité à l'utilité sociale. La nullité relative est un remède d'équité permettant d'intervenir pour faire exception à la validité du contrat selon le droit strict, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'espèce, il paraît injuste de donner effet au contrat. Ainsi les principes de justice contractuelle, issus de l'équité, permettent à la partie victime d'une injustice lors de la formation du contrat d'en être libérée grâce au recours en nullité relative.
Cette conception de la distinction entre les nullités relative et absolue implique le rejet à la fois de la théorie dite classique et de la théorie dite moderne des nullités, tout en confortant le point de vue voulant que la nullité absolue est liée à l'utilité sociale du contrat, tandis que la nullité relative est liée à la justice contractuelle.
Cette étude explore les fondements historiques des nullités contractuelles en droit civil et en droit de tradition anglaise, pour proposer ensuite une réinterprétation des nullités en droit contemporain. En droit romain, en Ancien droit français et en droit de tradition anglaise, la distinction entre les nullités absolue et relative (ou void et voidable contracts) tire son origine d'une opposition entre une juridiction de droit strict et une juridiction d'équité.
On en déduit que l'inexistence et la nullité absolue sanctionnent la non-conformité du contrat au droit strict, dont le rôle est de définir, en termes objectifs et généraux, les critères permettant l'identification du contrat et les règles assurant sa conformité à l'utilité sociale. La nullité relative est un remède d'équité permettant d'intervenir pour faire exception à la validité du contrat selon le droit strict, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'espèce, il paraît injuste de donner effet au contrat. Ainsi les principes de justice contractuelle, issus de l'équité, permettent à la partie victime d'une injustice lors de la formation du contrat d'en être libérée grâce au recours en nullité relative.
Cette conception de la distinction entre les nullités relative et absolue implique le rejet à la fois de la théorie dite classique et de la théorie dite moderne des nullités, tout en confortant le point de vue voulant que la nullité absolue est liée à l'utilité sociale du contrat, tandis que la nullité relative est liée à la justice contractuelle.