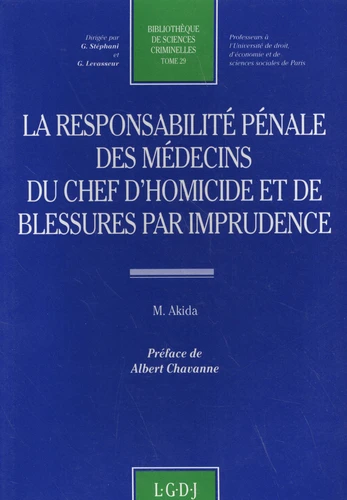La responsabilité pénale des médecins du chef d'homicide et de blessures par imprudence
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages456
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.78 kg
- Dimensions16,5 cm × 24,0 cm × 2,5 cm
- ISBN2-275-00381-9
- EAN9782275003818
- Date de parution01/12/1994
- CollectionBibliothèque de sciences crimi
- ÉditeurLGDJ
- PréfacierAlbert Chavanne
Résumé
La responsabilité pénale des médecins est mise en cause dix fois plus souvent aujourd'hui qu'il y a trente ans. La loi du 8 juillet 1983 (art. 470-1 C.P.P.) laissait espérer que les victimes pourraient obtenir réparation du dommage subi, "en vertu des règles du droit civil", en dépit d'une relaxe par le tribunal correctionnel. Malheureusement l'effet a été peu perceptible, du fait que la jurisprudence continue à s'en tenir (depuis 1912) à la thèse de l'unité de la faute civile et de la faute pénale.
M. Akida, comme l'unanimité de la doctrine à l'heure actuelle, critique ce point de vue. La responsabilité pénale du médecin suppose une faute de celui-ci et une relation de cause à effet entre cette faute et le dommage. L'auteur examine avec soin ces deux points, analysant une jurisprudence qui conserve toute son autorité en dépit de la promulgation du nouveau code pénal. La faute peut être relevée dans l'exercice individuel de la médecine, aussi bien que dans son exercice au sein d'une équipe chirurgicale.
Le lien de causalité est conçu par la jurisprudence française sur un mode extensif. Il peut être réalisé même en cas de comportement simplement passif du médecin ; il peut exister en même temps en liaison avec d'autres fautes (imputables à d'autres membres du corps médical, à des auxiliaires médicaux, à des tiers, au malade lui-même, ou encore aux prédispositions de celui-ci). Cet ouvrage intéresse donc tous les praticiens de l'art médical, aussi bien que les juristes même non pénalistes.
M. Akida, comme l'unanimité de la doctrine à l'heure actuelle, critique ce point de vue. La responsabilité pénale du médecin suppose une faute de celui-ci et une relation de cause à effet entre cette faute et le dommage. L'auteur examine avec soin ces deux points, analysant une jurisprudence qui conserve toute son autorité en dépit de la promulgation du nouveau code pénal. La faute peut être relevée dans l'exercice individuel de la médecine, aussi bien que dans son exercice au sein d'une équipe chirurgicale.
Le lien de causalité est conçu par la jurisprudence française sur un mode extensif. Il peut être réalisé même en cas de comportement simplement passif du médecin ; il peut exister en même temps en liaison avec d'autres fautes (imputables à d'autres membres du corps médical, à des auxiliaires médicaux, à des tiers, au malade lui-même, ou encore aux prédispositions de celui-ci). Cet ouvrage intéresse donc tous les praticiens de l'art médical, aussi bien que les juristes même non pénalistes.
La responsabilité pénale des médecins est mise en cause dix fois plus souvent aujourd'hui qu'il y a trente ans. La loi du 8 juillet 1983 (art. 470-1 C.P.P.) laissait espérer que les victimes pourraient obtenir réparation du dommage subi, "en vertu des règles du droit civil", en dépit d'une relaxe par le tribunal correctionnel. Malheureusement l'effet a été peu perceptible, du fait que la jurisprudence continue à s'en tenir (depuis 1912) à la thèse de l'unité de la faute civile et de la faute pénale.
M. Akida, comme l'unanimité de la doctrine à l'heure actuelle, critique ce point de vue. La responsabilité pénale du médecin suppose une faute de celui-ci et une relation de cause à effet entre cette faute et le dommage. L'auteur examine avec soin ces deux points, analysant une jurisprudence qui conserve toute son autorité en dépit de la promulgation du nouveau code pénal. La faute peut être relevée dans l'exercice individuel de la médecine, aussi bien que dans son exercice au sein d'une équipe chirurgicale.
Le lien de causalité est conçu par la jurisprudence française sur un mode extensif. Il peut être réalisé même en cas de comportement simplement passif du médecin ; il peut exister en même temps en liaison avec d'autres fautes (imputables à d'autres membres du corps médical, à des auxiliaires médicaux, à des tiers, au malade lui-même, ou encore aux prédispositions de celui-ci). Cet ouvrage intéresse donc tous les praticiens de l'art médical, aussi bien que les juristes même non pénalistes.
M. Akida, comme l'unanimité de la doctrine à l'heure actuelle, critique ce point de vue. La responsabilité pénale du médecin suppose une faute de celui-ci et une relation de cause à effet entre cette faute et le dommage. L'auteur examine avec soin ces deux points, analysant une jurisprudence qui conserve toute son autorité en dépit de la promulgation du nouveau code pénal. La faute peut être relevée dans l'exercice individuel de la médecine, aussi bien que dans son exercice au sein d'une équipe chirurgicale.
Le lien de causalité est conçu par la jurisprudence française sur un mode extensif. Il peut être réalisé même en cas de comportement simplement passif du médecin ; il peut exister en même temps en liaison avec d'autres fautes (imputables à d'autres membres du corps médical, à des auxiliaires médicaux, à des tiers, au malade lui-même, ou encore aux prédispositions de celui-ci). Cet ouvrage intéresse donc tous les praticiens de l'art médical, aussi bien que les juristes même non pénalistes.