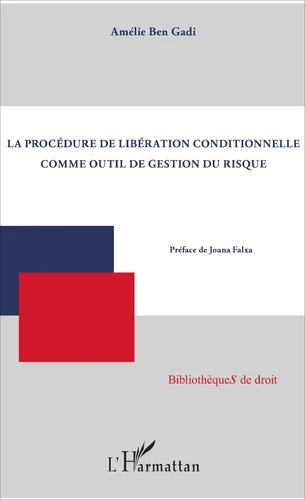La procédure de libération conditionnelle comme outil de gestion du risque
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages132
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.161 kg
- Dimensions13,0 cm × 21,0 cm × 0,5 cm
- ISBN978-2-343-11550-4
- EAN9782343115504
- Date de parution01/07/2017
- CollectionBibliothèqueS de droit
- ÉditeurL'Harmattan
- PréfacierJoana Falxa
Résumé
La procédure d'octroi de la libération conditionnelle des longues peines prévue à l'article 730-2 du Code de procédure pénale témoigne d'une sévérité accrue à leur égard. En imposant une évaluation de dangerosité, le législateur a souhaité " verrouiller " la procédure. Cependant, la notion de dangerosité est très complexe à définir et ne fait l'objet d'aucune définition légale. Elle introduit la logique de la gestion du risque, ouvrant le chemin vers une justice de précaution, révélant ainsi une subtile alliance entre le droit pénal classique et le mouvement de défense sociale nouvelle.
A ces ambiguïtés théoriques s'ajoutent les difficultés pratiques. En effet, les acteurs de l'évaluation de dangerosité mobilisent plus leurs connaissances empiriques que de réelles compétences criminologiques. De plus, leur saisine obligatoire allonge la durée de la procédure, de sorte que certains condamnés préfèrent renoncer à faire une demande de libération conditionnelle afin d'éviter les multiples étapes de la procédure.
Quoi qu'il en soit, l'avocat peut avoir un rôle essentiel, en informant et en accompagnant le condamné tout au long de la procédure, bien qu'il s'en remette nécessairement à la décision des magistrats du tribunal de l'application des peines, qui s'autonomisent dans leur prise de décision.
A ces ambiguïtés théoriques s'ajoutent les difficultés pratiques. En effet, les acteurs de l'évaluation de dangerosité mobilisent plus leurs connaissances empiriques que de réelles compétences criminologiques. De plus, leur saisine obligatoire allonge la durée de la procédure, de sorte que certains condamnés préfèrent renoncer à faire une demande de libération conditionnelle afin d'éviter les multiples étapes de la procédure.
Quoi qu'il en soit, l'avocat peut avoir un rôle essentiel, en informant et en accompagnant le condamné tout au long de la procédure, bien qu'il s'en remette nécessairement à la décision des magistrats du tribunal de l'application des peines, qui s'autonomisent dans leur prise de décision.
La procédure d'octroi de la libération conditionnelle des longues peines prévue à l'article 730-2 du Code de procédure pénale témoigne d'une sévérité accrue à leur égard. En imposant une évaluation de dangerosité, le législateur a souhaité " verrouiller " la procédure. Cependant, la notion de dangerosité est très complexe à définir et ne fait l'objet d'aucune définition légale. Elle introduit la logique de la gestion du risque, ouvrant le chemin vers une justice de précaution, révélant ainsi une subtile alliance entre le droit pénal classique et le mouvement de défense sociale nouvelle.
A ces ambiguïtés théoriques s'ajoutent les difficultés pratiques. En effet, les acteurs de l'évaluation de dangerosité mobilisent plus leurs connaissances empiriques que de réelles compétences criminologiques. De plus, leur saisine obligatoire allonge la durée de la procédure, de sorte que certains condamnés préfèrent renoncer à faire une demande de libération conditionnelle afin d'éviter les multiples étapes de la procédure.
Quoi qu'il en soit, l'avocat peut avoir un rôle essentiel, en informant et en accompagnant le condamné tout au long de la procédure, bien qu'il s'en remette nécessairement à la décision des magistrats du tribunal de l'application des peines, qui s'autonomisent dans leur prise de décision.
A ces ambiguïtés théoriques s'ajoutent les difficultés pratiques. En effet, les acteurs de l'évaluation de dangerosité mobilisent plus leurs connaissances empiriques que de réelles compétences criminologiques. De plus, leur saisine obligatoire allonge la durée de la procédure, de sorte que certains condamnés préfèrent renoncer à faire une demande de libération conditionnelle afin d'éviter les multiples étapes de la procédure.
Quoi qu'il en soit, l'avocat peut avoir un rôle essentiel, en informant et en accompagnant le condamné tout au long de la procédure, bien qu'il s'en remette nécessairement à la décision des magistrats du tribunal de l'application des peines, qui s'autonomisent dans leur prise de décision.