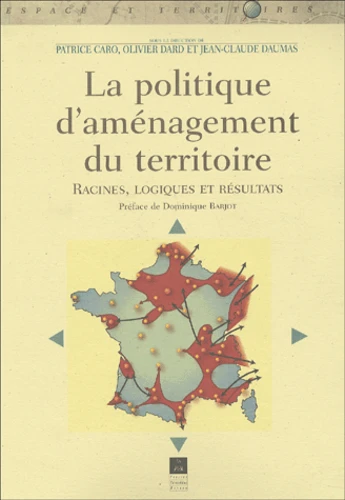La Politique D'Amenagement Du Territoire. Racines, Logiques Et Resultats
Par : , ,Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages360
- PrésentationBroché
- Poids0.67 kg
- Dimensions16,5 cm × 24,0 cm × 2,7 cm
- ISBN2-86847-664-3
- EAN9782868476647
- Date de parution01/03/2002
- ÉditeurPU Rennes
Résumé
Le présent ouvrage tiré d'un colloque tenu à Besançon en 2000, offre une lecture interdisciplinaire et comparatiste de l'histoire de l'aménagement du territoire en France. Il répond à trois grandes questions : Quelles sont les racines de cette politique ? Selon quelle logique s'est-elle construite ? Pour quels résultats, durant les "trente glorieuses" et depuis la crise des années 70 ? Il rend compte de l'épaisseur historique d'une politique qui n'est pas seulement le produit de la Reconstruction des années cinquante et d'un volontarisme étatique mais aussi le point d'aboutissement de processus (mise en réseaux) et de réflexions (sur la région, la ville ou l'Etat) qui jalonnent l'histoire de la France depuis la fin du XIXe siècle.
Grande affaire des années de croissance, l'aménagement du territoire n'a pas géré avec le même bonheur les conséquences de la crise et de la désindustrialisation. Echec d'une politique ? Mutation des mentalités ? L'ouvrage dresse un bilan suggestif des politiques de reconversions industrielles. Il s'interroge aussi sur l'avenir de l'aménagement du territoire à l'heure où l'Etat-nation est remis en cause par la région, l'Europe et la mondialisation.
Si les décennies récentes ont mis à mal un type d'aménagement du territoire impulsé par un Etat centralisateur, le XXIe siècle naissant ne favorisera t-il pas, en France comme dans d'autres pays européens, un aménagement privilégiant les initiatives locales ? A l'heure où la confiance dans l'Etat est effritée et où le local est sacralisé, c'est là un des scénarios du possible, mais comme les premières tentatives pour le concrétiser le montrent, il n'est nullement dépourvu d'effets pervers.
Grande affaire des années de croissance, l'aménagement du territoire n'a pas géré avec le même bonheur les conséquences de la crise et de la désindustrialisation. Echec d'une politique ? Mutation des mentalités ? L'ouvrage dresse un bilan suggestif des politiques de reconversions industrielles. Il s'interroge aussi sur l'avenir de l'aménagement du territoire à l'heure où l'Etat-nation est remis en cause par la région, l'Europe et la mondialisation.
Si les décennies récentes ont mis à mal un type d'aménagement du territoire impulsé par un Etat centralisateur, le XXIe siècle naissant ne favorisera t-il pas, en France comme dans d'autres pays européens, un aménagement privilégiant les initiatives locales ? A l'heure où la confiance dans l'Etat est effritée et où le local est sacralisé, c'est là un des scénarios du possible, mais comme les premières tentatives pour le concrétiser le montrent, il n'est nullement dépourvu d'effets pervers.
Le présent ouvrage tiré d'un colloque tenu à Besançon en 2000, offre une lecture interdisciplinaire et comparatiste de l'histoire de l'aménagement du territoire en France. Il répond à trois grandes questions : Quelles sont les racines de cette politique ? Selon quelle logique s'est-elle construite ? Pour quels résultats, durant les "trente glorieuses" et depuis la crise des années 70 ? Il rend compte de l'épaisseur historique d'une politique qui n'est pas seulement le produit de la Reconstruction des années cinquante et d'un volontarisme étatique mais aussi le point d'aboutissement de processus (mise en réseaux) et de réflexions (sur la région, la ville ou l'Etat) qui jalonnent l'histoire de la France depuis la fin du XIXe siècle.
Grande affaire des années de croissance, l'aménagement du territoire n'a pas géré avec le même bonheur les conséquences de la crise et de la désindustrialisation. Echec d'une politique ? Mutation des mentalités ? L'ouvrage dresse un bilan suggestif des politiques de reconversions industrielles. Il s'interroge aussi sur l'avenir de l'aménagement du territoire à l'heure où l'Etat-nation est remis en cause par la région, l'Europe et la mondialisation.
Si les décennies récentes ont mis à mal un type d'aménagement du territoire impulsé par un Etat centralisateur, le XXIe siècle naissant ne favorisera t-il pas, en France comme dans d'autres pays européens, un aménagement privilégiant les initiatives locales ? A l'heure où la confiance dans l'Etat est effritée et où le local est sacralisé, c'est là un des scénarios du possible, mais comme les premières tentatives pour le concrétiser le montrent, il n'est nullement dépourvu d'effets pervers.
Grande affaire des années de croissance, l'aménagement du territoire n'a pas géré avec le même bonheur les conséquences de la crise et de la désindustrialisation. Echec d'une politique ? Mutation des mentalités ? L'ouvrage dresse un bilan suggestif des politiques de reconversions industrielles. Il s'interroge aussi sur l'avenir de l'aménagement du territoire à l'heure où l'Etat-nation est remis en cause par la région, l'Europe et la mondialisation.
Si les décennies récentes ont mis à mal un type d'aménagement du territoire impulsé par un Etat centralisateur, le XXIe siècle naissant ne favorisera t-il pas, en France comme dans d'autres pays européens, un aménagement privilégiant les initiatives locales ? A l'heure où la confiance dans l'Etat est effritée et où le local est sacralisé, c'est là un des scénarios du possible, mais comme les premières tentatives pour le concrétiser le montrent, il n'est nullement dépourvu d'effets pervers.