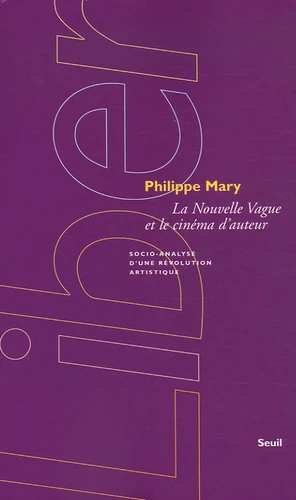La Nouvelle Vague et le cinéma d'auteur. Socio-analyse d'une révolution artistique
Par :Formats :
Actuellement indisponible
Cet article est actuellement indisponible, il ne peut pas être commandé sur notre site pour le moment. Nous vous invitons à vous inscrire à l'alerte disponibilité, vous recevrez un e-mail dès que cet ouvrage sera à nouveau disponible.
- Nombre de pages211
- PrésentationBroché
- Poids0.285 kg
- Dimensions13,0 cm × 21,5 cm × 1,5 cm
- ISBN2-02-088167-5
- EAN9782020881678
- Date de parution04/05/2006
- CollectionLiber
- ÉditeurSeuil
Résumé
De Truffaut à Godard ou Resnais, de Chabrol à Rivette ou Varda, le " jeune cinéma " de la Nouvelle Vague marque, au début des années 1960, un tournant. Au cinéma de la Qualité, celui de Carné et Prévert, de Gabin et Jouvet, des maîtres du décor et de la lumière, des " professionnels de la profession ", se substitue un " cinéma d'auteur ", libéré de son carcan technicien, indépendant des impératifs économiques et du vedettariat et capable de " confronter ", selon le mot de Godard, " des idées vagues avec des images claires ". L'ambition de ce livre est de proposer une socio-analyse de cette " révolution artistique " : cerner les règles professionnelles, les hiérarchies sociales ou les tendances de la critique qui caractérisent le cinéma français ; retracer les histoires singulières, familiales, scolaires et intellectuelles qui définissent les valeurs esthétiques, éthiques et politiques de ceux qui prennent part à cet événement ; comprendre les films comme la rencontre entre ce " microcosme " et ces " cosmologies culturelles ".
De Truffaut à Godard ou Resnais, de Chabrol à Rivette ou Varda, le " jeune cinéma " de la Nouvelle Vague marque, au début des années 1960, un tournant. Au cinéma de la Qualité, celui de Carné et Prévert, de Gabin et Jouvet, des maîtres du décor et de la lumière, des " professionnels de la profession ", se substitue un " cinéma d'auteur ", libéré de son carcan technicien, indépendant des impératifs économiques et du vedettariat et capable de " confronter ", selon le mot de Godard, " des idées vagues avec des images claires ". L'ambition de ce livre est de proposer une socio-analyse de cette " révolution artistique " : cerner les règles professionnelles, les hiérarchies sociales ou les tendances de la critique qui caractérisent le cinéma français ; retracer les histoires singulières, familiales, scolaires et intellectuelles qui définissent les valeurs esthétiques, éthiques et politiques de ceux qui prennent part à cet événement ; comprendre les films comme la rencontre entre ce " microcosme " et ces " cosmologies culturelles ".