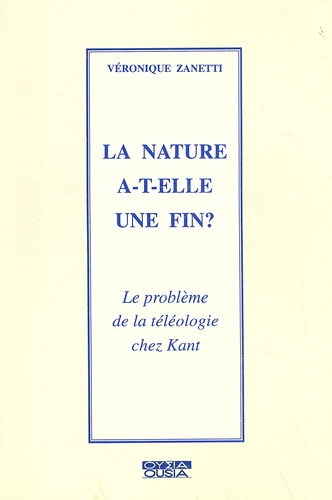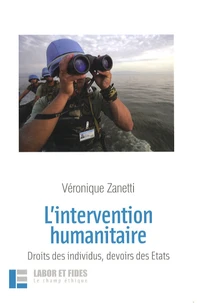La nature a-t-elle une fin ?. Le problème de la téléologie chez Kant
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages296
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.445 kg
- Dimensions21,0 cm × 21,0 cm × 1,8 cm
- ISBN2-87060-045-3
- EAN9782870600450
- Date de parution27/02/1995
- ÉditeurOusia (editions)
Résumé
La Critique de la faculté de juger téléologi-que cherche à déterminer les conditions de possibilité de connaissance de la nature empirique, à expliquer comment les organismes peuvent être pensés comme produits naturels et, enfin, à trouver un lien entre la philosophie théorique et la philosophie pratique, c'est-à-dire entre la thèse du déterminisme naturel et celle de la liberté. Kant mène de front ces trois enjeux qu'il souhaite concilier à l'aide d'un seul et même principe, celui de la téléologie de la nature.
Partant de cette constatation, l'auteur déga- . ge les différentes fonctions flu principe téléologique et examine ses diverses applications dans le système critique kantien. Il distingue l'usage théorique de ce principe où son statut est comparable à celui des catégories et son usage pratique. La troisième Critique a pour tâche de sauver le système de "l'incommensurable ábime" qui en menace la cohérence.
Or, comment soutenir qu'une nature déterminée produit des êtres libres ? Et comment la réalisation de l'impératif catégorique est-elle conciliable avec le déterminisme physique ? L'idée de finalité permet précisément de penser un lieu de rencontre possible entre l'histoire de l'évolution naturelle et l'histoire des actions humaines. Mais en revêtant une fonction pratique, le principe téléologique perd son statut strictement régulateur : alors que le jugement réfléchissant ne peut conclure qu'à la possibilité d'une cause finale dans la nature, la raison pratique juge de la nécessité d'une cause finale supra-naturelle.
Cette solution réintroduit le couple théorie-pratique et le clivage de leur législation. Dès lors on peut mettre en doute que le principe téléologique ait comblé le fossé du dualisme. L'auteur est assistante docteur de philosophie à l'université de Fribourg en Suisse.
Partant de cette constatation, l'auteur déga- . ge les différentes fonctions flu principe téléologique et examine ses diverses applications dans le système critique kantien. Il distingue l'usage théorique de ce principe où son statut est comparable à celui des catégories et son usage pratique. La troisième Critique a pour tâche de sauver le système de "l'incommensurable ábime" qui en menace la cohérence.
Or, comment soutenir qu'une nature déterminée produit des êtres libres ? Et comment la réalisation de l'impératif catégorique est-elle conciliable avec le déterminisme physique ? L'idée de finalité permet précisément de penser un lieu de rencontre possible entre l'histoire de l'évolution naturelle et l'histoire des actions humaines. Mais en revêtant une fonction pratique, le principe téléologique perd son statut strictement régulateur : alors que le jugement réfléchissant ne peut conclure qu'à la possibilité d'une cause finale dans la nature, la raison pratique juge de la nécessité d'une cause finale supra-naturelle.
Cette solution réintroduit le couple théorie-pratique et le clivage de leur législation. Dès lors on peut mettre en doute que le principe téléologique ait comblé le fossé du dualisme. L'auteur est assistante docteur de philosophie à l'université de Fribourg en Suisse.
La Critique de la faculté de juger téléologi-que cherche à déterminer les conditions de possibilité de connaissance de la nature empirique, à expliquer comment les organismes peuvent être pensés comme produits naturels et, enfin, à trouver un lien entre la philosophie théorique et la philosophie pratique, c'est-à-dire entre la thèse du déterminisme naturel et celle de la liberté. Kant mène de front ces trois enjeux qu'il souhaite concilier à l'aide d'un seul et même principe, celui de la téléologie de la nature.
Partant de cette constatation, l'auteur déga- . ge les différentes fonctions flu principe téléologique et examine ses diverses applications dans le système critique kantien. Il distingue l'usage théorique de ce principe où son statut est comparable à celui des catégories et son usage pratique. La troisième Critique a pour tâche de sauver le système de "l'incommensurable ábime" qui en menace la cohérence.
Or, comment soutenir qu'une nature déterminée produit des êtres libres ? Et comment la réalisation de l'impératif catégorique est-elle conciliable avec le déterminisme physique ? L'idée de finalité permet précisément de penser un lieu de rencontre possible entre l'histoire de l'évolution naturelle et l'histoire des actions humaines. Mais en revêtant une fonction pratique, le principe téléologique perd son statut strictement régulateur : alors que le jugement réfléchissant ne peut conclure qu'à la possibilité d'une cause finale dans la nature, la raison pratique juge de la nécessité d'une cause finale supra-naturelle.
Cette solution réintroduit le couple théorie-pratique et le clivage de leur législation. Dès lors on peut mettre en doute que le principe téléologique ait comblé le fossé du dualisme. L'auteur est assistante docteur de philosophie à l'université de Fribourg en Suisse.
Partant de cette constatation, l'auteur déga- . ge les différentes fonctions flu principe téléologique et examine ses diverses applications dans le système critique kantien. Il distingue l'usage théorique de ce principe où son statut est comparable à celui des catégories et son usage pratique. La troisième Critique a pour tâche de sauver le système de "l'incommensurable ábime" qui en menace la cohérence.
Or, comment soutenir qu'une nature déterminée produit des êtres libres ? Et comment la réalisation de l'impératif catégorique est-elle conciliable avec le déterminisme physique ? L'idée de finalité permet précisément de penser un lieu de rencontre possible entre l'histoire de l'évolution naturelle et l'histoire des actions humaines. Mais en revêtant une fonction pratique, le principe téléologique perd son statut strictement régulateur : alors que le jugement réfléchissant ne peut conclure qu'à la possibilité d'une cause finale dans la nature, la raison pratique juge de la nécessité d'une cause finale supra-naturelle.
Cette solution réintroduit le couple théorie-pratique et le clivage de leur législation. Dès lors on peut mettre en doute que le principe téléologique ait comblé le fossé du dualisme. L'auteur est assistante docteur de philosophie à l'université de Fribourg en Suisse.