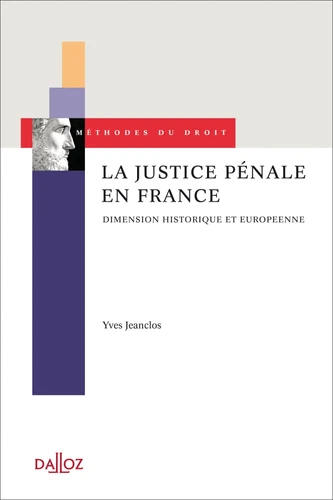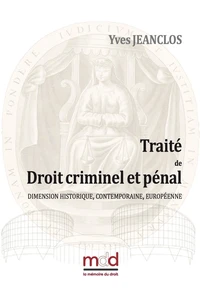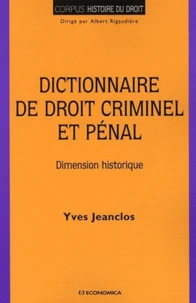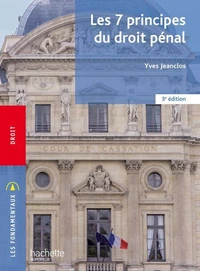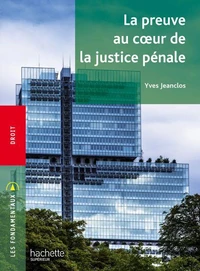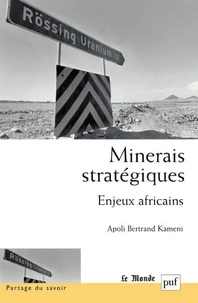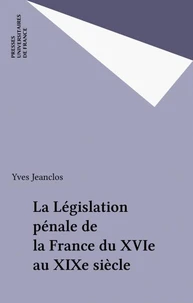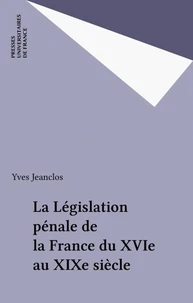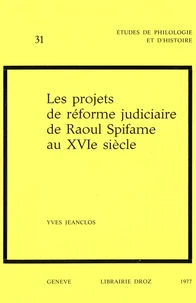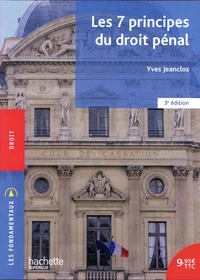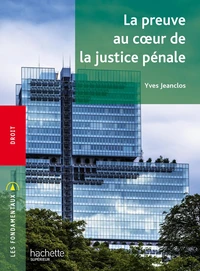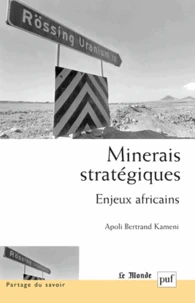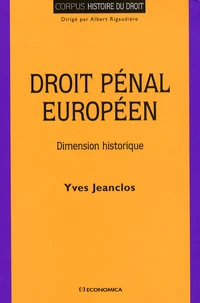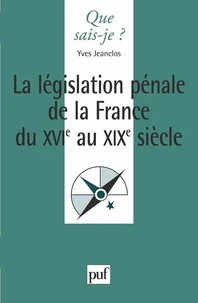La justice pénale en France. Dimension historique et européenne
Edition 2011
Par : Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages225
- PrésentationBroché
- Poids0.412 kg
- Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 1,5 cm
- ISBN978-2-247-10525-0
- EAN9782247105250
- Date de parution23/03/2011
- CollectionMéthodes du droit
- ÉditeurDalloz
Résumé
Actuellement, la justice pénale en France a de plus en plus la mission idéaliste de guérir et de moins en moins celle réaliste de sévir. Le législateur s'efforce de maintenir le condamné dans la société par des peines de substitution, prescrit parfois un suivi psychologique et des soins médicaux et incite les juges à contractualiser les peines plutôt qu'à les imposer. En contrepoint, la justice criminelle du 16° au 20° siècle, héritière des droits de l'Antiquité et du Moyen-Age en France comme ailleurs en Europe avait édicté des peines corporelles atroces et infamantes appliquées de façon exemplaire pour sanctionner et dissuader ; puis progressivement elles avaient été adoucies et proportionnalisées à l'infraction. Cette justice aspirait à rétablir un équilibre sociétal rompu par les auteurs des crimes ou délits au détriment des victimes. En ce début du 21° siècle, la justice pénale en France est confrontée à une évolution sans précédent des moeurs et des technologies qui l'a poussée à s'orienter dans deux directions principales : la lutte contre la petite délinquance en développement constant et la répression contre la criminalité internationale organisée de nature économique (mafias) et/ou politique (terrorisme et crimes contre l'humanité). Cette justice pénale en mutation traversée par les règles de droit de l'Union européenne devient finalement un vecteur d'intégration pacifique pour une Europe de sécurité de liberté et de justice.
Actuellement, la justice pénale en France a de plus en plus la mission idéaliste de guérir et de moins en moins celle réaliste de sévir. Le législateur s'efforce de maintenir le condamné dans la société par des peines de substitution, prescrit parfois un suivi psychologique et des soins médicaux et incite les juges à contractualiser les peines plutôt qu'à les imposer. En contrepoint, la justice criminelle du 16° au 20° siècle, héritière des droits de l'Antiquité et du Moyen-Age en France comme ailleurs en Europe avait édicté des peines corporelles atroces et infamantes appliquées de façon exemplaire pour sanctionner et dissuader ; puis progressivement elles avaient été adoucies et proportionnalisées à l'infraction. Cette justice aspirait à rétablir un équilibre sociétal rompu par les auteurs des crimes ou délits au détriment des victimes. En ce début du 21° siècle, la justice pénale en France est confrontée à une évolution sans précédent des moeurs et des technologies qui l'a poussée à s'orienter dans deux directions principales : la lutte contre la petite délinquance en développement constant et la répression contre la criminalité internationale organisée de nature économique (mafias) et/ou politique (terrorisme et crimes contre l'humanité). Cette justice pénale en mutation traversée par les règles de droit de l'Union européenne devient finalement un vecteur d'intégration pacifique pour une Europe de sécurité de liberté et de justice.