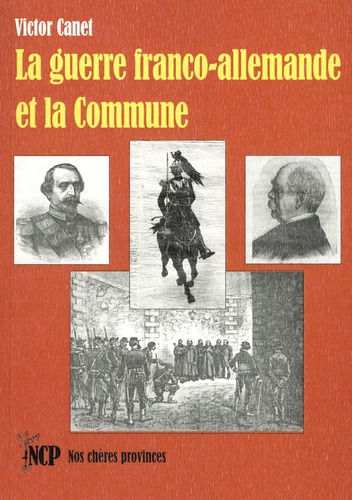La guerre franco - allemande et la Commune
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 24 décembreCet article sera commandé chez un fournisseur et vous sera envoyé 28 jours après la date de votre commande.
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 24 décembre
- Nombre de pages150
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.225 kg
- Dimensions15,0 cm × 21,1 cm × 0,9 cm
- ISBN978-2-493454-21-8
- EAN9782493454218
- Date de parution01/11/2024
- CollectionHistoire d'Europe
- ÉditeurNos chères provinces
Résumé
La guerre franco-allemande de 1870 à 1871 (appelée également guerre franco-prussienne) est, selon le chancelier Otto von Bismarck une réponse de la Prusse à sa défaite d'Iéna en 1806. En 1870, l'empereur Napoleon III déclare la guerre à la Prusse, malgré l'impréparation de l'état-major et des combattants français ainsi que leur nombre bien inférieur à celui des guerriers prussiens. Les batailles et la défaite sont rudes pour les Français et l'empereur Napoleon III capitule le 2 septembre 1870.
La capitulation sonne le glas du regime imperial français. La République est proclamée. Pourtant les combats contre les Prussiens se poursuivent. Ces derniers renforcent leur emprise sur la France, assistant, de pas très loin, à la guerre civile de la Commune de Paris. La concomitance des événements ne peut qu'affaiblir la France et précipiter la perte des territoires de l'Alsace et de la Moselle.
Comment ne pas s'indigner devant un va-t'en-guerre (qui s'ignorait certainement), assuré de sa putative pleine puissance, orgueilleux, tournant ses attentions vers l'extérieur, alors que son pays prenait son essor et avait besoin de paix pour consolider ses bases de développement. Comment ne pas s'indigner de ces politiciens français qui ont surfé sur la faiblesse de l'Etat pour livrer la France à l'insurrection, pour tenter le putsch, alors qu'il aurait certainement fallu resserrer les rangs pour ne pas en rajouter...
Comme un train peut en cacher un autre, une guerre peut en cacher une autre. La frustration, la revanche... On le sait, l'histoire à tendance à bégayer.
La capitulation sonne le glas du regime imperial français. La République est proclamée. Pourtant les combats contre les Prussiens se poursuivent. Ces derniers renforcent leur emprise sur la France, assistant, de pas très loin, à la guerre civile de la Commune de Paris. La concomitance des événements ne peut qu'affaiblir la France et précipiter la perte des territoires de l'Alsace et de la Moselle.
Comment ne pas s'indigner devant un va-t'en-guerre (qui s'ignorait certainement), assuré de sa putative pleine puissance, orgueilleux, tournant ses attentions vers l'extérieur, alors que son pays prenait son essor et avait besoin de paix pour consolider ses bases de développement. Comment ne pas s'indigner de ces politiciens français qui ont surfé sur la faiblesse de l'Etat pour livrer la France à l'insurrection, pour tenter le putsch, alors qu'il aurait certainement fallu resserrer les rangs pour ne pas en rajouter...
Comme un train peut en cacher un autre, une guerre peut en cacher une autre. La frustration, la revanche... On le sait, l'histoire à tendance à bégayer.
La guerre franco-allemande de 1870 à 1871 (appelée également guerre franco-prussienne) est, selon le chancelier Otto von Bismarck une réponse de la Prusse à sa défaite d'Iéna en 1806. En 1870, l'empereur Napoleon III déclare la guerre à la Prusse, malgré l'impréparation de l'état-major et des combattants français ainsi que leur nombre bien inférieur à celui des guerriers prussiens. Les batailles et la défaite sont rudes pour les Français et l'empereur Napoleon III capitule le 2 septembre 1870.
La capitulation sonne le glas du regime imperial français. La République est proclamée. Pourtant les combats contre les Prussiens se poursuivent. Ces derniers renforcent leur emprise sur la France, assistant, de pas très loin, à la guerre civile de la Commune de Paris. La concomitance des événements ne peut qu'affaiblir la France et précipiter la perte des territoires de l'Alsace et de la Moselle.
Comment ne pas s'indigner devant un va-t'en-guerre (qui s'ignorait certainement), assuré de sa putative pleine puissance, orgueilleux, tournant ses attentions vers l'extérieur, alors que son pays prenait son essor et avait besoin de paix pour consolider ses bases de développement. Comment ne pas s'indigner de ces politiciens français qui ont surfé sur la faiblesse de l'Etat pour livrer la France à l'insurrection, pour tenter le putsch, alors qu'il aurait certainement fallu resserrer les rangs pour ne pas en rajouter...
Comme un train peut en cacher un autre, une guerre peut en cacher une autre. La frustration, la revanche... On le sait, l'histoire à tendance à bégayer.
La capitulation sonne le glas du regime imperial français. La République est proclamée. Pourtant les combats contre les Prussiens se poursuivent. Ces derniers renforcent leur emprise sur la France, assistant, de pas très loin, à la guerre civile de la Commune de Paris. La concomitance des événements ne peut qu'affaiblir la France et précipiter la perte des territoires de l'Alsace et de la Moselle.
Comment ne pas s'indigner devant un va-t'en-guerre (qui s'ignorait certainement), assuré de sa putative pleine puissance, orgueilleux, tournant ses attentions vers l'extérieur, alors que son pays prenait son essor et avait besoin de paix pour consolider ses bases de développement. Comment ne pas s'indigner de ces politiciens français qui ont surfé sur la faiblesse de l'Etat pour livrer la France à l'insurrection, pour tenter le putsch, alors qu'il aurait certainement fallu resserrer les rangs pour ne pas en rajouter...
Comme un train peut en cacher un autre, une guerre peut en cacher une autre. La frustration, la revanche... On le sait, l'histoire à tendance à bégayer.