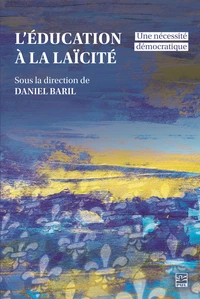Le début du 20e siècle nous avait annoncé la disparition imminente de ce que Marx avait appelé " l'opium du peuple " et Freud " la névrose de l'humanité ". La fin du siècle nous a plutôt montré qu'après un déclin relatif la religion a repris de la vigueur. Comment expliquer cette persistance du religieux ? Comment expliquer l'universalité de ce que nous appelons " religion " et qui s'observe à toutes les époques, dans toutes les régions du monde, dans toutes les cultures et dans toutes les sociétés humaines, du Paléolithique jusqu'à l'ère spatiale ? Comment expliquer ce besoin apparemment irrépressible qu'a le primate humain de créer du surnaturel ? Ce livre propose de nouvelles réponses à ces questions éternelles en recourant à la théorie de l'évolution.
En se référant aux avantages adaptatifs liés à l'appartenance religieuse, à la morale sociale, au comportement ritualiste et à la croyance au surnaturel, l'interprétation développée dans cet essai conduit à considérer le religieux comme un phénomène dérivé des mécanismes cognitifs nécessaires à la vie sociale. De la neurothéologie à la " religion du chimpanzé " en passant par les différences entre hommes et femmes, l'auteur explique en termes clairs et vulgarisés les fondements biologiques du sentiment d'appartenance, du geste rituel, de l'altruisme et de notre " irrépressible " anthropomorphisme.
Le début du 20e siècle nous avait annoncé la disparition imminente de ce que Marx avait appelé " l'opium du peuple " et Freud " la névrose de l'humanité ". La fin du siècle nous a plutôt montré qu'après un déclin relatif la religion a repris de la vigueur. Comment expliquer cette persistance du religieux ? Comment expliquer l'universalité de ce que nous appelons " religion " et qui s'observe à toutes les époques, dans toutes les régions du monde, dans toutes les cultures et dans toutes les sociétés humaines, du Paléolithique jusqu'à l'ère spatiale ? Comment expliquer ce besoin apparemment irrépressible qu'a le primate humain de créer du surnaturel ? Ce livre propose de nouvelles réponses à ces questions éternelles en recourant à la théorie de l'évolution.
En se référant aux avantages adaptatifs liés à l'appartenance religieuse, à la morale sociale, au comportement ritualiste et à la croyance au surnaturel, l'interprétation développée dans cet essai conduit à considérer le religieux comme un phénomène dérivé des mécanismes cognitifs nécessaires à la vie sociale. De la neurothéologie à la " religion du chimpanzé " en passant par les différences entre hommes et femmes, l'auteur explique en termes clairs et vulgarisés les fondements biologiques du sentiment d'appartenance, du geste rituel, de l'altruisme et de notre " irrépressible " anthropomorphisme.