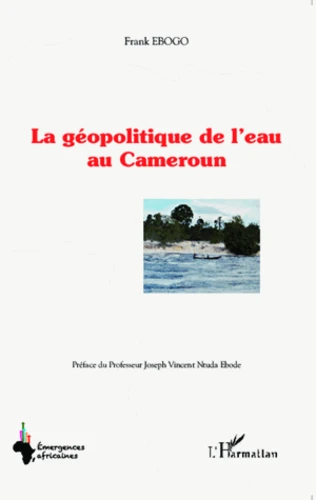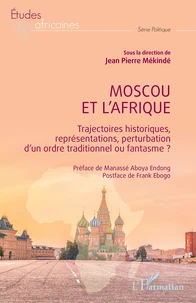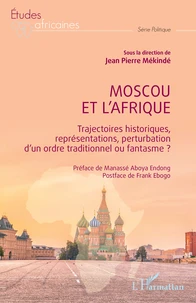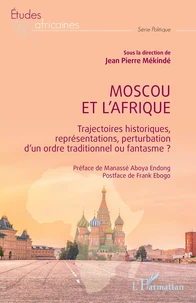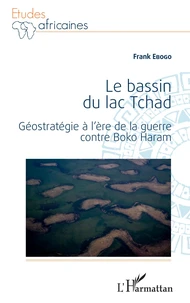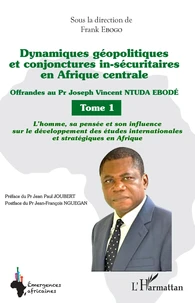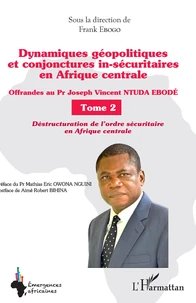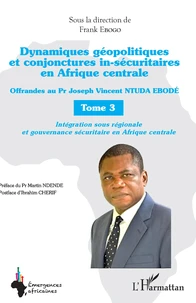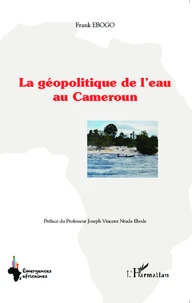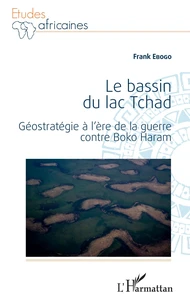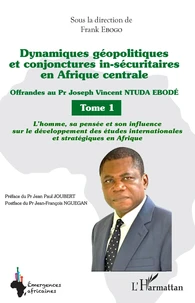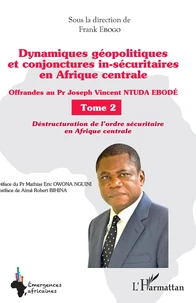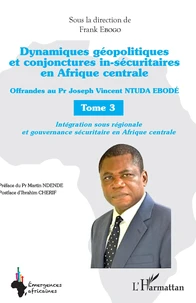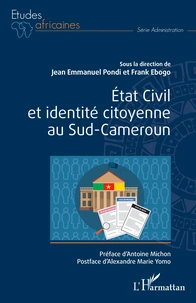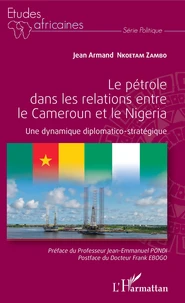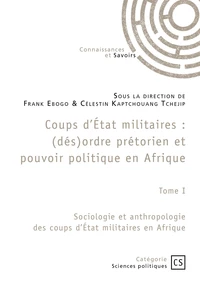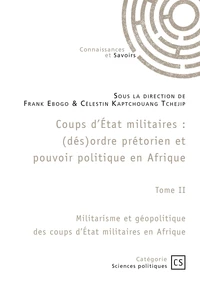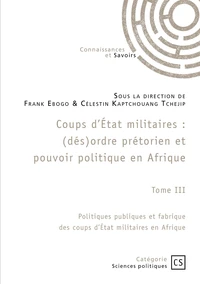La géopolitique de l'eau au Cameroun
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages459
- PrésentationBroché
- Poids0.73 kg
- Dimensions15,5 cm × 24,0 cm × 2,4 cm
- ISBN978-2-343-04783-6
- EAN9782343047836
- Date de parution15/01/2015
- CollectionEmergences africaines
- ÉditeurL'Harmattan
- PréfacierJoseph Vincent Ntuda Ebodé
Résumé
La problématique actuelle des changements climatiques a précipité l'insertion et l'inscription de l'eau dans l'agenda politique national et international des Etats. Partout, la communauté internationale se mobilise tantôt pour un meilleur accès des usagers à une eau inégalement répartie, tantôt pour une gestion rationnelle d'une ressource devenue de plus en plus stratégique. En tant que deuxième province hydrologique et aquifère du continent africain, le Cameroun est au coeur des batailles de positionnement entre les différents acteurs intervenant dans son champ hydropolitique.
Pour mieux appréhender la géopolitique de l'eau au Cameroun, il faut sans doute opérer une double rupture épistémologique. Par conséquent, cette étude se donne pour ambition de dépasser, d'une part, le pessimisme affiché par les penseurs réalistes et néo-malthusiens dont les travaux ont surtout montré que l'eau est intrinsèquement un facteur de conflictualité ; d'autre part, l'idéalisme triomphant des analyses libérales et néolibérales qui consacre la coopération interétatique autour des ressources hydriques partagées.
Il est donc question de déconstruire ces modèles figés et fixistes qui ont été faits sur l'eau pour parvenir à une reconstruction des différents modes de gestion de l'eau, en fonction des représentations subjectives et intersubjectives des acteurs.
Pour mieux appréhender la géopolitique de l'eau au Cameroun, il faut sans doute opérer une double rupture épistémologique. Par conséquent, cette étude se donne pour ambition de dépasser, d'une part, le pessimisme affiché par les penseurs réalistes et néo-malthusiens dont les travaux ont surtout montré que l'eau est intrinsèquement un facteur de conflictualité ; d'autre part, l'idéalisme triomphant des analyses libérales et néolibérales qui consacre la coopération interétatique autour des ressources hydriques partagées.
Il est donc question de déconstruire ces modèles figés et fixistes qui ont été faits sur l'eau pour parvenir à une reconstruction des différents modes de gestion de l'eau, en fonction des représentations subjectives et intersubjectives des acteurs.
La problématique actuelle des changements climatiques a précipité l'insertion et l'inscription de l'eau dans l'agenda politique national et international des Etats. Partout, la communauté internationale se mobilise tantôt pour un meilleur accès des usagers à une eau inégalement répartie, tantôt pour une gestion rationnelle d'une ressource devenue de plus en plus stratégique. En tant que deuxième province hydrologique et aquifère du continent africain, le Cameroun est au coeur des batailles de positionnement entre les différents acteurs intervenant dans son champ hydropolitique.
Pour mieux appréhender la géopolitique de l'eau au Cameroun, il faut sans doute opérer une double rupture épistémologique. Par conséquent, cette étude se donne pour ambition de dépasser, d'une part, le pessimisme affiché par les penseurs réalistes et néo-malthusiens dont les travaux ont surtout montré que l'eau est intrinsèquement un facteur de conflictualité ; d'autre part, l'idéalisme triomphant des analyses libérales et néolibérales qui consacre la coopération interétatique autour des ressources hydriques partagées.
Il est donc question de déconstruire ces modèles figés et fixistes qui ont été faits sur l'eau pour parvenir à une reconstruction des différents modes de gestion de l'eau, en fonction des représentations subjectives et intersubjectives des acteurs.
Pour mieux appréhender la géopolitique de l'eau au Cameroun, il faut sans doute opérer une double rupture épistémologique. Par conséquent, cette étude se donne pour ambition de dépasser, d'une part, le pessimisme affiché par les penseurs réalistes et néo-malthusiens dont les travaux ont surtout montré que l'eau est intrinsèquement un facteur de conflictualité ; d'autre part, l'idéalisme triomphant des analyses libérales et néolibérales qui consacre la coopération interétatique autour des ressources hydriques partagées.
Il est donc question de déconstruire ces modèles figés et fixistes qui ont été faits sur l'eau pour parvenir à une reconstruction des différents modes de gestion de l'eau, en fonction des représentations subjectives et intersubjectives des acteurs.