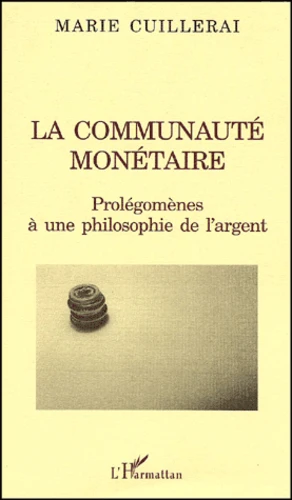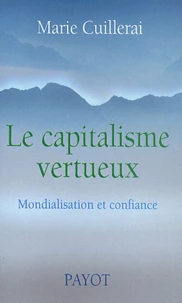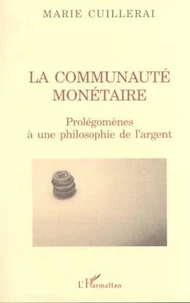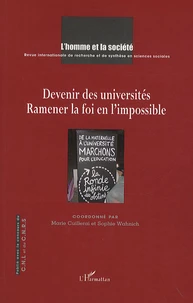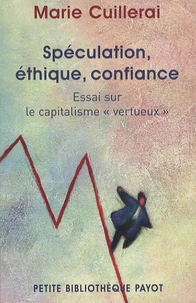LA communauté monétaire.. Prolégomènes à une philosophie de l'argent
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages3550
- PrésentationBroché
- Poids0.495 kg
- Dimensions13,6 cm × 21,5 cm × 2,6 cm
- ISBN2-7475-0325-9
- EAN9782747503259
- Date de parution01/02/2001
- CollectionLa philosophie en commun
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
L'argent ferait-il le bonheur ? Nouvelle économie, fonds éthiques, investissements socialement responsables vont-ils construire une planète plus humaine et plus juste ? L'interrogation sur le pouvoir de l'argent n'a pas toujours été délaissée par l'investigation philosophique. Reprenant la tradition depuis Aristote, ce livre interroge des œuvres qui ont conçu la monnaie comme une force communautaire et consensuelle. Pourquoi des agents acceptent-ils de la monnaie, sachant que sa valeur ne résulte d'aucune qualité intrinsèque depuis la disparition de la convertibilité-or ? Le fondement objectif de la valeur de la monnaie disparaît avec son référant métallique. La valeur repose donc sur l'acceptation dont jouit la monnaie au sein d'une collectivité. Comment se forme un tel consensus ? Faut-il le chercher dans des processus intersubjectifs ? L'hypothèse de cet ouvrage est que la monnaie est un consensus matérialisé. Mais quel est l'objet de ce consensus ? Comment définir une telle collectivité ? D'une réalité ambivalente, tantôt arme de la souveraineté qui la définit, tantôt dépendante des agents qui-en usent, parfois contre les Etats, la monnaie force à repenser les liens entre une communauté politique et une communauté économique. Ces deux entités peuvent-elles se concevoir distinctement si la monnaie est foncièrement communautaire ?
L'argent ferait-il le bonheur ? Nouvelle économie, fonds éthiques, investissements socialement responsables vont-ils construire une planète plus humaine et plus juste ? L'interrogation sur le pouvoir de l'argent n'a pas toujours été délaissée par l'investigation philosophique. Reprenant la tradition depuis Aristote, ce livre interroge des œuvres qui ont conçu la monnaie comme une force communautaire et consensuelle. Pourquoi des agents acceptent-ils de la monnaie, sachant que sa valeur ne résulte d'aucune qualité intrinsèque depuis la disparition de la convertibilité-or ? Le fondement objectif de la valeur de la monnaie disparaît avec son référant métallique. La valeur repose donc sur l'acceptation dont jouit la monnaie au sein d'une collectivité. Comment se forme un tel consensus ? Faut-il le chercher dans des processus intersubjectifs ? L'hypothèse de cet ouvrage est que la monnaie est un consensus matérialisé. Mais quel est l'objet de ce consensus ? Comment définir une telle collectivité ? D'une réalité ambivalente, tantôt arme de la souveraineté qui la définit, tantôt dépendante des agents qui-en usent, parfois contre les Etats, la monnaie force à repenser les liens entre une communauté politique et une communauté économique. Ces deux entités peuvent-elles se concevoir distinctement si la monnaie est foncièrement communautaire ?