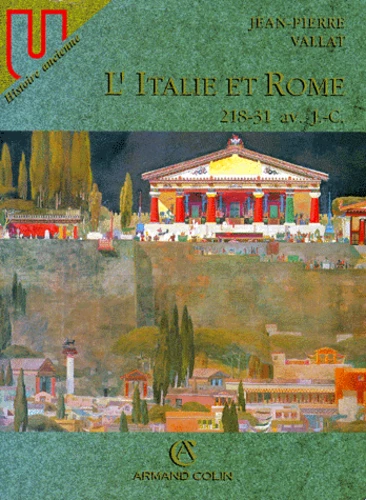L'ITALIE ET ROME.. 218-31 av. J.C.
Par :Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages258
- PrésentationBroché
- Poids0.44 kg
- Dimensions17,0 cm × 23,0 cm × 2,0 cm
- ISBN2-200-21530-4
- EAN9782200215309
- Date de parution01/05/1999
- CollectionU
- ÉditeurArmand Colin
Résumé
Qu'est-ce que Rome lorsque, les guerres puniques terminées, elle maîtrise militairement l'Italie, la Cisalpine, et les îles environnantes ? Qu'est-ce que l'Italie ? Si romancier veut dire imposer à un monde hostile ou consentant une forme de domination d'un type nouveau et spécifique, alors nous pourrions dire, un peu par provocation, qu'il n'y a jamais eu de romanisation. Car Rome n'est plus dans Rome depuis longtemps. Cité sabine, latine, étrusque, grecque, ouverte aux contacts avec les puniques, la Rome des années 200 a subi, accepté, rejeté, connu, toutes les influences de la Méditerranée. C'est donc en tenant compte de la multiplicité des substrats que Rome rencontre en Italie, qu'il faut envisager sa domination sur la péninsule.
Insister sur l'unité et la diversité de la péninsule Italienne à la fin de la République, c'est chercher à comprendre une emprise complexe de Rome. La violence de la conquête est une romanisation forcée : l'idéologie en est un élément essentiel car chaque peuple italien a sa propre vision de l'autre. Quel est dans ce processus, le rôle et la place respectifs des institutions centrales de Rome, des institutions locales romaines, des institutions " en voie de romanisation " et des institutions locales indigènes ? Charges et devoirs sont au cœur du processus d'intégration progressive à la citoyenneté romaine. La société romaine est à la fois cloisonnée, segmentaire, hiérarchisée et extrêmement fluide, ouverte à l'ascension sociale, au changement de statuts. Elle intègre et repousse, favorise ou empêche, de par sa structure même, les évolutions dues aux crises.
L'économie participe aussi à cette intégration selon la participation des individus ou groupes à des degrés divers au marché, à la diffusion de la monnaie, à la ville ou à l'autoconsommation. Enfin l'art, la religion, la culture sont autant de formes et de moyens de participation ou de rejet du monde romain. L'espace civique, architectural, spectaculaire fait de la ville un modèle visuel palpable de formes multiples de la romanisation.
Qu'est-ce que Rome lorsque, les guerres puniques terminées, elle maîtrise militairement l'Italie, la Cisalpine, et les îles environnantes ? Qu'est-ce que l'Italie ? Si romancier veut dire imposer à un monde hostile ou consentant une forme de domination d'un type nouveau et spécifique, alors nous pourrions dire, un peu par provocation, qu'il n'y a jamais eu de romanisation. Car Rome n'est plus dans Rome depuis longtemps. Cité sabine, latine, étrusque, grecque, ouverte aux contacts avec les puniques, la Rome des années 200 a subi, accepté, rejeté, connu, toutes les influences de la Méditerranée. C'est donc en tenant compte de la multiplicité des substrats que Rome rencontre en Italie, qu'il faut envisager sa domination sur la péninsule.
Insister sur l'unité et la diversité de la péninsule Italienne à la fin de la République, c'est chercher à comprendre une emprise complexe de Rome. La violence de la conquête est une romanisation forcée : l'idéologie en est un élément essentiel car chaque peuple italien a sa propre vision de l'autre. Quel est dans ce processus, le rôle et la place respectifs des institutions centrales de Rome, des institutions locales romaines, des institutions " en voie de romanisation " et des institutions locales indigènes ? Charges et devoirs sont au cœur du processus d'intégration progressive à la citoyenneté romaine. La société romaine est à la fois cloisonnée, segmentaire, hiérarchisée et extrêmement fluide, ouverte à l'ascension sociale, au changement de statuts. Elle intègre et repousse, favorise ou empêche, de par sa structure même, les évolutions dues aux crises.
L'économie participe aussi à cette intégration selon la participation des individus ou groupes à des degrés divers au marché, à la diffusion de la monnaie, à la ville ou à l'autoconsommation. Enfin l'art, la religion, la culture sont autant de formes et de moyens de participation ou de rejet du monde romain. L'espace civique, architectural, spectaculaire fait de la ville un modèle visuel palpable de formes multiples de la romanisation.