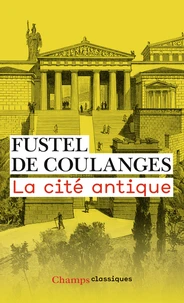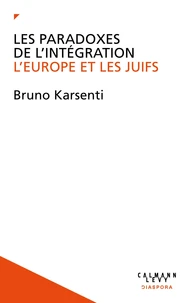L'homme total. Sociologie, anthropologie et philosophie chez Marcel Mauss
Par :Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages456
- PrésentationBroché
- Poids0.61 kg
- Dimensions15,1 cm × 21,7 cm × 3,0 cm
- ISBN2-13-048616-9
- EAN9782130486169
- Date de parution01/10/1997
- Collectionpratiques théoriques
- ÉditeurPUF
Résumé
L'homme total, tel est l'horizon d'une " science de l'homme " à la fois théorique et empirique, à laquelle Marcel Mauss a voulu donner ses assises par une conception renouvelée du symbolique et de son efficacité propre. Dans une série d'études écrites avant et après l'expérience traumatique de la Première Guerre mondiale, et qui culminent dans le célèbre Essai sur le don de 1925, rectifiant la conception durkheimienne du social comme structure de coercition du sujet, Mauss a refondé la sociologie comme anthropologie générale.
L'œuvre maussienne est ainsi devenue la source de tous les développements contemporains qui, en France, alimentent la réflexion à propos de l'objet des sciences humaines. Mais aussi, depuis plus de trente ans, le foyer des confrontations entre la phénoménologie (Merleau-Ponty), le structuralisme (Lévi-Strauss) et l'héritage nietzschéen (Bataille), à propos de l'ontologie et de l'éthique de l'intersubjectivité, sur le fond d'une critique de l'utilitarisme et d'une grande alternative à la dialectique hégélienne et marxiste.
Pour expliquer la productivité exceptionnelle de cette œuvre, Bruno Karsenti remonte les fils d'une généalogie intellectuelle qui traverse toute la philosophie, la sociologie et la psychologie françaises du XIXe et du XXe siècles, en évaluant l'effet des révolutions de pensée du langage, de la culture et de l'inconscient. Il montre comment s'est cristallisé le projet d'une critique des abstractions disciplinaires, qui font éclater l'unité du " phénomène social total ", et d'un dépassement des dualismes de l'individuel et du collectif, du logique et de l'affectif, du normal et du pathologique. Dans une reconstitution elle-même totale des déterminations dont l'Essai sur le don opère la synthèse, il met en évidence l'originalité de sa conception de la structure, le pouvoir d'explication et la capacité subversive dont elle dispose encore. Il contribue ainsi à éclairer la singularité du lien entre anthropologie et philosophie qui, depuis deux siècles, caractérise la pratique de ces disciplines dans l'espace intellectuel français.
L'homme total, tel est l'horizon d'une " science de l'homme " à la fois théorique et empirique, à laquelle Marcel Mauss a voulu donner ses assises par une conception renouvelée du symbolique et de son efficacité propre. Dans une série d'études écrites avant et après l'expérience traumatique de la Première Guerre mondiale, et qui culminent dans le célèbre Essai sur le don de 1925, rectifiant la conception durkheimienne du social comme structure de coercition du sujet, Mauss a refondé la sociologie comme anthropologie générale.
L'œuvre maussienne est ainsi devenue la source de tous les développements contemporains qui, en France, alimentent la réflexion à propos de l'objet des sciences humaines. Mais aussi, depuis plus de trente ans, le foyer des confrontations entre la phénoménologie (Merleau-Ponty), le structuralisme (Lévi-Strauss) et l'héritage nietzschéen (Bataille), à propos de l'ontologie et de l'éthique de l'intersubjectivité, sur le fond d'une critique de l'utilitarisme et d'une grande alternative à la dialectique hégélienne et marxiste.
Pour expliquer la productivité exceptionnelle de cette œuvre, Bruno Karsenti remonte les fils d'une généalogie intellectuelle qui traverse toute la philosophie, la sociologie et la psychologie françaises du XIXe et du XXe siècles, en évaluant l'effet des révolutions de pensée du langage, de la culture et de l'inconscient. Il montre comment s'est cristallisé le projet d'une critique des abstractions disciplinaires, qui font éclater l'unité du " phénomène social total ", et d'un dépassement des dualismes de l'individuel et du collectif, du logique et de l'affectif, du normal et du pathologique. Dans une reconstitution elle-même totale des déterminations dont l'Essai sur le don opère la synthèse, il met en évidence l'originalité de sa conception de la structure, le pouvoir d'explication et la capacité subversive dont elle dispose encore. Il contribue ainsi à éclairer la singularité du lien entre anthropologie et philosophie qui, depuis deux siècles, caractérise la pratique de ces disciplines dans l'espace intellectuel français.