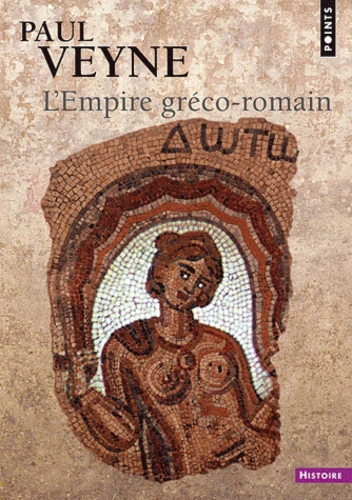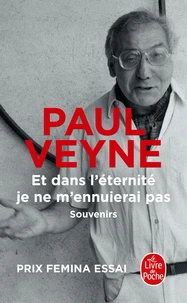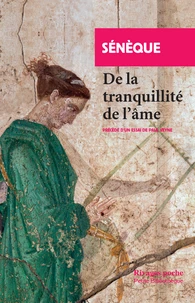L'Empire gréco-romain
Par :Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages1072
- PrésentationBroché
- FormatPoche
- Poids0.918 kg
- Dimensions13,0 cm × 18,5 cm × 4,7 cm
- ISBN978-2-7578-2781-9
- EAN9782757827819
- Date de parution23/02/2012
- CollectionPoints. Histoire
- ÉditeurPoints
Résumé
Qu’est-ce qu’un empereur romain ? A quoi est due la fin de
l’art antique ? Pourquoi des protestataires manifestaient-ils
contre les dieux en cas de malheur ? Autant de questions
parfois dérangeantes et toujours passionnantes que Paul Veyne
développe avec passion dans ce qu’il avait, à l’origine, conçu
comme une simple suite à La Société romaine. C’est devenu
au fil du temps et des remaniements un livre autonome, où il
ne tente rien moins que de donner une vision d’ensemble de ce
qu’il appelle "l’Empire gréco-romain".
Car l’Empire dit romain fut en réalité gréco-romain à au moins trois titres. D’abord par la langue. Certes, la langue véhiculaire qu’on pratiquait dans sa moitié occidentale était le latin, mais c’était le grec autour de la Méditerranée orientale et au Proche- Orient. Ensuite, la culture matérielle et morale de Rome est issue d’un processus d’assimilation de cette civilisation hellénique qui, de l’Afghanistan au Maroc, était la culture "mondiale" du temps.
Enfin, la culture y était hellénique et le pouvoir romain ; c’est d’ailleurs pourquoi les Romains hellénisés ont pu continuer à se croire tout aussi romains qu’ils l’avaient toujours été. Paul Veyne part donc du principe que ce qui se passait de l'Ecosse à l’Euphrate a autant d’importance et d’intérêt pour comprendre "Rome" que ce qui se passait chez les Romains de Rome, et il tente suggérer, à coups d’aperçus partiels, une vision d’ensemble de l’Empire gréco-romain qui montre que la "mondialisation" actuelle devrait plutôt être appelée la "seconde mondialisation", puisque la première est précisément celle qui a produit cet Empire qui a dominé, pendant plus de 400 ans, une surface de terre ferme partagée aujourd’hui entre trente nations.
Car l’Empire dit romain fut en réalité gréco-romain à au moins trois titres. D’abord par la langue. Certes, la langue véhiculaire qu’on pratiquait dans sa moitié occidentale était le latin, mais c’était le grec autour de la Méditerranée orientale et au Proche- Orient. Ensuite, la culture matérielle et morale de Rome est issue d’un processus d’assimilation de cette civilisation hellénique qui, de l’Afghanistan au Maroc, était la culture "mondiale" du temps.
Enfin, la culture y était hellénique et le pouvoir romain ; c’est d’ailleurs pourquoi les Romains hellénisés ont pu continuer à se croire tout aussi romains qu’ils l’avaient toujours été. Paul Veyne part donc du principe que ce qui se passait de l'Ecosse à l’Euphrate a autant d’importance et d’intérêt pour comprendre "Rome" que ce qui se passait chez les Romains de Rome, et il tente suggérer, à coups d’aperçus partiels, une vision d’ensemble de l’Empire gréco-romain qui montre que la "mondialisation" actuelle devrait plutôt être appelée la "seconde mondialisation", puisque la première est précisément celle qui a produit cet Empire qui a dominé, pendant plus de 400 ans, une surface de terre ferme partagée aujourd’hui entre trente nations.
Qu’est-ce qu’un empereur romain ? A quoi est due la fin de
l’art antique ? Pourquoi des protestataires manifestaient-ils
contre les dieux en cas de malheur ? Autant de questions
parfois dérangeantes et toujours passionnantes que Paul Veyne
développe avec passion dans ce qu’il avait, à l’origine, conçu
comme une simple suite à La Société romaine. C’est devenu
au fil du temps et des remaniements un livre autonome, où il
ne tente rien moins que de donner une vision d’ensemble de ce
qu’il appelle "l’Empire gréco-romain".
Car l’Empire dit romain fut en réalité gréco-romain à au moins trois titres. D’abord par la langue. Certes, la langue véhiculaire qu’on pratiquait dans sa moitié occidentale était le latin, mais c’était le grec autour de la Méditerranée orientale et au Proche- Orient. Ensuite, la culture matérielle et morale de Rome est issue d’un processus d’assimilation de cette civilisation hellénique qui, de l’Afghanistan au Maroc, était la culture "mondiale" du temps.
Enfin, la culture y était hellénique et le pouvoir romain ; c’est d’ailleurs pourquoi les Romains hellénisés ont pu continuer à se croire tout aussi romains qu’ils l’avaient toujours été. Paul Veyne part donc du principe que ce qui se passait de l'Ecosse à l’Euphrate a autant d’importance et d’intérêt pour comprendre "Rome" que ce qui se passait chez les Romains de Rome, et il tente suggérer, à coups d’aperçus partiels, une vision d’ensemble de l’Empire gréco-romain qui montre que la "mondialisation" actuelle devrait plutôt être appelée la "seconde mondialisation", puisque la première est précisément celle qui a produit cet Empire qui a dominé, pendant plus de 400 ans, une surface de terre ferme partagée aujourd’hui entre trente nations.
Car l’Empire dit romain fut en réalité gréco-romain à au moins trois titres. D’abord par la langue. Certes, la langue véhiculaire qu’on pratiquait dans sa moitié occidentale était le latin, mais c’était le grec autour de la Méditerranée orientale et au Proche- Orient. Ensuite, la culture matérielle et morale de Rome est issue d’un processus d’assimilation de cette civilisation hellénique qui, de l’Afghanistan au Maroc, était la culture "mondiale" du temps.
Enfin, la culture y était hellénique et le pouvoir romain ; c’est d’ailleurs pourquoi les Romains hellénisés ont pu continuer à se croire tout aussi romains qu’ils l’avaient toujours été. Paul Veyne part donc du principe que ce qui se passait de l'Ecosse à l’Euphrate a autant d’importance et d’intérêt pour comprendre "Rome" que ce qui se passait chez les Romains de Rome, et il tente suggérer, à coups d’aperçus partiels, une vision d’ensemble de l’Empire gréco-romain qui montre que la "mondialisation" actuelle devrait plutôt être appelée la "seconde mondialisation", puisque la première est précisément celle qui a produit cet Empire qui a dominé, pendant plus de 400 ans, une surface de terre ferme partagée aujourd’hui entre trente nations.