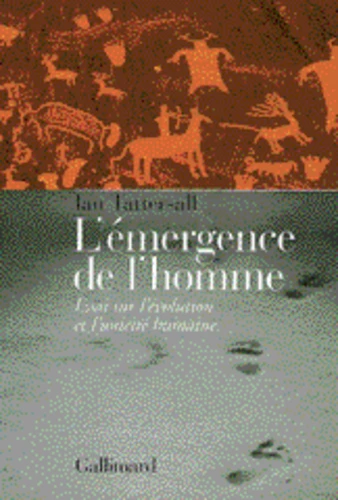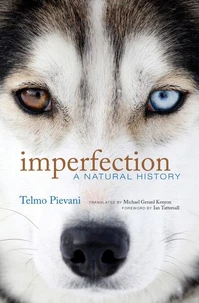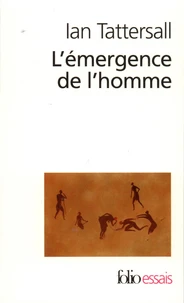L'Emergence De L'Homme. Essai Sur L'Evolution Et L'Unicite Humaine
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages282
- PrésentationBroché
- Poids0.29 kg
- Dimensions14,0 cm × 20,6 cm × 1,9 cm
- ISBN2-07-075364-6
- EAN9782070753642
- Date de parution22/05/1999
- CollectionNRF Essais
- ÉditeurGallimard
Résumé
Ce pourrait être la fable de l'arbre et du buisson. L'arbre, c'est la manière dont trop souvent encore, en France, on présente les origines de l'homme : comme un tronc planté droit, sans presque aucune branche morte, qui aurait vu se succéder les hominidés jusqu'à Homo
Sapiens, notre ancêtre. Le buisson, c'est désormais l'image de branches multiples et sans descendance, fruit d'une évolution qui tâtonne et bricole sous l'empire du seul hasard. Une évolution discontinue, marquée
par le décalage constant entre les progrès des caractéristiques anatomiques et les progrès de l'intelligence.
Cette image nouvelle se dégage des découvertes advenues au Cours du dernier quart de siècle. Il y a d'abord celles, préhistoriques, de squelettes d'hominidés jusqu'alors ignorés et qui ne sont aucunement nos ancêtres. Ces découvertes conduisent à postuler désormais qu'il n'y a pas eu uniquement succession des espèces, mais bien coexistence de certaines d'entre elles dans le temps et dans l'espace. Pourquoi l'une a-t-elle survécu et donnée l'homme ? La réponse est apportée par la théorie de l'évolution qui porte aujourd'hui l'accent sur la " spéciation ", c'est-à-dire la production incessante d'espèces nouvelles, et le " tri entre espèces " comme mécanismes de sélection naturelle.
Langage, faculté symbolique, conscience de la mort et invention de l'art n'apparaissent que très tardivement, au stade d'Homo sapiens, il y a 100 000 ans. Autant de caractéristiques qui n'avaient rien d'inéluctable, l'évolution avant pur s'arrêter avec l'homme de Néandertal qui ne jouissait pas de celles-ci. C'est en ce sens qu'on peut parler d'unicité de l'espèce humaine. C'est en cela qu'il n'y a pas en " naissance " de l'homme, mais " émergence ", fruit imprévu d'adaptations contingentes.
Ce pourrait être la fable de l'arbre et du buisson. L'arbre, c'est la manière dont trop souvent encore, en France, on présente les origines de l'homme : comme un tronc planté droit, sans presque aucune branche morte, qui aurait vu se succéder les hominidés jusqu'à Homo
Sapiens, notre ancêtre. Le buisson, c'est désormais l'image de branches multiples et sans descendance, fruit d'une évolution qui tâtonne et bricole sous l'empire du seul hasard. Une évolution discontinue, marquée
par le décalage constant entre les progrès des caractéristiques anatomiques et les progrès de l'intelligence.
Cette image nouvelle se dégage des découvertes advenues au Cours du dernier quart de siècle. Il y a d'abord celles, préhistoriques, de squelettes d'hominidés jusqu'alors ignorés et qui ne sont aucunement nos ancêtres. Ces découvertes conduisent à postuler désormais qu'il n'y a pas eu uniquement succession des espèces, mais bien coexistence de certaines d'entre elles dans le temps et dans l'espace. Pourquoi l'une a-t-elle survécu et donnée l'homme ? La réponse est apportée par la théorie de l'évolution qui porte aujourd'hui l'accent sur la " spéciation ", c'est-à-dire la production incessante d'espèces nouvelles, et le " tri entre espèces " comme mécanismes de sélection naturelle.
Langage, faculté symbolique, conscience de la mort et invention de l'art n'apparaissent que très tardivement, au stade d'Homo sapiens, il y a 100 000 ans. Autant de caractéristiques qui n'avaient rien d'inéluctable, l'évolution avant pur s'arrêter avec l'homme de Néandertal qui ne jouissait pas de celles-ci. C'est en ce sens qu'on peut parler d'unicité de l'espèce humaine. C'est en cela qu'il n'y a pas en " naissance " de l'homme, mais " émergence ", fruit imprévu d'adaptations contingentes.