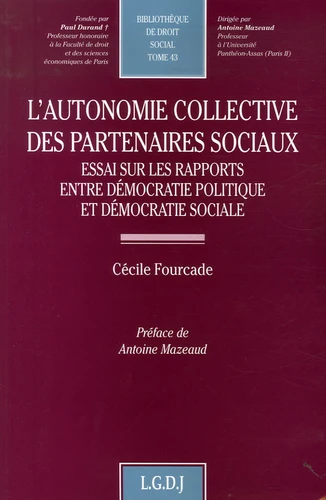L'autonomie collective des partenaires sociaux. Essai sur les rapports entre démocratie politique et démocratie sociale
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages506
- PrésentationBroché
- Poids0.71 kg
- Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 2,4 cm
- ISBN2-275-03122-7
- EAN9782275031224
- Date de parution28/11/2006
- CollectionBibliothèque de droit social
- ÉditeurLGDJ
- PréfacierAntoine Mazeaud
Résumé
Le système de droit collectif français du travail se caractérise par une absence de reconnaissance de sphère d'autonomie exclusive au profit des partenaires sociaux. La Constitution consacre une réserve de compétence législative irréductible pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale, puis elle renvoie au seul pouvoir exécutif, et à lui seul, les modalités de leur application.
L'autorité étatique, consciente des vertus de la négociation collective, et le juge constitutionnel, attentif à la spécificité et à la diversité des sources propres au droit du travail, ont néanmoins permis le développement de la négociation collective. Ils ont, en particulier, favorisé l'association des acteurs sociaux au processus de création et de mise en œuvre de la norme légale, ce qui a pour effet de perturber la hiérarchie des normes et la répartition traditionnelle des compétences entre les pouvoirs législatif et réglementaire.
Pour autant, ce développement de la " politique contractuelle ", et plus généralement de la négociation collective, ne s'est pas traduit par un déclin de l'autorité du législateur. En droit interne, l'autonomie collective, au sens fort, n'existe pas ; elle demeure, en dépit des apparences, un pouvoir concédé et non reconnu par l'autorité étatique qui organise et promeut la négociation collective. La participation des partenaires sociaux à l'œuvre du législateur a conduit certaines organisations patronales et syndicales à revendiquer une sphère d'intervention autonome, à l'instar de celle dont ils jouissent à certains égards au niveau communautaire.
Le renforcement de l'autonomie collective des partenaires sociaux est un objectif à atteindre. Il convient de redéfinir la place de la démocratie sociale par rapport à la démocratie nationale, ce qui suppose, notamment, un renforcement de la légitimité des partenaires sociaux. Un tel objectif nécessite une refonte du droit positif (droit de la représentativité, modes de ratification des accords négociés, processus d'élaboration et de mise en couvre de la norme légale...).
La présente étude ne préconise pas la reconnaissance d'un domaine constitutionnellement réservé à la négociation collective, mais elle formule des propositions de réforme tendant à un renforcement du pouvoir normatif des partenaires sociaux. Le développement inéluctable de l'autonomie collective des partenaires sociaux devra nécessairement s'inscrire dans un processus progressif et raisonné.
L'autorité étatique, consciente des vertus de la négociation collective, et le juge constitutionnel, attentif à la spécificité et à la diversité des sources propres au droit du travail, ont néanmoins permis le développement de la négociation collective. Ils ont, en particulier, favorisé l'association des acteurs sociaux au processus de création et de mise en œuvre de la norme légale, ce qui a pour effet de perturber la hiérarchie des normes et la répartition traditionnelle des compétences entre les pouvoirs législatif et réglementaire.
Pour autant, ce développement de la " politique contractuelle ", et plus généralement de la négociation collective, ne s'est pas traduit par un déclin de l'autorité du législateur. En droit interne, l'autonomie collective, au sens fort, n'existe pas ; elle demeure, en dépit des apparences, un pouvoir concédé et non reconnu par l'autorité étatique qui organise et promeut la négociation collective. La participation des partenaires sociaux à l'œuvre du législateur a conduit certaines organisations patronales et syndicales à revendiquer une sphère d'intervention autonome, à l'instar de celle dont ils jouissent à certains égards au niveau communautaire.
Le renforcement de l'autonomie collective des partenaires sociaux est un objectif à atteindre. Il convient de redéfinir la place de la démocratie sociale par rapport à la démocratie nationale, ce qui suppose, notamment, un renforcement de la légitimité des partenaires sociaux. Un tel objectif nécessite une refonte du droit positif (droit de la représentativité, modes de ratification des accords négociés, processus d'élaboration et de mise en couvre de la norme légale...).
La présente étude ne préconise pas la reconnaissance d'un domaine constitutionnellement réservé à la négociation collective, mais elle formule des propositions de réforme tendant à un renforcement du pouvoir normatif des partenaires sociaux. Le développement inéluctable de l'autonomie collective des partenaires sociaux devra nécessairement s'inscrire dans un processus progressif et raisonné.
Le système de droit collectif français du travail se caractérise par une absence de reconnaissance de sphère d'autonomie exclusive au profit des partenaires sociaux. La Constitution consacre une réserve de compétence législative irréductible pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale, puis elle renvoie au seul pouvoir exécutif, et à lui seul, les modalités de leur application.
L'autorité étatique, consciente des vertus de la négociation collective, et le juge constitutionnel, attentif à la spécificité et à la diversité des sources propres au droit du travail, ont néanmoins permis le développement de la négociation collective. Ils ont, en particulier, favorisé l'association des acteurs sociaux au processus de création et de mise en œuvre de la norme légale, ce qui a pour effet de perturber la hiérarchie des normes et la répartition traditionnelle des compétences entre les pouvoirs législatif et réglementaire.
Pour autant, ce développement de la " politique contractuelle ", et plus généralement de la négociation collective, ne s'est pas traduit par un déclin de l'autorité du législateur. En droit interne, l'autonomie collective, au sens fort, n'existe pas ; elle demeure, en dépit des apparences, un pouvoir concédé et non reconnu par l'autorité étatique qui organise et promeut la négociation collective. La participation des partenaires sociaux à l'œuvre du législateur a conduit certaines organisations patronales et syndicales à revendiquer une sphère d'intervention autonome, à l'instar de celle dont ils jouissent à certains égards au niveau communautaire.
Le renforcement de l'autonomie collective des partenaires sociaux est un objectif à atteindre. Il convient de redéfinir la place de la démocratie sociale par rapport à la démocratie nationale, ce qui suppose, notamment, un renforcement de la légitimité des partenaires sociaux. Un tel objectif nécessite une refonte du droit positif (droit de la représentativité, modes de ratification des accords négociés, processus d'élaboration et de mise en couvre de la norme légale...).
La présente étude ne préconise pas la reconnaissance d'un domaine constitutionnellement réservé à la négociation collective, mais elle formule des propositions de réforme tendant à un renforcement du pouvoir normatif des partenaires sociaux. Le développement inéluctable de l'autonomie collective des partenaires sociaux devra nécessairement s'inscrire dans un processus progressif et raisonné.
L'autorité étatique, consciente des vertus de la négociation collective, et le juge constitutionnel, attentif à la spécificité et à la diversité des sources propres au droit du travail, ont néanmoins permis le développement de la négociation collective. Ils ont, en particulier, favorisé l'association des acteurs sociaux au processus de création et de mise en œuvre de la norme légale, ce qui a pour effet de perturber la hiérarchie des normes et la répartition traditionnelle des compétences entre les pouvoirs législatif et réglementaire.
Pour autant, ce développement de la " politique contractuelle ", et plus généralement de la négociation collective, ne s'est pas traduit par un déclin de l'autorité du législateur. En droit interne, l'autonomie collective, au sens fort, n'existe pas ; elle demeure, en dépit des apparences, un pouvoir concédé et non reconnu par l'autorité étatique qui organise et promeut la négociation collective. La participation des partenaires sociaux à l'œuvre du législateur a conduit certaines organisations patronales et syndicales à revendiquer une sphère d'intervention autonome, à l'instar de celle dont ils jouissent à certains égards au niveau communautaire.
Le renforcement de l'autonomie collective des partenaires sociaux est un objectif à atteindre. Il convient de redéfinir la place de la démocratie sociale par rapport à la démocratie nationale, ce qui suppose, notamment, un renforcement de la légitimité des partenaires sociaux. Un tel objectif nécessite une refonte du droit positif (droit de la représentativité, modes de ratification des accords négociés, processus d'élaboration et de mise en couvre de la norme légale...).
La présente étude ne préconise pas la reconnaissance d'un domaine constitutionnellement réservé à la négociation collective, mais elle formule des propositions de réforme tendant à un renforcement du pouvoir normatif des partenaires sociaux. Le développement inéluctable de l'autonomie collective des partenaires sociaux devra nécessairement s'inscrire dans un processus progressif et raisonné.