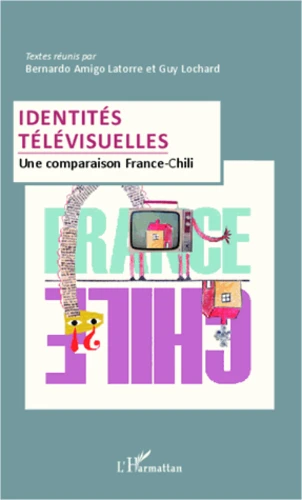Identités télévisuelles. Une comparaison France-Chili
Par : ,Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages218
- PrésentationBroché
- Poids0.275 kg
- Dimensions13,5 cm × 21,3 cm × 1,7 cm
- ISBN978-2-336-29193-2
- EAN9782336291932
- Date de parution01/05/2013
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
La télévision mondiale est-elle en proie à un mouvement irréversible et unidirectionnel d'homogénéisation des formats et de standardisation des logiques de programmation à un niveau mondial ? S'oriente-t-on vers une télévision uniforme ? C'est l'interrogation à laquelle tente de répondre cet ouvrage à travers une étude comparative de deux systèmes télévisuels : celui du Chili et de la France. Ces deux télévisions nationales sont a priori très éloignées par leur histoire.
Elles présentent toutefois un point commun généralement ignoré : celui de s'être constituées à l'origine sur un projet culturel et pédagogique, pris en charge par l'Etat en France, délégué au Chili à deux universités nationales. En raison d'une histoire politique contrastée, elles ont connu ensuite une évolution très différenciée à l'origine de paysages de programmes spécifiques que ne laisse pas soupçonner un regard borné au constat de formats communs ou apparentés.
C'est bien ce que montrent les contributions de deux équipes de chercheurs associés qui ont examiné trois types de programmes particulièrement révélateurs de ces écarts : les programmes politiques, les retransmissions sportives et les séries fictionnelles. Leur examen révèle des dispositifs, des discours et des usages particuliers et témoigne donc de l'existence d'identités télévisuelles bien spécifiques.
Cette étude met aussi au jour la différence d'approche qui demeure entre des communautés nationales de chercheurs lorsqu'elles se confrontent à un objet aussi impliquant que la télévision.
Elles présentent toutefois un point commun généralement ignoré : celui de s'être constituées à l'origine sur un projet culturel et pédagogique, pris en charge par l'Etat en France, délégué au Chili à deux universités nationales. En raison d'une histoire politique contrastée, elles ont connu ensuite une évolution très différenciée à l'origine de paysages de programmes spécifiques que ne laisse pas soupçonner un regard borné au constat de formats communs ou apparentés.
C'est bien ce que montrent les contributions de deux équipes de chercheurs associés qui ont examiné trois types de programmes particulièrement révélateurs de ces écarts : les programmes politiques, les retransmissions sportives et les séries fictionnelles. Leur examen révèle des dispositifs, des discours et des usages particuliers et témoigne donc de l'existence d'identités télévisuelles bien spécifiques.
Cette étude met aussi au jour la différence d'approche qui demeure entre des communautés nationales de chercheurs lorsqu'elles se confrontent à un objet aussi impliquant que la télévision.
La télévision mondiale est-elle en proie à un mouvement irréversible et unidirectionnel d'homogénéisation des formats et de standardisation des logiques de programmation à un niveau mondial ? S'oriente-t-on vers une télévision uniforme ? C'est l'interrogation à laquelle tente de répondre cet ouvrage à travers une étude comparative de deux systèmes télévisuels : celui du Chili et de la France. Ces deux télévisions nationales sont a priori très éloignées par leur histoire.
Elles présentent toutefois un point commun généralement ignoré : celui de s'être constituées à l'origine sur un projet culturel et pédagogique, pris en charge par l'Etat en France, délégué au Chili à deux universités nationales. En raison d'une histoire politique contrastée, elles ont connu ensuite une évolution très différenciée à l'origine de paysages de programmes spécifiques que ne laisse pas soupçonner un regard borné au constat de formats communs ou apparentés.
C'est bien ce que montrent les contributions de deux équipes de chercheurs associés qui ont examiné trois types de programmes particulièrement révélateurs de ces écarts : les programmes politiques, les retransmissions sportives et les séries fictionnelles. Leur examen révèle des dispositifs, des discours et des usages particuliers et témoigne donc de l'existence d'identités télévisuelles bien spécifiques.
Cette étude met aussi au jour la différence d'approche qui demeure entre des communautés nationales de chercheurs lorsqu'elles se confrontent à un objet aussi impliquant que la télévision.
Elles présentent toutefois un point commun généralement ignoré : celui de s'être constituées à l'origine sur un projet culturel et pédagogique, pris en charge par l'Etat en France, délégué au Chili à deux universités nationales. En raison d'une histoire politique contrastée, elles ont connu ensuite une évolution très différenciée à l'origine de paysages de programmes spécifiques que ne laisse pas soupçonner un regard borné au constat de formats communs ou apparentés.
C'est bien ce que montrent les contributions de deux équipes de chercheurs associés qui ont examiné trois types de programmes particulièrement révélateurs de ces écarts : les programmes politiques, les retransmissions sportives et les séries fictionnelles. Leur examen révèle des dispositifs, des discours et des usages particuliers et témoigne donc de l'existence d'identités télévisuelles bien spécifiques.
Cette étude met aussi au jour la différence d'approche qui demeure entre des communautés nationales de chercheurs lorsqu'elles se confrontent à un objet aussi impliquant que la télévision.