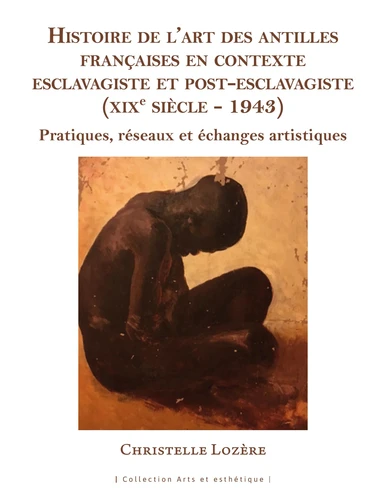À paraître
Histoire de l'art des Antilles françaises en contexte esclavagiste et post - esclavagiste (XIXe siècle - 1943). Pratiques, réseaux et échanges artistiques
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 8 décembreVotre colis est préparé et expédié le jour de la sortie de cet article, hors dimanches et jours fériés, dans la limite des stocks disponibles.
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 8 décembre
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages200
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.696 kg
- Dimensions17,2 cm × 22,0 cm × 2,3 cm
- ISBN978-2-488234-20-7
- EAN9782488234207
- Date de parution04/12/2025
- ÉditeurPresses universitaires des Ant
Résumé
Cet ouvrage ouvre la voie à une histoire de l'art des Antilles décentrée et renouvelée de la période esclavagiste et post-esclavagiste. Il est basé sur un travail de recherches, de grande ampleur, inédit et fondateur. Dès la fin du XVIII ? siècle, les sources archivistiques témoignent de pratiques picturales amatrices et professionnelles en Guadeloupe et en Martinique. Elles révèlent l'émergence d'un marché de l'art européen et inter-caribéen, qui se développe au XIX ? siècle avec l'essor de l'école du paysage pittoresque et de la photographie, avant de prendre une ampleur et une résonance particulières dans la première moitié du XX ? siècle.
Ce travail de recherches, mené depuis une dizaine d'années, aborde les artistes (600 environ), et les oeuvres qui ont construit les imaginaires caribéens en mutation. Depuis les Antilles, il souligne les absences, les silences, les fractures, les blocages, les préjugés, le poids du modèle académique et son esthétique "? beaux-arts ? ", celui des propagandes impériales assimilationnistes et touristiques.
Il sort de l'oubli le rôle majeur des femmes artistes, des professeurs de dessin des lycées républicains et des afro-descendants dans l'élaboration d'une vie artistique insulaire solidaire et engagée, porteuse d'espoir de changement et de reconnaissance. Cet ouvrage fondateur ouvre la voie à une histoire de l'art des Antilles décentrée, renouvelée et en réseau avec Paris. Il explore les temporalités, les trajectoires et les dynamiques artistiques au coeur d'un contexte esclavagiste et post-esclavagiste, marqué par des rapports de domination et de contraintes, mais aussi des stratégies de résistance par le contournement.
Ce travail de recherches, mené depuis une dizaine d'années, aborde les artistes (600 environ), et les oeuvres qui ont construit les imaginaires caribéens en mutation. Depuis les Antilles, il souligne les absences, les silences, les fractures, les blocages, les préjugés, le poids du modèle académique et son esthétique "? beaux-arts ? ", celui des propagandes impériales assimilationnistes et touristiques.
Il sort de l'oubli le rôle majeur des femmes artistes, des professeurs de dessin des lycées républicains et des afro-descendants dans l'élaboration d'une vie artistique insulaire solidaire et engagée, porteuse d'espoir de changement et de reconnaissance. Cet ouvrage fondateur ouvre la voie à une histoire de l'art des Antilles décentrée, renouvelée et en réseau avec Paris. Il explore les temporalités, les trajectoires et les dynamiques artistiques au coeur d'un contexte esclavagiste et post-esclavagiste, marqué par des rapports de domination et de contraintes, mais aussi des stratégies de résistance par le contournement.
Cet ouvrage ouvre la voie à une histoire de l'art des Antilles décentrée et renouvelée de la période esclavagiste et post-esclavagiste. Il est basé sur un travail de recherches, de grande ampleur, inédit et fondateur. Dès la fin du XVIII ? siècle, les sources archivistiques témoignent de pratiques picturales amatrices et professionnelles en Guadeloupe et en Martinique. Elles révèlent l'émergence d'un marché de l'art européen et inter-caribéen, qui se développe au XIX ? siècle avec l'essor de l'école du paysage pittoresque et de la photographie, avant de prendre une ampleur et une résonance particulières dans la première moitié du XX ? siècle.
Ce travail de recherches, mené depuis une dizaine d'années, aborde les artistes (600 environ), et les oeuvres qui ont construit les imaginaires caribéens en mutation. Depuis les Antilles, il souligne les absences, les silences, les fractures, les blocages, les préjugés, le poids du modèle académique et son esthétique "? beaux-arts ? ", celui des propagandes impériales assimilationnistes et touristiques.
Il sort de l'oubli le rôle majeur des femmes artistes, des professeurs de dessin des lycées républicains et des afro-descendants dans l'élaboration d'une vie artistique insulaire solidaire et engagée, porteuse d'espoir de changement et de reconnaissance. Cet ouvrage fondateur ouvre la voie à une histoire de l'art des Antilles décentrée, renouvelée et en réseau avec Paris. Il explore les temporalités, les trajectoires et les dynamiques artistiques au coeur d'un contexte esclavagiste et post-esclavagiste, marqué par des rapports de domination et de contraintes, mais aussi des stratégies de résistance par le contournement.
Ce travail de recherches, mené depuis une dizaine d'années, aborde les artistes (600 environ), et les oeuvres qui ont construit les imaginaires caribéens en mutation. Depuis les Antilles, il souligne les absences, les silences, les fractures, les blocages, les préjugés, le poids du modèle académique et son esthétique "? beaux-arts ? ", celui des propagandes impériales assimilationnistes et touristiques.
Il sort de l'oubli le rôle majeur des femmes artistes, des professeurs de dessin des lycées républicains et des afro-descendants dans l'élaboration d'une vie artistique insulaire solidaire et engagée, porteuse d'espoir de changement et de reconnaissance. Cet ouvrage fondateur ouvre la voie à une histoire de l'art des Antilles décentrée, renouvelée et en réseau avec Paris. Il explore les temporalités, les trajectoires et les dynamiques artistiques au coeur d'un contexte esclavagiste et post-esclavagiste, marqué par des rapports de domination et de contraintes, mais aussi des stratégies de résistance par le contournement.