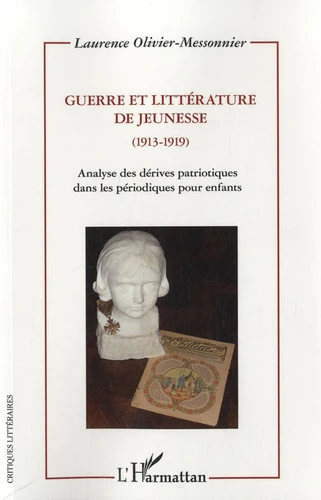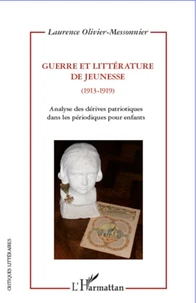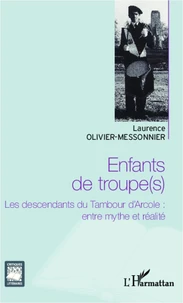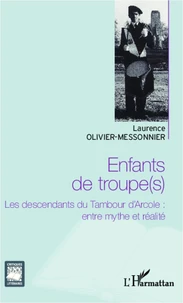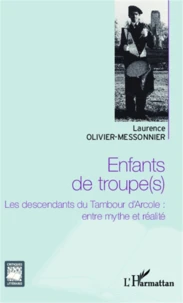Guerre et littérature de jeunesse (1913-1919). Analyse des dérives patriotiques dans les périodiques pour enfants
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages412
- PrésentationBroché
- Poids0.645 kg
- Dimensions15,5 cm × 23,8 cm × 2,2 cm
- ISBN978-2-296-96069-5
- EAN9782296960695
- Date de parution01/04/2012
- CollectionCritiques littéraires
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
Entre 1900 et 1933, quarante journaux pour enfants voient le
jour, au nombre desquels La Semaine de Suzette, L'Epatant,
Fillette avec leurs héros phares, Bécassine, Les Pieds Nickelés
et Lili. Les périodiques comme les "Livres Roses de la guerre"
de Larousse alimentent une paralittérature de "bourrage de
crâne". En effet, la déclaration de la guerre en août 1914
donne une inflexion patriotique à ces publications alors avant
tout récréatives.
Elles vont devenir des vecteurs idéologiques polémiques tant par leur contenu nationaliste que par leur forme contestée : la bande dessinée dont les détracteurs se plaisent à dire qu'elle perd toute consistance intellectuelle. Une optique comparatiste permet d'envisager le degré d'adhésion aux consignes officielles édictées et de faire le pont entre fiction et non-fiction, texte et contexte, histoire et littérature, texte et image.
Sous les poncifs cocardiers sont exhumées des richesses littéraires insoupçonnées. Cet essai se trouve à l'articulation du politique, de l'imaginaire, de l'organisation narrative, de la transcription pédagogique, de la transmission intergénérationnelle...
Elles vont devenir des vecteurs idéologiques polémiques tant par leur contenu nationaliste que par leur forme contestée : la bande dessinée dont les détracteurs se plaisent à dire qu'elle perd toute consistance intellectuelle. Une optique comparatiste permet d'envisager le degré d'adhésion aux consignes officielles édictées et de faire le pont entre fiction et non-fiction, texte et contexte, histoire et littérature, texte et image.
Sous les poncifs cocardiers sont exhumées des richesses littéraires insoupçonnées. Cet essai se trouve à l'articulation du politique, de l'imaginaire, de l'organisation narrative, de la transcription pédagogique, de la transmission intergénérationnelle...
Entre 1900 et 1933, quarante journaux pour enfants voient le
jour, au nombre desquels La Semaine de Suzette, L'Epatant,
Fillette avec leurs héros phares, Bécassine, Les Pieds Nickelés
et Lili. Les périodiques comme les "Livres Roses de la guerre"
de Larousse alimentent une paralittérature de "bourrage de
crâne". En effet, la déclaration de la guerre en août 1914
donne une inflexion patriotique à ces publications alors avant
tout récréatives.
Elles vont devenir des vecteurs idéologiques polémiques tant par leur contenu nationaliste que par leur forme contestée : la bande dessinée dont les détracteurs se plaisent à dire qu'elle perd toute consistance intellectuelle. Une optique comparatiste permet d'envisager le degré d'adhésion aux consignes officielles édictées et de faire le pont entre fiction et non-fiction, texte et contexte, histoire et littérature, texte et image.
Sous les poncifs cocardiers sont exhumées des richesses littéraires insoupçonnées. Cet essai se trouve à l'articulation du politique, de l'imaginaire, de l'organisation narrative, de la transcription pédagogique, de la transmission intergénérationnelle...
Elles vont devenir des vecteurs idéologiques polémiques tant par leur contenu nationaliste que par leur forme contestée : la bande dessinée dont les détracteurs se plaisent à dire qu'elle perd toute consistance intellectuelle. Une optique comparatiste permet d'envisager le degré d'adhésion aux consignes officielles édictées et de faire le pont entre fiction et non-fiction, texte et contexte, histoire et littérature, texte et image.
Sous les poncifs cocardiers sont exhumées des richesses littéraires insoupçonnées. Cet essai se trouve à l'articulation du politique, de l'imaginaire, de l'organisation narrative, de la transcription pédagogique, de la transmission intergénérationnelle...