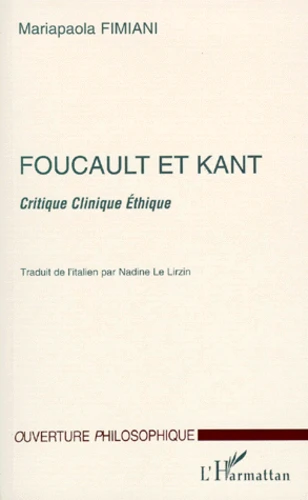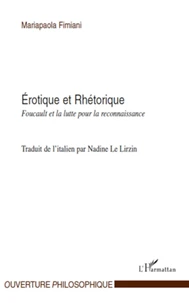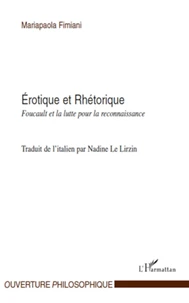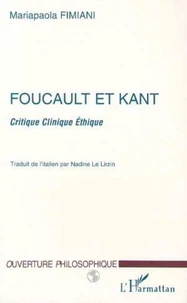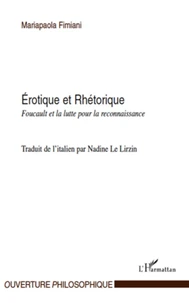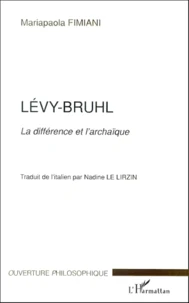FOUCAULT ET KANT.. Critique Clinique Ethique
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages143
- PrésentationBroché
- Poids0.185 kg
- Dimensions13,6 cm × 21,6 cm × 1,2 cm
- ISBN2-7384-7211-7
- EAN9782738472113
- Date de parution07/01/1999
- CollectionOuverture philosophique
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
L'idée que l'uvre de Michel Foucault puisse être considérée comme une réécriture, un "palimpseste" du Kantisme nous est suggérée par ses commentaires des écrits de Kant sur les Lumières et la Révolution. En réalité, et c'est la thèse qui est soutenue dans cet ouvrage, l'inspiration kantienne accompagne à distance le parcours entier de la recherche de Foucault. La séquence conceptuelle mise en jeu par l'éthique de la "subjectivation" et par la difficile notion d'une "esthétique de l'existence" se trouve déjà esquissée dans son Introduction à l'anthropologie de Kant.
Inédit à ce jour, ce texte en 1961 discute des problèmes de l'anthropologie pragmatique kantienne. C'est dans sa lecture de l'anthropologie de Kant que Foucault rencontre les questions qui l'occuperont tout au long de sa recherche : l'existence singulière et la maladie, la "médecine morale", le domaine du "souci" et la maîtrise de soi, la "conduite" du sujet moral pris dans les systèmes de savoir et e pouvoir, "l'exercice quotidien" d'un "art" qui devient un "usage de la vie" délicat et attentif, la liberté comme connaissance des limites et comme courage "parrhésiaste" et enfin le monde comme "système concret d'appartenance" et comme espace de "l'actualité".
Inédit à ce jour, ce texte en 1961 discute des problèmes de l'anthropologie pragmatique kantienne. C'est dans sa lecture de l'anthropologie de Kant que Foucault rencontre les questions qui l'occuperont tout au long de sa recherche : l'existence singulière et la maladie, la "médecine morale", le domaine du "souci" et la maîtrise de soi, la "conduite" du sujet moral pris dans les systèmes de savoir et e pouvoir, "l'exercice quotidien" d'un "art" qui devient un "usage de la vie" délicat et attentif, la liberté comme connaissance des limites et comme courage "parrhésiaste" et enfin le monde comme "système concret d'appartenance" et comme espace de "l'actualité".
L'idée que l'uvre de Michel Foucault puisse être considérée comme une réécriture, un "palimpseste" du Kantisme nous est suggérée par ses commentaires des écrits de Kant sur les Lumières et la Révolution. En réalité, et c'est la thèse qui est soutenue dans cet ouvrage, l'inspiration kantienne accompagne à distance le parcours entier de la recherche de Foucault. La séquence conceptuelle mise en jeu par l'éthique de la "subjectivation" et par la difficile notion d'une "esthétique de l'existence" se trouve déjà esquissée dans son Introduction à l'anthropologie de Kant.
Inédit à ce jour, ce texte en 1961 discute des problèmes de l'anthropologie pragmatique kantienne. C'est dans sa lecture de l'anthropologie de Kant que Foucault rencontre les questions qui l'occuperont tout au long de sa recherche : l'existence singulière et la maladie, la "médecine morale", le domaine du "souci" et la maîtrise de soi, la "conduite" du sujet moral pris dans les systèmes de savoir et e pouvoir, "l'exercice quotidien" d'un "art" qui devient un "usage de la vie" délicat et attentif, la liberté comme connaissance des limites et comme courage "parrhésiaste" et enfin le monde comme "système concret d'appartenance" et comme espace de "l'actualité".
Inédit à ce jour, ce texte en 1961 discute des problèmes de l'anthropologie pragmatique kantienne. C'est dans sa lecture de l'anthropologie de Kant que Foucault rencontre les questions qui l'occuperont tout au long de sa recherche : l'existence singulière et la maladie, la "médecine morale", le domaine du "souci" et la maîtrise de soi, la "conduite" du sujet moral pris dans les systèmes de savoir et e pouvoir, "l'exercice quotidien" d'un "art" qui devient un "usage de la vie" délicat et attentif, la liberté comme connaissance des limites et comme courage "parrhésiaste" et enfin le monde comme "système concret d'appartenance" et comme espace de "l'actualité".