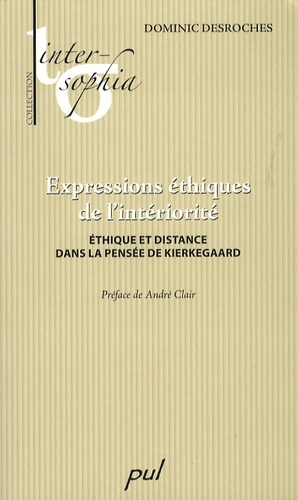Expressions éthiques de l'intériorité. Ethique et distance dans la pensée de Kierkegaard
Par :Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages360
- PrésentationBroché
- Poids0.435 kg
- Dimensions13,5 cm × 22,0 cm × 1,9 cm
- ISBN978-2-7637-8625-4
- EAN9782763786254
- Date de parution30/10/2008
- CollectionInter-Sophia
- ÉditeurPresses Université Laval
- PréfacierAndré Clair
Résumé
Kierkegaard est un penseur du langage. Dans ses Papirer, il note que derrière toute parole se tient un silence, une idéalité " que l'homme a reçue gratuitement ", et dont l'usage exprime un agir. Or ce rappel d'une vieille vérité, au moins aussi vieille que Pythagore, a plongé Kierkegaard dans un problème nouveau. Car, si la philosophie veut tout dire, elle oublie que l'essentiel ne se dit pas, ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'exprime pas. Ainsi est-il amené à penser une dialectique de la distance cherchant à illustrer les expressions de cette intériorité qui ne peut se dire directement sans se perdre. Abandonnant Hegel, il interprète Hamann. Ce choix permet à Kierkegaard de montrer que, si le langage, par la distance qu'il pose, falsifie l'éthique, il peut aussi la réhabiliter dans une " seconde éthique ". Le Danois forge le problème qui animera toute l'éthique du XXe siècle. Car c'est cet enjeu, au centre des œuvres de Wittgenstein, de Gadamer et de Lévinas, qui consiste à cerner les limites du langage, qu'il analyse. Or, père du problème, Kierkegaard peut nous réapprendre quelque chose que notre modernité a tendance à refuser. C'est qu'en niant l'intériorité, en l'obligeant à vouloir dire ou en la séparant de l'autre, la pensée contemporaine a perdu la clef de l'éthique. Cette clef réside en ceci : il faut d'abord accepter de se taire pour réentendre la parole qui s'exprime au fond de nous, en secret, et qui seule assure la genèse de la subjectivité dans sa quête de vérité.
Kierkegaard est un penseur du langage. Dans ses Papirer, il note que derrière toute parole se tient un silence, une idéalité " que l'homme a reçue gratuitement ", et dont l'usage exprime un agir. Or ce rappel d'une vieille vérité, au moins aussi vieille que Pythagore, a plongé Kierkegaard dans un problème nouveau. Car, si la philosophie veut tout dire, elle oublie que l'essentiel ne se dit pas, ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'exprime pas. Ainsi est-il amené à penser une dialectique de la distance cherchant à illustrer les expressions de cette intériorité qui ne peut se dire directement sans se perdre. Abandonnant Hegel, il interprète Hamann. Ce choix permet à Kierkegaard de montrer que, si le langage, par la distance qu'il pose, falsifie l'éthique, il peut aussi la réhabiliter dans une " seconde éthique ". Le Danois forge le problème qui animera toute l'éthique du XXe siècle. Car c'est cet enjeu, au centre des œuvres de Wittgenstein, de Gadamer et de Lévinas, qui consiste à cerner les limites du langage, qu'il analyse. Or, père du problème, Kierkegaard peut nous réapprendre quelque chose que notre modernité a tendance à refuser. C'est qu'en niant l'intériorité, en l'obligeant à vouloir dire ou en la séparant de l'autre, la pensée contemporaine a perdu la clef de l'éthique. Cette clef réside en ceci : il faut d'abord accepter de se taire pour réentendre la parole qui s'exprime au fond de nous, en secret, et qui seule assure la genèse de la subjectivité dans sa quête de vérité.