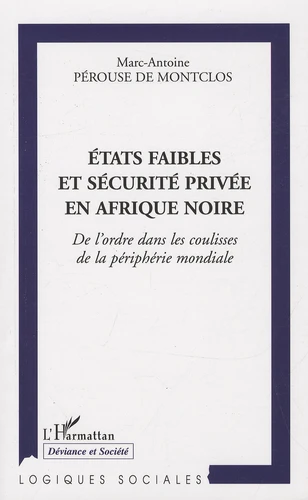Etats faibles et sécurité privée en Afrique noire. De l'ordre dans les coulisses de la périphérie mondiale
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages204
- PrésentationBroché
- Poids0.235 kg
- Dimensions14,0 cm × 21,5 cm × 1,4 cm
- ISBN978-2-296-05597-1
- EAN9782296055971
- Date de parution01/04/2008
- CollectionLogiques sociales
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
A partir d'exemples majoritairement puisés en Afrique noire, ce livre analyse les dilemmes de la sécurité publique dans les États faibles. Il montre notamment que si les polices des pays en développement sont rarement considérées comme des objets de recherche dignes de considération, elles constituent en fait un enjeu fondamental de la construction de l'État. Leurs défaillances relèvent en effet de problèmes structurels et pas seulement conjoncturels.
Elles ne sont ni récentes, ni limitées géographiquement. De façon empirique, le visiteur de passage ou l'expatrié ne peut certainement pas les ignorer. Les check points de police qui lui barrent la route sont bien visibles. Appelés bouchons en Afrique francophone, ils mettent en évidence toute une économie politique de la violence et du racket qui consiste à rançonner la population au nom de l'État et au service d'intérêts privés.
Ces pratiques d'extorsion ne sont pas de simples bavures : au vu de leur caractère systématique, il convient assurément de les avoir à l'esprit si l'on veut réformer en profondeur les appareils sécuritaires des pays en développement. Dans le même ordre d'idées, il importe également de dépasser les habituels lieux communs sur la prétendue " nouveauté " des phénomènes de privatisation de la sécurité depuis la fin de la guerre froide.
Historiquement, le monopole weberien de la " violence légitime " n'a été qu'une référence lointaine dans le cadre colonial d'États inachevés et jamais hégémoniques. Autrement dit, parler aujourd'hui d'une " privatisation " de la sécurité perd beaucoup de son sens quand on sait que les polices coloniales défendaient déjà les intérêts d'une frange minoritaire de la population, à défaut d'avoir été conçues comme un véritable service public.
Elles ne sont ni récentes, ni limitées géographiquement. De façon empirique, le visiteur de passage ou l'expatrié ne peut certainement pas les ignorer. Les check points de police qui lui barrent la route sont bien visibles. Appelés bouchons en Afrique francophone, ils mettent en évidence toute une économie politique de la violence et du racket qui consiste à rançonner la population au nom de l'État et au service d'intérêts privés.
Ces pratiques d'extorsion ne sont pas de simples bavures : au vu de leur caractère systématique, il convient assurément de les avoir à l'esprit si l'on veut réformer en profondeur les appareils sécuritaires des pays en développement. Dans le même ordre d'idées, il importe également de dépasser les habituels lieux communs sur la prétendue " nouveauté " des phénomènes de privatisation de la sécurité depuis la fin de la guerre froide.
Historiquement, le monopole weberien de la " violence légitime " n'a été qu'une référence lointaine dans le cadre colonial d'États inachevés et jamais hégémoniques. Autrement dit, parler aujourd'hui d'une " privatisation " de la sécurité perd beaucoup de son sens quand on sait que les polices coloniales défendaient déjà les intérêts d'une frange minoritaire de la population, à défaut d'avoir été conçues comme un véritable service public.
A partir d'exemples majoritairement puisés en Afrique noire, ce livre analyse les dilemmes de la sécurité publique dans les États faibles. Il montre notamment que si les polices des pays en développement sont rarement considérées comme des objets de recherche dignes de considération, elles constituent en fait un enjeu fondamental de la construction de l'État. Leurs défaillances relèvent en effet de problèmes structurels et pas seulement conjoncturels.
Elles ne sont ni récentes, ni limitées géographiquement. De façon empirique, le visiteur de passage ou l'expatrié ne peut certainement pas les ignorer. Les check points de police qui lui barrent la route sont bien visibles. Appelés bouchons en Afrique francophone, ils mettent en évidence toute une économie politique de la violence et du racket qui consiste à rançonner la population au nom de l'État et au service d'intérêts privés.
Ces pratiques d'extorsion ne sont pas de simples bavures : au vu de leur caractère systématique, il convient assurément de les avoir à l'esprit si l'on veut réformer en profondeur les appareils sécuritaires des pays en développement. Dans le même ordre d'idées, il importe également de dépasser les habituels lieux communs sur la prétendue " nouveauté " des phénomènes de privatisation de la sécurité depuis la fin de la guerre froide.
Historiquement, le monopole weberien de la " violence légitime " n'a été qu'une référence lointaine dans le cadre colonial d'États inachevés et jamais hégémoniques. Autrement dit, parler aujourd'hui d'une " privatisation " de la sécurité perd beaucoup de son sens quand on sait que les polices coloniales défendaient déjà les intérêts d'une frange minoritaire de la population, à défaut d'avoir été conçues comme un véritable service public.
Elles ne sont ni récentes, ni limitées géographiquement. De façon empirique, le visiteur de passage ou l'expatrié ne peut certainement pas les ignorer. Les check points de police qui lui barrent la route sont bien visibles. Appelés bouchons en Afrique francophone, ils mettent en évidence toute une économie politique de la violence et du racket qui consiste à rançonner la population au nom de l'État et au service d'intérêts privés.
Ces pratiques d'extorsion ne sont pas de simples bavures : au vu de leur caractère systématique, il convient assurément de les avoir à l'esprit si l'on veut réformer en profondeur les appareils sécuritaires des pays en développement. Dans le même ordre d'idées, il importe également de dépasser les habituels lieux communs sur la prétendue " nouveauté " des phénomènes de privatisation de la sécurité depuis la fin de la guerre froide.
Historiquement, le monopole weberien de la " violence légitime " n'a été qu'une référence lointaine dans le cadre colonial d'États inachevés et jamais hégémoniques. Autrement dit, parler aujourd'hui d'une " privatisation " de la sécurité perd beaucoup de son sens quand on sait que les polices coloniales défendaient déjà les intérêts d'une frange minoritaire de la population, à défaut d'avoir été conçues comme un véritable service public.