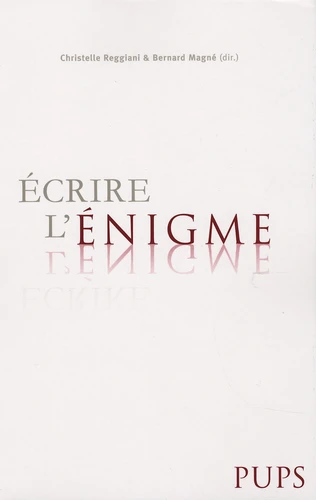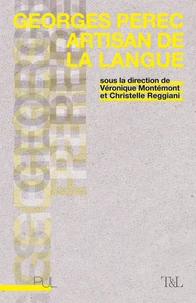Ecrire l'énigme
Par : ,Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages347
- PrésentationBroché
- Poids0.645 kg
- Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 2,0 cm
- ISBN978-2-84050-529-7
- EAN9782840505297
- Date de parution15/09/2007
- CollectionBibliothèque des styles
- ÉditeurPU Paris-Sorbonne
Résumé
Comment l'œuvre littéraire choisit-elle, le cas échéant, de donner forme à une énigme qui tend dès lors à tenir le discours, plus familier, du secret ? De fait, le goût des formes - structures, contraintes, figures...-qui caractérise toute une part de la littérature française du XXe siècle (prose et vers), loin de renoncer à la définition subjective que l'esthétique romantique avait proposée de l'œuvre d'art, donne à la subjectivité de l'auteur une existence précisément formelle, telle structure énonçant énigmatiquement un discours intime. A l'imaginaire vertical du texte bien décrit par Mallarmé dans " Le Mystère des lettres " (le " soupçon " d'un " trésor " mystérieux naît de la perception incertaine d'une " miroitement en dessous ") s'associent alors quelques figures architecturales : celle du mémorial, de la crypte, ou du tombeau. Ces questions de poétique impliquent plus largement le problème, historique, de la définition des différents régimes de littérarité, la littérature contemporaine apparaissant ainsi comme un discours fondamentalement paradoxal, une adresse toujours problématique engageant une rhétorique véritablement, et radicalement, " restreinte ". le texte énigmatique, en effet, ne suppose une connivence - confiant son secret au " suffisant lecteur " capable de l'entendre - que pour prononcer ce faisant l'exclusion, complémentaire, des lecteurs moins " malins " jusqu'à risquer, parfois, de refermer l'œuvre sur le cercle intime d'une communauté absolument privée. Il s'agit en somme de reprendre à nouveaux frais (historiques, théoriques aussi bien qu'esthétiques) la réflexion sur le formalisme du siècle dernier - les œuvres de George Perec et de Jacques Roubaud représentant alors des points de repère commodes, en même temps que des postes d'observation efficaces, sans que ces exemples privilégiés excluent pour autant d'autres auteurs, d'autres poétiques (en l'occurrence, de Victor Hugo à Jean-Marie Gleize).
Comment l'œuvre littéraire choisit-elle, le cas échéant, de donner forme à une énigme qui tend dès lors à tenir le discours, plus familier, du secret ? De fait, le goût des formes - structures, contraintes, figures...-qui caractérise toute une part de la littérature française du XXe siècle (prose et vers), loin de renoncer à la définition subjective que l'esthétique romantique avait proposée de l'œuvre d'art, donne à la subjectivité de l'auteur une existence précisément formelle, telle structure énonçant énigmatiquement un discours intime. A l'imaginaire vertical du texte bien décrit par Mallarmé dans " Le Mystère des lettres " (le " soupçon " d'un " trésor " mystérieux naît de la perception incertaine d'une " miroitement en dessous ") s'associent alors quelques figures architecturales : celle du mémorial, de la crypte, ou du tombeau. Ces questions de poétique impliquent plus largement le problème, historique, de la définition des différents régimes de littérarité, la littérature contemporaine apparaissant ainsi comme un discours fondamentalement paradoxal, une adresse toujours problématique engageant une rhétorique véritablement, et radicalement, " restreinte ". le texte énigmatique, en effet, ne suppose une connivence - confiant son secret au " suffisant lecteur " capable de l'entendre - que pour prononcer ce faisant l'exclusion, complémentaire, des lecteurs moins " malins " jusqu'à risquer, parfois, de refermer l'œuvre sur le cercle intime d'une communauté absolument privée. Il s'agit en somme de reprendre à nouveaux frais (historiques, théoriques aussi bien qu'esthétiques) la réflexion sur le formalisme du siècle dernier - les œuvres de George Perec et de Jacques Roubaud représentant alors des points de repère commodes, en même temps que des postes d'observation efficaces, sans que ces exemples privilégiés excluent pour autant d'autres auteurs, d'autres poétiques (en l'occurrence, de Victor Hugo à Jean-Marie Gleize).