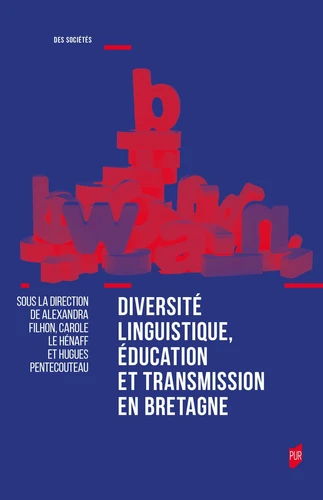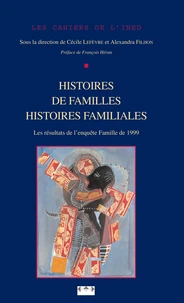Diversité linguistique, éducation et transmission en Bretagne
Par : , ,Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 27 novembreCet article sera commandé chez un fournisseur et vous sera envoyé 5 jours après la date de votre commande.
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 27 novembre
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages303
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.498 kg
- Dimensions15,4 cm × 23,9 cm × 2,5 cm
- ISBN978-2-7535-9885-0
- EAN9782753598850
- Date de parution18/09/2025
- CollectionDes Sociétés
- ÉditeurPU Rennes
Résumé
Face au monolinguisme officiel affiché, la France donne à voir une grande diversité de langues apprises, parlées et transmises au gré des générations. Le plurilinguisme est pourtant une réalité encore peu appréhendée : comment apprend-on à parler une autre langue que le français ? Dans quels contextes ? Avec qui ? Pour quelles finalités ? Outre le français, les langues de Bretagne se composent de deux langues endogènes que sont le gallo et le breton et de langues apportées par l'immigration telles l'arabe, le turc ou encore le portugais.
Il s'agit de langues minorées, au regard de la langue nationale hégémonique, dont il convient de saisir les ressorts de leur maintien sur le territoire breton. L'ambition du livre est de comprendre comment la diversité linguistique et culturelle prend forme et se transforme dans un contexte social et politique français qui ne la favorise pas toujours. En interrogeant cette diversité linguistique du paysage breton, l'ouvrage tente de penser les modes de transmission et d'éducation des populations bretonnes à partir de trois orientations complémentaires : les politiques scolaires, la famille et l'école.
Il s'agit de langues minorées, au regard de la langue nationale hégémonique, dont il convient de saisir les ressorts de leur maintien sur le territoire breton. L'ambition du livre est de comprendre comment la diversité linguistique et culturelle prend forme et se transforme dans un contexte social et politique français qui ne la favorise pas toujours. En interrogeant cette diversité linguistique du paysage breton, l'ouvrage tente de penser les modes de transmission et d'éducation des populations bretonnes à partir de trois orientations complémentaires : les politiques scolaires, la famille et l'école.
Face au monolinguisme officiel affiché, la France donne à voir une grande diversité de langues apprises, parlées et transmises au gré des générations. Le plurilinguisme est pourtant une réalité encore peu appréhendée : comment apprend-on à parler une autre langue que le français ? Dans quels contextes ? Avec qui ? Pour quelles finalités ? Outre le français, les langues de Bretagne se composent de deux langues endogènes que sont le gallo et le breton et de langues apportées par l'immigration telles l'arabe, le turc ou encore le portugais.
Il s'agit de langues minorées, au regard de la langue nationale hégémonique, dont il convient de saisir les ressorts de leur maintien sur le territoire breton. L'ambition du livre est de comprendre comment la diversité linguistique et culturelle prend forme et se transforme dans un contexte social et politique français qui ne la favorise pas toujours. En interrogeant cette diversité linguistique du paysage breton, l'ouvrage tente de penser les modes de transmission et d'éducation des populations bretonnes à partir de trois orientations complémentaires : les politiques scolaires, la famille et l'école.
Il s'agit de langues minorées, au regard de la langue nationale hégémonique, dont il convient de saisir les ressorts de leur maintien sur le territoire breton. L'ambition du livre est de comprendre comment la diversité linguistique et culturelle prend forme et se transforme dans un contexte social et politique français qui ne la favorise pas toujours. En interrogeant cette diversité linguistique du paysage breton, l'ouvrage tente de penser les modes de transmission et d'éducation des populations bretonnes à partir de trois orientations complémentaires : les politiques scolaires, la famille et l'école.