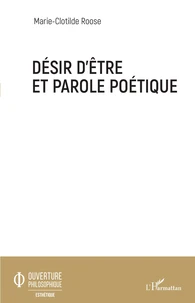La parole poétique jaillit-elle du désir d'être ? Pour y répondre, plusieurs méthodologies entrent en dialogue. La phénoménologie de Mikel Dufrenne est confrontée à la lecture de poètes choisis : Y. Bonnefoy, Ph. Jaccottet, R. Juarroz, F. lacgmin, A. Reniers. L'expérience poétique est décrite par Dufrenne, définie, pour en analyser les conditions de possibilité, et formuler l'hypothèse de son origine, s'inspirant de Spinoza lu par Schelling : une Nature au double visage, tantôt bienveillant tantôt aveugle.
Ici la tentation métaphysique de passer du transcendantal à l'ontologique fait l'objet d'une critique, mettant en cause la spéculation utopique, outrepassant les limites de l'expérience et la parole singulière des poèmes, pour les englober dans un système moniste, qui sous-estime la place de la liberté humaine, et sa responsabilité dans la création d'une culture. La question vise alors l'éthique du désir du sujet, auquel répond l'éclairage de psychanalystes (J.
Triol, D. Vasse, A. Didier-Weill, ...). Enfin, la nature du désir d'être se précise à l'écoute des textes des poètes. Tension entre éros et thanatos, le désir d'être témoigne chez le sujet d'un écart différentiel originaire autorisant l'expression symbolique et poétique. Lorsqu'il participe de l'agapê, le désir d'être se révèle comme assomption d'une finitude et acquiescement au don infini de l'Autre.
La parole poétique jaillit-elle du désir d'être ? Pour y répondre, plusieurs méthodologies entrent en dialogue. La phénoménologie de Mikel Dufrenne est confrontée à la lecture de poètes choisis : Y. Bonnefoy, Ph. Jaccottet, R. Juarroz, F. lacgmin, A. Reniers. L'expérience poétique est décrite par Dufrenne, définie, pour en analyser les conditions de possibilité, et formuler l'hypothèse de son origine, s'inspirant de Spinoza lu par Schelling : une Nature au double visage, tantôt bienveillant tantôt aveugle.
Ici la tentation métaphysique de passer du transcendantal à l'ontologique fait l'objet d'une critique, mettant en cause la spéculation utopique, outrepassant les limites de l'expérience et la parole singulière des poèmes, pour les englober dans un système moniste, qui sous-estime la place de la liberté humaine, et sa responsabilité dans la création d'une culture. La question vise alors l'éthique du désir du sujet, auquel répond l'éclairage de psychanalystes (J.
Triol, D. Vasse, A. Didier-Weill, ...). Enfin, la nature du désir d'être se précise à l'écoute des textes des poètes. Tension entre éros et thanatos, le désir d'être témoigne chez le sujet d'un écart différentiel originaire autorisant l'expression symbolique et poétique. Lorsqu'il participe de l'agapê, le désir d'être se révèle comme assomption d'une finitude et acquiescement au don infini de l'Autre.