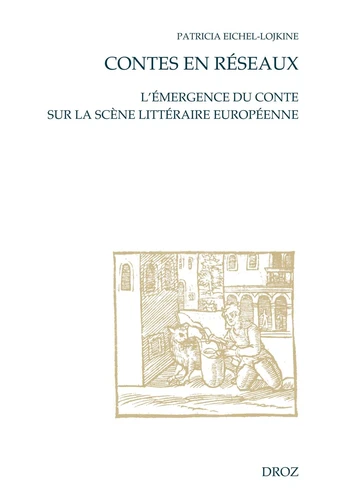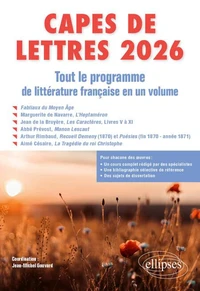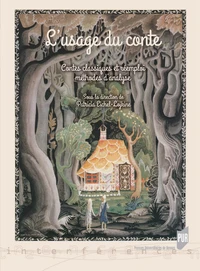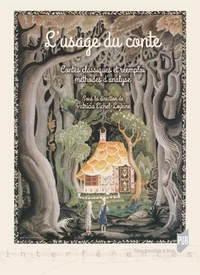Contes en réseaux. L'émergence du conte sur la scène littéraire européenne
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Nombre de pages464
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.66 kg
- Dimensions15,0 cm × 22,0 cm × 3,5 cm
- ISBN978-2-600-01615-5
- EAN9782600016155
- Date de parution01/04/2013
- CollectionLes seuils de la modernité
- ÉditeurDroz
Résumé
Loin d'être un genre hors du temps, le conte émerge dans l'Europe pré-moderne à partir de chassés-croisés entre l'oralité et l'écrit, et de transferts culturels entre l'Orient et l'Occident. L'analyse de ses structures et de son devenir historique requiert une méthode qui prenne en considération les phénomènes de variance et de rémanence propres à ce corpus. Les contes se développent en arborescence et constituent des réseaux de motifs, de figures et de séquences narratives.
Le phénomène apparaît encore plus clairement lorsque des récits parallèles sont parvenus jusqu'à nous. "Costantino Fortunato" de Straparola, sa traduction par Larivey et "Cagliuso" de Basile ont précédé "Le Maître Chat ou le Chat botté" de Perrault. De même, la "Belle aux Cheveux d'Or" de Mme d'Aulnoy gagne à être lue en parallèle avec le "Livoretto" de Straparola et un curieux conte en ancien yiddish (1602).
Ces histoires, comme les images qui les illustrent, ont en commun le motif de l'entraide entre l'homme et l'animal, hérité de lointains récits de sagesse comme Kalila et Dimna. L'homme n'est pas plus isolé au sein de la Création que le récit au sein du maillage serré des contes.
Le phénomène apparaît encore plus clairement lorsque des récits parallèles sont parvenus jusqu'à nous. "Costantino Fortunato" de Straparola, sa traduction par Larivey et "Cagliuso" de Basile ont précédé "Le Maître Chat ou le Chat botté" de Perrault. De même, la "Belle aux Cheveux d'Or" de Mme d'Aulnoy gagne à être lue en parallèle avec le "Livoretto" de Straparola et un curieux conte en ancien yiddish (1602).
Ces histoires, comme les images qui les illustrent, ont en commun le motif de l'entraide entre l'homme et l'animal, hérité de lointains récits de sagesse comme Kalila et Dimna. L'homme n'est pas plus isolé au sein de la Création que le récit au sein du maillage serré des contes.
Loin d'être un genre hors du temps, le conte émerge dans l'Europe pré-moderne à partir de chassés-croisés entre l'oralité et l'écrit, et de transferts culturels entre l'Orient et l'Occident. L'analyse de ses structures et de son devenir historique requiert une méthode qui prenne en considération les phénomènes de variance et de rémanence propres à ce corpus. Les contes se développent en arborescence et constituent des réseaux de motifs, de figures et de séquences narratives.
Le phénomène apparaît encore plus clairement lorsque des récits parallèles sont parvenus jusqu'à nous. "Costantino Fortunato" de Straparola, sa traduction par Larivey et "Cagliuso" de Basile ont précédé "Le Maître Chat ou le Chat botté" de Perrault. De même, la "Belle aux Cheveux d'Or" de Mme d'Aulnoy gagne à être lue en parallèle avec le "Livoretto" de Straparola et un curieux conte en ancien yiddish (1602).
Ces histoires, comme les images qui les illustrent, ont en commun le motif de l'entraide entre l'homme et l'animal, hérité de lointains récits de sagesse comme Kalila et Dimna. L'homme n'est pas plus isolé au sein de la Création que le récit au sein du maillage serré des contes.
Le phénomène apparaît encore plus clairement lorsque des récits parallèles sont parvenus jusqu'à nous. "Costantino Fortunato" de Straparola, sa traduction par Larivey et "Cagliuso" de Basile ont précédé "Le Maître Chat ou le Chat botté" de Perrault. De même, la "Belle aux Cheveux d'Or" de Mme d'Aulnoy gagne à être lue en parallèle avec le "Livoretto" de Straparola et un curieux conte en ancien yiddish (1602).
Ces histoires, comme les images qui les illustrent, ont en commun le motif de l'entraide entre l'homme et l'animal, hérité de lointains récits de sagesse comme Kalila et Dimna. L'homme n'est pas plus isolé au sein de la Création que le récit au sein du maillage serré des contes.