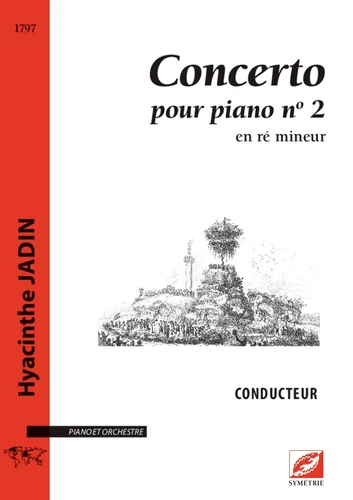Hyacinthe Jadin (1785-1800) est né dans une famille de musiciens dont plusieurs membres ont été compositeurs : François, Jean, Louis Emmanuel, appelé couramment Louis. Élève de son père François, Hyacinthe a pris ensuite des leçons de Nicolas Hüllmandel, pianiste et compositeur alsacien qui avait étudié à Hambourg, dit-on, sous la direction de Carl Philipp Emanuel Bach, fils de Johann Sebastian. Précoce, Hyacinthe compose dès l'âge de neuf ans. Dix ans avant lui, la grande compositrice Hélène de Montgeroult avait suivi l'enseignement du même professeur, qui avait déclaré au bout d'un an, alors qu'elle n'avait que treize ans, qu'il n'avait plus rien à lui apprendre. Voilà donc deux "prodiges de leur âge" qui émergent quelques années après Mozart, et quelques années avant Mendelssohn, Liszt et Chopin. Hyacinthe Jadin joue un de ses concertos pour piano au Concert spirituel en 1789, à treize ans. C'est déjà une consécration, tant la réputation de cette institution est grande en France et en Europe. Jérôme Dorival
Concerto pour piano et orchestre n°2 (conducteur A3). en ré mineur
Par : ,Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Nombre de pages72
- PrésentationBroché
- Poids0.25 kg
- Dimensions29,7 cm × 42,0 cm × 1,5 cm
- ISBN978-2-36485-093-4
- EAN9782364850934
- Date de parution01/09/2020
- ÉditeurSymétrie
Résumé
Le Concerto pour piano et orchestre n°2 de Hyacinthe Jadin (1776-1800) adopte la tonalité de ré mineur pour les premier et troisième mouvements, et si bémol majeur pour le second. L'orchestre, assez fourni, comporte 2 flûtes, 2 hautbois, 2 bassons, 2 cors et les cordes (violons 1 et 2, altos, violoncelles et basses). L'Allegro moderato qui ouvre le concerto adopte la forme sonate, avec le premier thème en ré mineur, suivi par un pont (mesure 22) qui amène le second thème en fa majeur (mesure 30).
Après l'introduction orchestrale, le piano entre à la mesure 72 et développe le premier thème, puis le second (mesure 110). La réexposition a lieu à la mesure 283, selon un schéma qui pourrait paraître classique. Il ne l'est pas, cependant, car le développement se construit autour d'un nouveau thème en ut majeur (mesure 209), et que la réexposition redonne le second thème, qu'on entend en ré mineur, tandis que le premier ne réapparaît pas ! L'Adagio à quatre temps s'apparente davantage à une aria d'opéra où le piano développe des arabesques subtiles et des ornementations finement ciselées.
L'Allegro final associerait un rondeau à la française à deux couplets avec un esprit d'alla polacca très fréquent à cette époque (Deuxième Concerto pour clarinette de Weber, Triple Concerto de Beethoven), s'il n'était à quatre temps ! On ne peut manquer de souligner l'originalité des conceptions musicales de Jadin, mais aussi la finesse et la souplesse de son écriture pianistique. L'orchestre n'est jamais écrasant, ce qui n'empêche pas le compositeur de mettre en valeur les couleurs instrumentales.
Son sens de l'harmonie, tout en délicatesse, construit un parcours qui intéresse toujours l'oreille en se combinant à merveille avec la logique de construction qu'imposent les thèmes. Nul doute que Jadin a bien appris de Haydn, et peut-être même de Mozart. Jérôme Dorival
Après l'introduction orchestrale, le piano entre à la mesure 72 et développe le premier thème, puis le second (mesure 110). La réexposition a lieu à la mesure 283, selon un schéma qui pourrait paraître classique. Il ne l'est pas, cependant, car le développement se construit autour d'un nouveau thème en ut majeur (mesure 209), et que la réexposition redonne le second thème, qu'on entend en ré mineur, tandis que le premier ne réapparaît pas ! L'Adagio à quatre temps s'apparente davantage à une aria d'opéra où le piano développe des arabesques subtiles et des ornementations finement ciselées.
L'Allegro final associerait un rondeau à la française à deux couplets avec un esprit d'alla polacca très fréquent à cette époque (Deuxième Concerto pour clarinette de Weber, Triple Concerto de Beethoven), s'il n'était à quatre temps ! On ne peut manquer de souligner l'originalité des conceptions musicales de Jadin, mais aussi la finesse et la souplesse de son écriture pianistique. L'orchestre n'est jamais écrasant, ce qui n'empêche pas le compositeur de mettre en valeur les couleurs instrumentales.
Son sens de l'harmonie, tout en délicatesse, construit un parcours qui intéresse toujours l'oreille en se combinant à merveille avec la logique de construction qu'imposent les thèmes. Nul doute que Jadin a bien appris de Haydn, et peut-être même de Mozart. Jérôme Dorival
Le Concerto pour piano et orchestre n°2 de Hyacinthe Jadin (1776-1800) adopte la tonalité de ré mineur pour les premier et troisième mouvements, et si bémol majeur pour le second. L'orchestre, assez fourni, comporte 2 flûtes, 2 hautbois, 2 bassons, 2 cors et les cordes (violons 1 et 2, altos, violoncelles et basses). L'Allegro moderato qui ouvre le concerto adopte la forme sonate, avec le premier thème en ré mineur, suivi par un pont (mesure 22) qui amène le second thème en fa majeur (mesure 30).
Après l'introduction orchestrale, le piano entre à la mesure 72 et développe le premier thème, puis le second (mesure 110). La réexposition a lieu à la mesure 283, selon un schéma qui pourrait paraître classique. Il ne l'est pas, cependant, car le développement se construit autour d'un nouveau thème en ut majeur (mesure 209), et que la réexposition redonne le second thème, qu'on entend en ré mineur, tandis que le premier ne réapparaît pas ! L'Adagio à quatre temps s'apparente davantage à une aria d'opéra où le piano développe des arabesques subtiles et des ornementations finement ciselées.
L'Allegro final associerait un rondeau à la française à deux couplets avec un esprit d'alla polacca très fréquent à cette époque (Deuxième Concerto pour clarinette de Weber, Triple Concerto de Beethoven), s'il n'était à quatre temps ! On ne peut manquer de souligner l'originalité des conceptions musicales de Jadin, mais aussi la finesse et la souplesse de son écriture pianistique. L'orchestre n'est jamais écrasant, ce qui n'empêche pas le compositeur de mettre en valeur les couleurs instrumentales.
Son sens de l'harmonie, tout en délicatesse, construit un parcours qui intéresse toujours l'oreille en se combinant à merveille avec la logique de construction qu'imposent les thèmes. Nul doute que Jadin a bien appris de Haydn, et peut-être même de Mozart. Jérôme Dorival
Après l'introduction orchestrale, le piano entre à la mesure 72 et développe le premier thème, puis le second (mesure 110). La réexposition a lieu à la mesure 283, selon un schéma qui pourrait paraître classique. Il ne l'est pas, cependant, car le développement se construit autour d'un nouveau thème en ut majeur (mesure 209), et que la réexposition redonne le second thème, qu'on entend en ré mineur, tandis que le premier ne réapparaît pas ! L'Adagio à quatre temps s'apparente davantage à une aria d'opéra où le piano développe des arabesques subtiles et des ornementations finement ciselées.
L'Allegro final associerait un rondeau à la française à deux couplets avec un esprit d'alla polacca très fréquent à cette époque (Deuxième Concerto pour clarinette de Weber, Triple Concerto de Beethoven), s'il n'était à quatre temps ! On ne peut manquer de souligner l'originalité des conceptions musicales de Jadin, mais aussi la finesse et la souplesse de son écriture pianistique. L'orchestre n'est jamais écrasant, ce qui n'empêche pas le compositeur de mettre en valeur les couleurs instrumentales.
Son sens de l'harmonie, tout en délicatesse, construit un parcours qui intéresse toujours l'oreille en se combinant à merveille avec la logique de construction qu'imposent les thèmes. Nul doute que Jadin a bien appris de Haydn, et peut-être même de Mozart. Jérôme Dorival