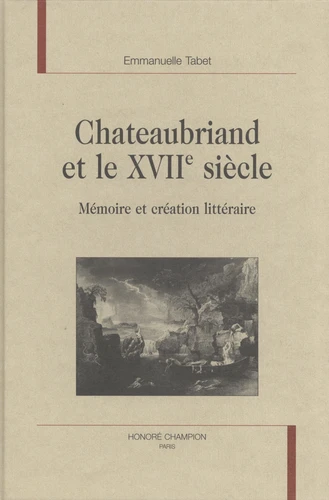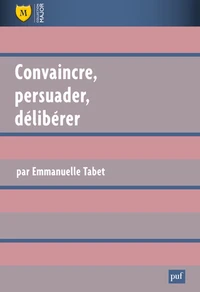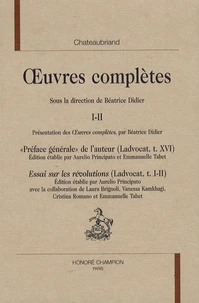Chateaubriand et le XVIIe siècle. Mémoire et création littéraire
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Nombre de pages461
- PrésentationRelié
- FormatGrand Format
- Poids0.645 kg
- Dimensions16,5 cm × 24,0 cm × 2,5 cm
- ISBN2-7453-0644-8
- EAN9782745306449
- Date de parution01/01/2002
- CollectionLumière classique
- ÉditeurHonoré Champion
Résumé
L'oeuvre de Chateaubriand est marquée par sa profonde fascination pour le XVIIe siècle. Le Génie du christianisme s'ouvre en effet sur l'éloquent éloge de la mémoire du Grand Siècle chrétien ; et ce dialogue constant se poursuit tout au long de l'oeuvre jusqu'à son ultime aboutissement, la Vie de Rancé, où le désert de La Trappe voit défiler les grandes figures du siècle. Cette étude ne nous informe pas seulement sur les positions de l'écrivain, mais elle propose plus largement, à travers son oeuvre, une véritable relecture du XVIIe siècle et un examen de ses survivances au XIXe.
La mémoire du siècle classique fut en effet pour Chateaubriand non le signe d'un passéisme stérile mais une mémoire vivante qui devait informer tant son style que son imaginaire. L'auteur met ainsi en lumière la trace littéraire profonde qu'ont laissée la représentation racinienne des passions humaines, les descriptions féneloniennes d'une Antiquité religieusement païenne, le vaste "obituaire" des Mémoires de Saint-Simon, la méditation de Bossuet sur le néant des empires ou encore l'analyse du coeur humain développée par Massillon.
L'apport de cet ouvrage est aussi de replacer dans le temps long de l'augustinisme littéraire certains des traits essentiels du romantisme : le "vague des passions" et la mélancolie devenue le signe d'un. manque ontologique, d'un malheur naturel à l'homme ; l'inquiétude du moi incapable de trouver sa place dans le siècle ; la méditation angoissée sur un temps fragmentaire et discontinu ; la réflexion sur la Providence, infléchie en nécessité historique ; l'omniprésence du memento mori et des grandes figures de vanités littéraires.
La mémoire du siècle classique fut en effet pour Chateaubriand non le signe d'un passéisme stérile mais une mémoire vivante qui devait informer tant son style que son imaginaire. L'auteur met ainsi en lumière la trace littéraire profonde qu'ont laissée la représentation racinienne des passions humaines, les descriptions féneloniennes d'une Antiquité religieusement païenne, le vaste "obituaire" des Mémoires de Saint-Simon, la méditation de Bossuet sur le néant des empires ou encore l'analyse du coeur humain développée par Massillon.
L'apport de cet ouvrage est aussi de replacer dans le temps long de l'augustinisme littéraire certains des traits essentiels du romantisme : le "vague des passions" et la mélancolie devenue le signe d'un. manque ontologique, d'un malheur naturel à l'homme ; l'inquiétude du moi incapable de trouver sa place dans le siècle ; la méditation angoissée sur un temps fragmentaire et discontinu ; la réflexion sur la Providence, infléchie en nécessité historique ; l'omniprésence du memento mori et des grandes figures de vanités littéraires.
L'oeuvre de Chateaubriand est marquée par sa profonde fascination pour le XVIIe siècle. Le Génie du christianisme s'ouvre en effet sur l'éloquent éloge de la mémoire du Grand Siècle chrétien ; et ce dialogue constant se poursuit tout au long de l'oeuvre jusqu'à son ultime aboutissement, la Vie de Rancé, où le désert de La Trappe voit défiler les grandes figures du siècle. Cette étude ne nous informe pas seulement sur les positions de l'écrivain, mais elle propose plus largement, à travers son oeuvre, une véritable relecture du XVIIe siècle et un examen de ses survivances au XIXe.
La mémoire du siècle classique fut en effet pour Chateaubriand non le signe d'un passéisme stérile mais une mémoire vivante qui devait informer tant son style que son imaginaire. L'auteur met ainsi en lumière la trace littéraire profonde qu'ont laissée la représentation racinienne des passions humaines, les descriptions féneloniennes d'une Antiquité religieusement païenne, le vaste "obituaire" des Mémoires de Saint-Simon, la méditation de Bossuet sur le néant des empires ou encore l'analyse du coeur humain développée par Massillon.
L'apport de cet ouvrage est aussi de replacer dans le temps long de l'augustinisme littéraire certains des traits essentiels du romantisme : le "vague des passions" et la mélancolie devenue le signe d'un. manque ontologique, d'un malheur naturel à l'homme ; l'inquiétude du moi incapable de trouver sa place dans le siècle ; la méditation angoissée sur un temps fragmentaire et discontinu ; la réflexion sur la Providence, infléchie en nécessité historique ; l'omniprésence du memento mori et des grandes figures de vanités littéraires.
La mémoire du siècle classique fut en effet pour Chateaubriand non le signe d'un passéisme stérile mais une mémoire vivante qui devait informer tant son style que son imaginaire. L'auteur met ainsi en lumière la trace littéraire profonde qu'ont laissée la représentation racinienne des passions humaines, les descriptions féneloniennes d'une Antiquité religieusement païenne, le vaste "obituaire" des Mémoires de Saint-Simon, la méditation de Bossuet sur le néant des empires ou encore l'analyse du coeur humain développée par Massillon.
L'apport de cet ouvrage est aussi de replacer dans le temps long de l'augustinisme littéraire certains des traits essentiels du romantisme : le "vague des passions" et la mélancolie devenue le signe d'un. manque ontologique, d'un malheur naturel à l'homme ; l'inquiétude du moi incapable de trouver sa place dans le siècle ; la méditation angoissée sur un temps fragmentaire et discontinu ; la réflexion sur la Providence, infléchie en nécessité historique ; l'omniprésence du memento mori et des grandes figures de vanités littéraires.