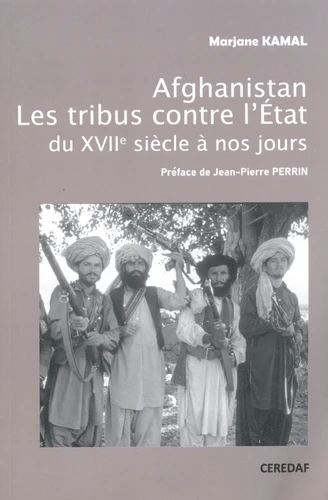Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages366
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.73 kg
- Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 1,5 cm
- ISBN978-2-906657-41-0
- EAN9782906657410
- Date de parution22/02/2021
- ÉditeurCEREDAF
- PréfacierJean-Pierre Perrin
Résumé
Les ouvrages sur l'Afghanistan contemporain sont nombreux. Celui-ci est unique, évoquant l'histoire du pays dès ses origines pour détailler la formation de la nation afghane. Pays d'Asie centrale, soumis aux influences de la Perse, du sous-continent indien et des sociétés nomades des steppes, l'Afghanistan est composé de populations variées. La constitution d'un Etat afghan depuis le XVIIIe siècle a dû vaincre les habitudes d'autonomie des régions de ce pays largement montagneux et sans débouchés sur l'Océan, où le nomadisme pastoral gardait une place primordiale.
Dans ce long processus, les tribus afghanes pachtounes ont joué un rôle essentiel : celles liées à la royauté, désireuses de centralisation et de relations fructueuses avec l'Emir, les autres désireuses de conserver leur indépendance et leurs coutumes ancestrales. L'Histoire se répète. Le conflit actuel vient essentiellement du désir des campagnes et des tribus non dominantes de préserver leur autonomie, leur loi et leur foi, face au gouvernement citadin et centralisateur de Kaboul.
Et l'Afghanistan est plus que jamais dépendant des puissances régionales et internationales, de leurs influences contradictoires et de leurs financements.
Dans ce long processus, les tribus afghanes pachtounes ont joué un rôle essentiel : celles liées à la royauté, désireuses de centralisation et de relations fructueuses avec l'Emir, les autres désireuses de conserver leur indépendance et leurs coutumes ancestrales. L'Histoire se répète. Le conflit actuel vient essentiellement du désir des campagnes et des tribus non dominantes de préserver leur autonomie, leur loi et leur foi, face au gouvernement citadin et centralisateur de Kaboul.
Et l'Afghanistan est plus que jamais dépendant des puissances régionales et internationales, de leurs influences contradictoires et de leurs financements.
Les ouvrages sur l'Afghanistan contemporain sont nombreux. Celui-ci est unique, évoquant l'histoire du pays dès ses origines pour détailler la formation de la nation afghane. Pays d'Asie centrale, soumis aux influences de la Perse, du sous-continent indien et des sociétés nomades des steppes, l'Afghanistan est composé de populations variées. La constitution d'un Etat afghan depuis le XVIIIe siècle a dû vaincre les habitudes d'autonomie des régions de ce pays largement montagneux et sans débouchés sur l'Océan, où le nomadisme pastoral gardait une place primordiale.
Dans ce long processus, les tribus afghanes pachtounes ont joué un rôle essentiel : celles liées à la royauté, désireuses de centralisation et de relations fructueuses avec l'Emir, les autres désireuses de conserver leur indépendance et leurs coutumes ancestrales. L'Histoire se répète. Le conflit actuel vient essentiellement du désir des campagnes et des tribus non dominantes de préserver leur autonomie, leur loi et leur foi, face au gouvernement citadin et centralisateur de Kaboul.
Et l'Afghanistan est plus que jamais dépendant des puissances régionales et internationales, de leurs influences contradictoires et de leurs financements.
Dans ce long processus, les tribus afghanes pachtounes ont joué un rôle essentiel : celles liées à la royauté, désireuses de centralisation et de relations fructueuses avec l'Emir, les autres désireuses de conserver leur indépendance et leurs coutumes ancestrales. L'Histoire se répète. Le conflit actuel vient essentiellement du désir des campagnes et des tribus non dominantes de préserver leur autonomie, leur loi et leur foi, face au gouvernement citadin et centralisateur de Kaboul.
Et l'Afghanistan est plus que jamais dépendant des puissances régionales et internationales, de leurs influences contradictoires et de leurs financements.
Avis des lecteursCommentaires laissés par nos lecteurs
5/5