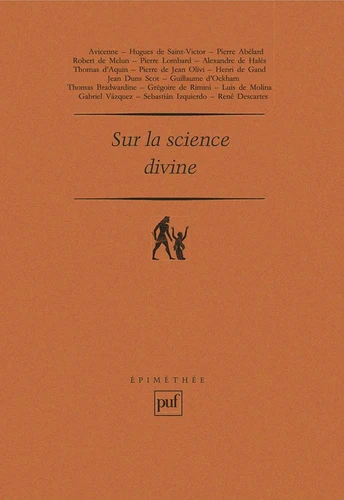Sur la science divine
Par : , ,Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages470
- PrésentationBroché
- Poids0.66 kg
- Dimensions15,0 cm × 22,0 cm × 3,0 cm
- ISBN2-13-051105-8
- EAN9782130511052
- Date de parution17/09/2002
- CollectionEpiméthée
- ÉditeurPUF
- AuteurRémi Brague
- AuteurVincent Carraud
- AuteurMarc Ozilou
Résumé
Philosophes et théologiens s'accordent pour reconnaître à Dieu la connaissance de soi. Mais Dieu pense-t-il ce qui est autre que lui ? Connaît-il l'impossible, le faux, le mal ou les fictions ? Sa science infaillible des futurs contingents détruit-elle la liberté humaine ? Avec ces questions, théologie et philosophie entrent en un dialogue tourmenté mais fécond. D'Avicenne à Descartes, en passant par Thomas d'Acquin, Duns Scot, Ockham et Molina, mais aussi par des auteurs inédits ou mal connus, tels Robert de Melun, Olivi ou Izquierdo, cet ensemble de traductions inédites, présentées et annotées, esquisse une histoire des variations de la science divine qui change constamment de visage.
Ainsi les modèles néoplatoniciens reçus de la pensée antique subissent, du Moyen Age au XVIIe siècle, une inversion radicale : d'un Dieu qui ignore le monde ou ne le connaît qu'en se connaissant lui-même, on passe à un monde qui détient en soi sa vérité propre, devient la règle du savoir divin et finalement se dispense de Dieu. L'ancien savoir créateur et ordonnateur fait place à une science infinie, universelle et commune, que l'âge classique nommera " omniscience ".
Ce faisant, la science divine définit paradoxalement le modèle de la science humaine et de la philosophie à l'aube des temps modernes. Si la science ne convient plus à Dieu, c'est peut-être parce qu'elle en vient à revendiquer pour elle-même le privilège de la divinité. Ou qu'au contraire, elle s'avère trop humaine pour rester vraiment digne de Dieu.
Ainsi les modèles néoplatoniciens reçus de la pensée antique subissent, du Moyen Age au XVIIe siècle, une inversion radicale : d'un Dieu qui ignore le monde ou ne le connaît qu'en se connaissant lui-même, on passe à un monde qui détient en soi sa vérité propre, devient la règle du savoir divin et finalement se dispense de Dieu. L'ancien savoir créateur et ordonnateur fait place à une science infinie, universelle et commune, que l'âge classique nommera " omniscience ".
Ce faisant, la science divine définit paradoxalement le modèle de la science humaine et de la philosophie à l'aube des temps modernes. Si la science ne convient plus à Dieu, c'est peut-être parce qu'elle en vient à revendiquer pour elle-même le privilège de la divinité. Ou qu'au contraire, elle s'avère trop humaine pour rester vraiment digne de Dieu.
Philosophes et théologiens s'accordent pour reconnaître à Dieu la connaissance de soi. Mais Dieu pense-t-il ce qui est autre que lui ? Connaît-il l'impossible, le faux, le mal ou les fictions ? Sa science infaillible des futurs contingents détruit-elle la liberté humaine ? Avec ces questions, théologie et philosophie entrent en un dialogue tourmenté mais fécond. D'Avicenne à Descartes, en passant par Thomas d'Acquin, Duns Scot, Ockham et Molina, mais aussi par des auteurs inédits ou mal connus, tels Robert de Melun, Olivi ou Izquierdo, cet ensemble de traductions inédites, présentées et annotées, esquisse une histoire des variations de la science divine qui change constamment de visage.
Ainsi les modèles néoplatoniciens reçus de la pensée antique subissent, du Moyen Age au XVIIe siècle, une inversion radicale : d'un Dieu qui ignore le monde ou ne le connaît qu'en se connaissant lui-même, on passe à un monde qui détient en soi sa vérité propre, devient la règle du savoir divin et finalement se dispense de Dieu. L'ancien savoir créateur et ordonnateur fait place à une science infinie, universelle et commune, que l'âge classique nommera " omniscience ".
Ce faisant, la science divine définit paradoxalement le modèle de la science humaine et de la philosophie à l'aube des temps modernes. Si la science ne convient plus à Dieu, c'est peut-être parce qu'elle en vient à revendiquer pour elle-même le privilège de la divinité. Ou qu'au contraire, elle s'avère trop humaine pour rester vraiment digne de Dieu.
Ainsi les modèles néoplatoniciens reçus de la pensée antique subissent, du Moyen Age au XVIIe siècle, une inversion radicale : d'un Dieu qui ignore le monde ou ne le connaît qu'en se connaissant lui-même, on passe à un monde qui détient en soi sa vérité propre, devient la règle du savoir divin et finalement se dispense de Dieu. L'ancien savoir créateur et ordonnateur fait place à une science infinie, universelle et commune, que l'âge classique nommera " omniscience ".
Ce faisant, la science divine définit paradoxalement le modèle de la science humaine et de la philosophie à l'aube des temps modernes. Si la science ne convient plus à Dieu, c'est peut-être parce qu'elle en vient à revendiquer pour elle-même le privilège de la divinité. Ou qu'au contraire, elle s'avère trop humaine pour rester vraiment digne de Dieu.