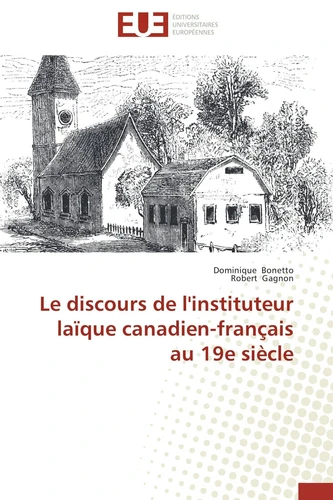L'auteur est montréalais et canadien-français d'origine. Après avoir complété un baccalauréat à l'Université du Québec à Montréal en histoire, avec une mineur en sciences politiques, il a achevé un mémoire de maîtrise en histoire de l'éducation au Québec, sous la direction de Robert Gagnon. Il s'agit de sa première publication.
Le discours de l'instituteur laïque canadien-français au 19e siècle
Par : ,Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Nombre de pages128
- PrésentationBroché
- FormatPoche
- Poids0.2 kg
- Dimensions15,0 cm × 22,0 cm × 0,0 cm
- ISBN978-3-8417-3803-5
- EAN9783841738035
- Date de parution16/09/2014
- CollectionOMN.UNIV.EUROP.
- ÉditeurUniv Européenne
Résumé
Cet ouvrage a pour objet l'étude du discours des instituteurs laïques franco-catholiques, dans le Québec de la seconde moitié du 19e siècle. Ce discours, orienté vers l'identité professionnelle que le groupe cherche à se construire, se développe en même temps qu'est publiquement remis en cause l'investissement de l'Etat dans un secteur que plusieurs jugent encore de la responsabilité exclusive du clergé.
Les instituteurs laïques sont donc pris, dans la seconde moitié du 19e siècle, entre deux courants idéologiques qui s'affrontent sur le terrain scolaire québécois. En 1856, deux nouvelles lois d'éducation sont votées dans le Bas-Canada. S'enclenche alors un processus de professionnalisation du corps enseignant québécois : on met sur pied des écoles normales pour former les maîtres, on fonde des associations d'instituteurs, des journaux pédagogiques ainsi qu'un fonds de pension.
Ces outils permettront aux instituteurs laïques, dès les années suivant la fondation de leur associations professionnelles, de se forger une identité et un esprit de corps qui leur servira lorsqu'il leur faudra revendiquer, entre autres lorsque leur fonds de pension sera mis en péril...
Les instituteurs laïques sont donc pris, dans la seconde moitié du 19e siècle, entre deux courants idéologiques qui s'affrontent sur le terrain scolaire québécois. En 1856, deux nouvelles lois d'éducation sont votées dans le Bas-Canada. S'enclenche alors un processus de professionnalisation du corps enseignant québécois : on met sur pied des écoles normales pour former les maîtres, on fonde des associations d'instituteurs, des journaux pédagogiques ainsi qu'un fonds de pension.
Ces outils permettront aux instituteurs laïques, dès les années suivant la fondation de leur associations professionnelles, de se forger une identité et un esprit de corps qui leur servira lorsqu'il leur faudra revendiquer, entre autres lorsque leur fonds de pension sera mis en péril...
Cet ouvrage a pour objet l'étude du discours des instituteurs laïques franco-catholiques, dans le Québec de la seconde moitié du 19e siècle. Ce discours, orienté vers l'identité professionnelle que le groupe cherche à se construire, se développe en même temps qu'est publiquement remis en cause l'investissement de l'Etat dans un secteur que plusieurs jugent encore de la responsabilité exclusive du clergé.
Les instituteurs laïques sont donc pris, dans la seconde moitié du 19e siècle, entre deux courants idéologiques qui s'affrontent sur le terrain scolaire québécois. En 1856, deux nouvelles lois d'éducation sont votées dans le Bas-Canada. S'enclenche alors un processus de professionnalisation du corps enseignant québécois : on met sur pied des écoles normales pour former les maîtres, on fonde des associations d'instituteurs, des journaux pédagogiques ainsi qu'un fonds de pension.
Ces outils permettront aux instituteurs laïques, dès les années suivant la fondation de leur associations professionnelles, de se forger une identité et un esprit de corps qui leur servira lorsqu'il leur faudra revendiquer, entre autres lorsque leur fonds de pension sera mis en péril...
Les instituteurs laïques sont donc pris, dans la seconde moitié du 19e siècle, entre deux courants idéologiques qui s'affrontent sur le terrain scolaire québécois. En 1856, deux nouvelles lois d'éducation sont votées dans le Bas-Canada. S'enclenche alors un processus de professionnalisation du corps enseignant québécois : on met sur pied des écoles normales pour former les maîtres, on fonde des associations d'instituteurs, des journaux pédagogiques ainsi qu'un fonds de pension.
Ces outils permettront aux instituteurs laïques, dès les années suivant la fondation de leur associations professionnelles, de se forger une identité et un esprit de corps qui leur servira lorsqu'il leur faudra revendiquer, entre autres lorsque leur fonds de pension sera mis en péril...