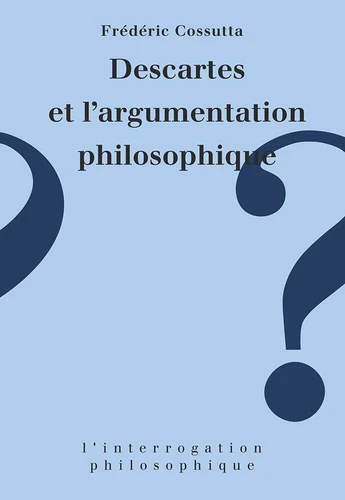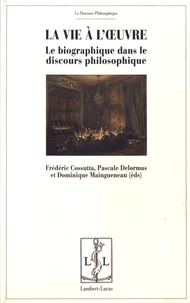Descartes et l'argumentation philosophique
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages241
- PrésentationBroché
- Poids0.345 kg
- Dimensions15,1 cm × 21,7 cm × 1,6 cm
- ISBN2-13-047493-4
- EAN9782130474937
- Date de parution01/02/1996
- CollectionL'interrogation philosophique
- ÉditeurPUF
Résumé
Les auteurs de cet ouvrage (J.F. Bordron, A. Bouvier, C. Giolito, D. Maingueneau, F. Cossutta) viennent d'horizons différents (sémiotique, sociologie cognitive, histoire de la philosophie, analyse du discours), mais ont en commun le souci de ne pas réduire les œuvres philosophiques à leurs seules structures doctrinales, et prennent en considération leurs dimensions spécifiquement langagières et discursives.
Ils s'interrogent sur la nature de l'argumentation philosophique, et proposent des modèles théoriques permettant de relier les contraintes qu'une doctrine se donne dans la recherche de sa légitimité avec les formes expressives présidant à leur mise en œuvre. Le cartésianisme offre à ce titre un exemple particulièrement éclairant, puisqu'il prétend refuser le recours aux figures de rhétorique comme aux procédés scolastiques, et veut élaborer les formes d'expressions qui garantissent simultanément la véracité et la communicabilité de son propos.
En étudiant la langue, les modes d'exposition, les genres, les formes énonciatives et narratives adoptées par Descartes dans ses écrits, les contributions ici réunies montrent que sous la clarté revendiquée d'une langue qui se voudrait celle de la raison même, s'opère un travail discursif complexe . Le philosophe doit en effet simultanément dire au plus près et au plus juste ce qu'exige l'enchaînement nécessaire des raisons, et composer avec les reformulations ou les voix multiples qu'imposent la conversion du lecteur et les stratégies d'institution de la doctrine.
Ce travail dans l'ordre du discours n'est pas dissociable de l'effort consentit pour philosopher, et c'est le mérite d'une théorie de l'argumentation philosophique de montrer comment une pensée fait œuvre.
Ils s'interrogent sur la nature de l'argumentation philosophique, et proposent des modèles théoriques permettant de relier les contraintes qu'une doctrine se donne dans la recherche de sa légitimité avec les formes expressives présidant à leur mise en œuvre. Le cartésianisme offre à ce titre un exemple particulièrement éclairant, puisqu'il prétend refuser le recours aux figures de rhétorique comme aux procédés scolastiques, et veut élaborer les formes d'expressions qui garantissent simultanément la véracité et la communicabilité de son propos.
En étudiant la langue, les modes d'exposition, les genres, les formes énonciatives et narratives adoptées par Descartes dans ses écrits, les contributions ici réunies montrent que sous la clarté revendiquée d'une langue qui se voudrait celle de la raison même, s'opère un travail discursif complexe . Le philosophe doit en effet simultanément dire au plus près et au plus juste ce qu'exige l'enchaînement nécessaire des raisons, et composer avec les reformulations ou les voix multiples qu'imposent la conversion du lecteur et les stratégies d'institution de la doctrine.
Ce travail dans l'ordre du discours n'est pas dissociable de l'effort consentit pour philosopher, et c'est le mérite d'une théorie de l'argumentation philosophique de montrer comment une pensée fait œuvre.
Les auteurs de cet ouvrage (J.F. Bordron, A. Bouvier, C. Giolito, D. Maingueneau, F. Cossutta) viennent d'horizons différents (sémiotique, sociologie cognitive, histoire de la philosophie, analyse du discours), mais ont en commun le souci de ne pas réduire les œuvres philosophiques à leurs seules structures doctrinales, et prennent en considération leurs dimensions spécifiquement langagières et discursives.
Ils s'interrogent sur la nature de l'argumentation philosophique, et proposent des modèles théoriques permettant de relier les contraintes qu'une doctrine se donne dans la recherche de sa légitimité avec les formes expressives présidant à leur mise en œuvre. Le cartésianisme offre à ce titre un exemple particulièrement éclairant, puisqu'il prétend refuser le recours aux figures de rhétorique comme aux procédés scolastiques, et veut élaborer les formes d'expressions qui garantissent simultanément la véracité et la communicabilité de son propos.
En étudiant la langue, les modes d'exposition, les genres, les formes énonciatives et narratives adoptées par Descartes dans ses écrits, les contributions ici réunies montrent que sous la clarté revendiquée d'une langue qui se voudrait celle de la raison même, s'opère un travail discursif complexe . Le philosophe doit en effet simultanément dire au plus près et au plus juste ce qu'exige l'enchaînement nécessaire des raisons, et composer avec les reformulations ou les voix multiples qu'imposent la conversion du lecteur et les stratégies d'institution de la doctrine.
Ce travail dans l'ordre du discours n'est pas dissociable de l'effort consentit pour philosopher, et c'est le mérite d'une théorie de l'argumentation philosophique de montrer comment une pensée fait œuvre.
Ils s'interrogent sur la nature de l'argumentation philosophique, et proposent des modèles théoriques permettant de relier les contraintes qu'une doctrine se donne dans la recherche de sa légitimité avec les formes expressives présidant à leur mise en œuvre. Le cartésianisme offre à ce titre un exemple particulièrement éclairant, puisqu'il prétend refuser le recours aux figures de rhétorique comme aux procédés scolastiques, et veut élaborer les formes d'expressions qui garantissent simultanément la véracité et la communicabilité de son propos.
En étudiant la langue, les modes d'exposition, les genres, les formes énonciatives et narratives adoptées par Descartes dans ses écrits, les contributions ici réunies montrent que sous la clarté revendiquée d'une langue qui se voudrait celle de la raison même, s'opère un travail discursif complexe . Le philosophe doit en effet simultanément dire au plus près et au plus juste ce qu'exige l'enchaînement nécessaire des raisons, et composer avec les reformulations ou les voix multiples qu'imposent la conversion du lecteur et les stratégies d'institution de la doctrine.
Ce travail dans l'ordre du discours n'est pas dissociable de l'effort consentit pour philosopher, et c'est le mérite d'une théorie de l'argumentation philosophique de montrer comment une pensée fait œuvre.