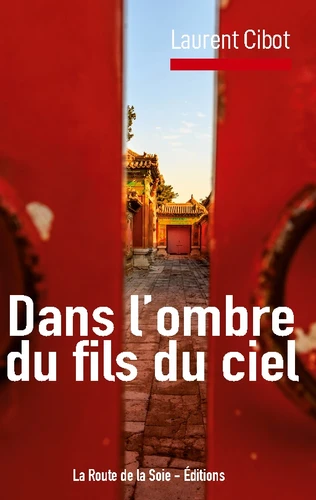Laurent Cibot est entrepreneur et écrivain. Il réside à Shanghai.
Dans l'ombre du fils du ciel. Le destin extraordinaire de Pierre Martial Cibot, jésuite à la cour de l'Empereur de Chine au XVIIIe siècle
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay indisponible
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages196
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.214 kg
- Dimensions12,0 cm × 19,0 cm × 1,3 cm
- ISBN978-2-493255-08-2
- EAN9782493255082
- Date de parution28/06/2022
- ÉditeurLa Route de la Soie
- PréfacierJean-Pierre Raffarin
Résumé
On a du mal à imaginer aujourd'hui les débats qui ont pu animer les sociétés européennes du XVIIe et du XVIIIe siècles, en France et en Angleterre notamment, sur le régime politique chinois. Les partisans des Lumières, comme Voltaire ou John Locke, opposaient les moeurs politiques et le pouvoir jugé excessif de leurs monarques, au gouvernement éclairé des Empereurs de Chine, avec une administration de mandarins bien formés et dévoués à l'intérêt général, qui tempéraient leur pouvoir en filtrant les décisions qu'ils devaient prendre.
Voltaire ne manquait pas d'écrire sur les vertus du régime chinois qui devaient inspirer l'esprit des Lumières. Cette connaissance de la Chine devait beaucoup aux jésuites qui ont servi de trait d'union entre l'Europe et l'Empire du Milieu. Pendant un siècle, ils ont servi de passeurs entre les deux extrémités de l'Eurasie, jouant sur leurs connaissances scientifiques et historiques pour se faire accepter en Chine et sur la curiosité liée à la méconnaissance d'un monde que certains philosophes européens idéalisaient pour combattre la royauté et le christianisme jugés totalitaires.
Il en résulte une sinophilie que l'on retrouve dans nos architectures et nos objets décoratifs du XVIIIe siècle, avant que la sinophobie ne s'installe dès lors que l'Empire est apparu faible, vermoulu et rétif à la modernité.
Voltaire ne manquait pas d'écrire sur les vertus du régime chinois qui devaient inspirer l'esprit des Lumières. Cette connaissance de la Chine devait beaucoup aux jésuites qui ont servi de trait d'union entre l'Europe et l'Empire du Milieu. Pendant un siècle, ils ont servi de passeurs entre les deux extrémités de l'Eurasie, jouant sur leurs connaissances scientifiques et historiques pour se faire accepter en Chine et sur la curiosité liée à la méconnaissance d'un monde que certains philosophes européens idéalisaient pour combattre la royauté et le christianisme jugés totalitaires.
Il en résulte une sinophilie que l'on retrouve dans nos architectures et nos objets décoratifs du XVIIIe siècle, avant que la sinophobie ne s'installe dès lors que l'Empire est apparu faible, vermoulu et rétif à la modernité.
On a du mal à imaginer aujourd'hui les débats qui ont pu animer les sociétés européennes du XVIIe et du XVIIIe siècles, en France et en Angleterre notamment, sur le régime politique chinois. Les partisans des Lumières, comme Voltaire ou John Locke, opposaient les moeurs politiques et le pouvoir jugé excessif de leurs monarques, au gouvernement éclairé des Empereurs de Chine, avec une administration de mandarins bien formés et dévoués à l'intérêt général, qui tempéraient leur pouvoir en filtrant les décisions qu'ils devaient prendre.
Voltaire ne manquait pas d'écrire sur les vertus du régime chinois qui devaient inspirer l'esprit des Lumières. Cette connaissance de la Chine devait beaucoup aux jésuites qui ont servi de trait d'union entre l'Europe et l'Empire du Milieu. Pendant un siècle, ils ont servi de passeurs entre les deux extrémités de l'Eurasie, jouant sur leurs connaissances scientifiques et historiques pour se faire accepter en Chine et sur la curiosité liée à la méconnaissance d'un monde que certains philosophes européens idéalisaient pour combattre la royauté et le christianisme jugés totalitaires.
Il en résulte une sinophilie que l'on retrouve dans nos architectures et nos objets décoratifs du XVIIIe siècle, avant que la sinophobie ne s'installe dès lors que l'Empire est apparu faible, vermoulu et rétif à la modernité.
Voltaire ne manquait pas d'écrire sur les vertus du régime chinois qui devaient inspirer l'esprit des Lumières. Cette connaissance de la Chine devait beaucoup aux jésuites qui ont servi de trait d'union entre l'Europe et l'Empire du Milieu. Pendant un siècle, ils ont servi de passeurs entre les deux extrémités de l'Eurasie, jouant sur leurs connaissances scientifiques et historiques pour se faire accepter en Chine et sur la curiosité liée à la méconnaissance d'un monde que certains philosophes européens idéalisaient pour combattre la royauté et le christianisme jugés totalitaires.
Il en résulte une sinophilie que l'on retrouve dans nos architectures et nos objets décoratifs du XVIIIe siècle, avant que la sinophobie ne s'installe dès lors que l'Empire est apparu faible, vermoulu et rétif à la modernité.